« Mon dialogue avec Simone Weil de Joseph-Marie Perrin : un alphabet de la vie sainte en temps de damnation, par Gregory Mion | Page d'accueil | La Messagère de Sunsiaré de Larcône, par Gregory Mion »
14/10/2023
Hors mode : entretien avec Francesco Masci, par Baptiste Rappin

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Francesco Masci dans la Zone.
 Deux critiques du bonheur fictif : L'Empire et l'absence de Léo Strintz et L'Ordre règne à Berlin de Francesco Masci.
Deux critiques du bonheur fictif : L'Empire et l'absence de Léo Strintz et L'Ordre règne à Berlin de Francesco Masci. Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.Baptiste Rappin
Cher Francesco Masci, vous venez de publier, aux Éditions Allia, Hors mode, dans lequel vous sortez des sentiers battus de la sociologie – et de son bras armé : le marketing – pour penser la mode en son essence,
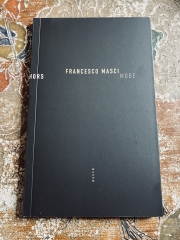 si du moins on peut parler d’essence pour appréhender ce phénomène qui se caractérise justement par son caractère éphémère. C’est ainsi, en effet, que vous rentrez dans le vif du sujet en écrivant, dès la première page de votre ouvrage, que « dans la mode, rien n’existe que le présent», puis que la mode pratique le travail «de la destruction pour la destruction ». Pourriez-vous alors préciser la nature et la structure de cette temporalité propre à la mode ? Et je me permets d’ajouter aussitôt une seconde question : faut-il y voir une temporalité propre, irréductible, ou un exemple supplémentaire de ces destructions créatrices qui caractérisent le capitalisme selon Schumpeter ?
si du moins on peut parler d’essence pour appréhender ce phénomène qui se caractérise justement par son caractère éphémère. C’est ainsi, en effet, que vous rentrez dans le vif du sujet en écrivant, dès la première page de votre ouvrage, que « dans la mode, rien n’existe que le présent», puis que la mode pratique le travail «de la destruction pour la destruction ». Pourriez-vous alors préciser la nature et la structure de cette temporalité propre à la mode ? Et je me permets d’ajouter aussitôt une seconde question : faut-il y voir une temporalité propre, irréductible, ou un exemple supplémentaire de ces destructions créatrices qui caractérisent le capitalisme selon Schumpeter ? Francesco Masci
La temporalité, la relation très particulière qu’elle entretien avec le temps, c’est en effet tout ce qui m’intéresse dans cette institution moderne qu’est la mode. Elle occupe une position hétérodoxe à l’intérieur de la modernité (telle que j’ai essayé de l’interpréter dans mon travail théorique). Car si la mode s’inscrit pleinement dans l’histoire de la modernité, elle s’en distingue justement par son travail du temps qui est, à l’intérieur de cette histoire, tout à fait original. La temporalité de la mode est une temporalité fondée sur un empilement de destructions, un temps de la catastrophe permanente. La modernité est fondée sur un double mouvement de négation et d’affirmation, refus du monde présent et promesse d’un monde différent, toujours à venir, postulé comme meilleur de celui que nous connaissons dans le présent, voire tout simplement comme un monde parfait. Il s’agit d’une temporalité progressive fondé sur un cycle récursif de promesse-attente-déception où la déception ne constitue pas une menace, le risque d’une impasse fatale de ce système, mais, au contraire, sert à redonner un nouvel élan à la production des promesses qui, par ailleurs, peuvent revêtir des contenus assez disparates, comme la justice sociale ou morale, l’équité économique ou l’égalité politique. Le contenu des promesses est de toute manière négligeable, tout ce qui compte dans la société moderne c’est que ce double mouvement formel de négation du monde présent et d’affirmation d’un monde futur enfin amendé ne connaisse pas d’entraves. Dans la mode, rien de tout cela, aucune promesse, aucune attente, juste une suite de déceptions qui s’alimente avec chaque changement de mode, pure négativité. Car la mode est faite pour se démoder, tout ce qui est à la mode est hors mode au moment même de son apparition. Le présent ici n’est subordonné ni à la critique du passé ni à l’attente du futur, il s’affirme au contraire dans l’évidence de sa seule présence injustifiée. La mode est alors une institution entièrement anhistorique et immanente, la succession de présents absolus ne trouve aucune justification dans une réalité qui lui serait transcendante. Il n’y aucun lien causal entre l’apparition d’une mode et l’autre. Le négatif ici, l’arrivée d’une nouvelle mode se fait par une négation radicale de celle qui la précède, retrouve une sorte de pureté, il ne subit pas, et c’est exactement cela qui me paraît digne de considération, le processus de positivisation qu’il a subi en Occident depuis Platon au moins et qui a constitué l’instrument central de l’expansion de la modernité. Que l’économie de marché ait pu se brancher sur cette ontologie de la destruction (et je réponds à votre question sur Schumpeter) est quelque chose de, somme toute, secondaire et prévisible. La force de l’économie n’est pas celle de dicter les lois de l’évolution sociale mais de les accompagner, de savoir toujours trouver des points d’ancrages et d’exploitation dans chacun des autres systèmes autopoïetiques qui, par un processus de différentiation fonctionnelle, forment la société moderne. Le capitalisme peut faire cela car il est aussi une manifestation de cette ontologie de la négation/affirmation du monde, lui aussi fonctionne selon le nihilisme de la promesse typiquement moderne. L’exploitation commerciale de la mode est une évidence. La mode est une activité essentiellement économique et c’est en cela qu’elle reste, malgré sa temporalité hétérodoxe, un phénomène qui est né et a connu son essor à l’intérieur de la modernité.
Baptiste Rappin
Dans la mode ne subsiste donc plus que le présent, délivré du poids des traditions et des espérances de l’avenir. Mais alors, de façon tout à fait inattendue, la catastrophe permanente met fin à la temporalité linéaire – c’est l’image traditionnelle du temps comme flèche que vous reprenez à votre compte – en réactivant une temporalité cyclique au sein de la laquelle la nouveauté, toujours déjà caduque, toujours déjà périmée, inlassablement se répète. La mode, d’une certaine manière, se reconnecte aux anciens paganismes. Vous écrivez d’ailleurs en ce sens : «Il y a une surprenante proximité entre les pratiques mondaines de la mode et les procédures extrêmement codifiées des religions et des cultes anciens». Quel lien faites-vous plus précisément entre mode et religion ? Et quelles sont la portée et les limites d’un tel rapprochement ?
Francesco Masci
Plus que de religion, avec toutes les implications de croyance ou d’une relation prémoderne entre l’homme (pas encore individu) et la société que cela comporte, il me parait plus opportun, pour la mode, de se limiter à parler de rituel. La mode a toutes les caractéristiques d’un rituel, avec cette cyclicité que vous rappeliez, ce retour incessant et ordonné de la nouveauté (ou plutôt de la différence), même si dans la mode le rituel est purement formel, il a été vidé de sa substance, le sacrifice. C’est un rituel qui tourne donc à vide ou autour du vide. Il n’y a dans la mode aucune réactivation d’une violence ancestrale, aucune mise à distance comme dans les religions traditionnelles, d’une nature menaçante et violente que le rituel se charge d’exorciser grâce à la répétition formalisée du sacrifice. Dans les religions anciennes, le rituel sert à réorganiser un monde constamment soumis à la menace d’un effondrement. Selon l’anthropologue marxiste italien Ernesto De Martino, le rituel sert, par exemple, à aider l’individu et son groupe social à dépasser la crise née de l’expérience traumatique de l’effondrement du monde, selon d’autres spécialistes des religions anciennes, le rituel renforce et oriente les désirs imaginaires de l’individu en les réinscrivant dans des formes socialement valides. Dans tous les cas, le rituel replace l’individu à l’intérieur d’une communauté, lui donne une assise stable par la participation à une forme universelle. Dans la mode qui (ne l’oublions pas) reste une institution moderne et où le rituel a fini par fusionner avec le sacrifice, la relation de l’individu avec la société est plus complexe. La mode est plutôt un rituel de désorganisation du monde, avec le vide au centre. L’individu y trouve un outil pour se distinguer des autres tout en entérinant la reconnaissance du groupe social, il y pratique un exercice paradoxal où la distinction et le mimétisme coïncident. Avec la mode, l’individu ne fait pas seulement l’apprentissage de sa propre vacuité, du néant qui le constitue, la succession incessante de formes qui le traversent n’ayant aucune raison d’être, aucune consistance, mais il apprend aussi à gérer sa propre représentation dans l’instabilité essentielle d’une société qui est vouée à la contingence radicale. La mode est un rituel avec lequel le sujet célèbre sa propre disparition comme unité significative de la société, sans drame. On peut aussi ajouter, accessoirement, que la mode est aussi un rituel de pure destruction. On y pratique le recyclage infini des images et des fictions créées par la culture absolue et qui débordent le monde. La production imaginaire est au cœur même de la société moderne, c’est par elle que s’enclenche cette temporalité progressive de la promesse-attente-déception dont nous parlions précédemment. C’est par elle aussi que l’individu retrouve une nouvelle forme d’entièreté et d’autonomie que la technique (ou mieux, l’ensemble des techniques modernes, comme le droit, la médecine, l’économie, etc.) lui ont déniées. Ces fictions dont est traversé le sujet (un sujet éphémère et très instable, comme on vient de le voir) deviennent caduques de plus en plus rapidement. La mode pratique l’holocauste de ces formes nécessaires mais surabondantes, double toujours excédentaire de la production matérielle.
Baptiste Rappin
C’est peut-être ici qu’il faudrait ouvrir une parenthèse car vous venez de manier des concepts – culture absolue, image,
 fiction, subjectivité fictive, modernité – qui, s’ils sont familiers aux lecteurs de vos précédents ouvrages, peuvent apparaître comme sinon obscurs du moins flous à tous ceux qui découvrent votre travail à travers cet entretien. Pourquoi la production d’images est-elle au cœur de la modernité ? Vous affirmez par ailleurs, dans votre Traité anti-sentimental, que «[notre] société continue à être massivement conditionnée par la technique mais [que] les images se sont désolidarisées du futur et, toujours maîtresses du réel, ont commencé à fonctionner à rebours». Quel est alors ce revirement, «autonome et funeste» écrivez-vous encore, que nous sommes en train de vivre ? Cette bascule a-t-elle un lien avec la «culture absolue» qui, selon ce que vous écrivez dans L’ordre règne à Berlin, se trouve en position hégémonique par rapport au pouvoir techno-politique ?
fiction, subjectivité fictive, modernité – qui, s’ils sont familiers aux lecteurs de vos précédents ouvrages, peuvent apparaître comme sinon obscurs du moins flous à tous ceux qui découvrent votre travail à travers cet entretien. Pourquoi la production d’images est-elle au cœur de la modernité ? Vous affirmez par ailleurs, dans votre Traité anti-sentimental, que «[notre] société continue à être massivement conditionnée par la technique mais [que] les images se sont désolidarisées du futur et, toujours maîtresses du réel, ont commencé à fonctionner à rebours». Quel est alors ce revirement, «autonome et funeste» écrivez-vous encore, que nous sommes en train de vivre ? Cette bascule a-t-elle un lien avec la «culture absolue» qui, selon ce que vous écrivez dans L’ordre règne à Berlin, se trouve en position hégémonique par rapport au pouvoir techno-politique ? Francesco Masci
Depuis mon premier livre, Superstitions, j’essaie d’élaborer une lecture de la modernité qui ne soit pas une énième version de l’auto-interprétation que cette dernière a élaborée et qui sert à accompagner son évolution comme un véritable outil de reproduction. J’ai essayé alors de m’extirper d’un récit fondé sur une dichotomie manichéenne, récit qui assigne à la technique et à l’économie les rôles de grands méchants et à la culture et aux images celui de la victime inerme qui, à cause même de sa pureté, finit soumise et asservie mais ne cesse pas pour autant de se battre contre le mal. Cette narration folklorique (qu’on retrouve, plus ou moins maquillée, dans presque toute la philosophie contemporaine) est trop simpliste, incapable de saisir dans toute sa complexité la structure sociale mais aussi le soubassement ontologique de la modernité. J’essaierai ici de résumer de manière succincte ma propre lecture de la modernité, en prévenant le lecteur de cet entretien que je serai obligé d’être un peu
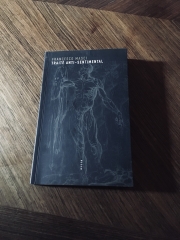 cavalier avec l’histoire et de faire l’impasse sur beaucoup de crises et de ruptures historiques internes qu’elle a connu dans son évolution. La modernité naît aux alentours de la fin du XIVe siècle, à cause d’un ensemble de raisons sur lesquelles il serait trop long de s’attarder ici, avec le passage d’une société structurée de manière verticale avec des rôles sociaux astreints à une très grande fixité à une société se déployant de manière horizontale et devenue extrêmement mobile. Elle est immédiatement confrontée à un paradoxe, le paradoxe original pourrait-on dire, le premier d’une longue série, car la modernité est essentiellement une machine à poser et à résoudre des paradoxes. Si d’un côté, par l’effondrement de la société verticale structurées par castes, elle donne naissance à l’individu comme sujet autonome pouvant prétendre à une liberté illimitée, d’un autre côté elle est aussi à l’origine d’une société qui n’aura de cesse, dans son évolution et fragmentation en sous-systèmes fonctionnellement différenciés et avec le concours de la technique, d’empiéter sur cette même liberté jusqu’à la nier complètement. Comment peut-on alors assurer la liberté à un individu qui se trouve de plus en plus pris dans les mailles fines d’une société vouée à la contingence radicale et à une technicisation rampante ? Pour résoudre ce paradoxe fondateur, la modernité a parié sur les images, c’est-dire sur une fictionnalisation du sujet. Avec un raccourci, on pourrait dire qu’elle a choisi la voie de l’Utopie de Thomas More, la voie de «la culture absolue» (je vais revenir sur ce concept) par rapport au réalisme très conflictuel du politique, la voie ouverte par Machiavel qui, à cause d’un coût trop élevé (en un sens élargi, je ne parle pas ici du marché) s’est révélée une voie non praticable dans une société qui devenait de plus en plus universelle et inclusive et a été rapidement abandonnée. La liberté de l’individu a été alors posée comme une liberté qui est toujours à venir et qui ne pourra se matérialiser pleinement que dans un monde autre appelé à remplacer ou mieux à sauver la réalité déficiente à laquelle l’individu est confronté dans le présent. La culture est chargée non pas seulement d’annoncer avec les images, les fictions et les événements qu’elle produit, ce nouveau monde mais aussi de le faire concrètement advenir. La société moderne a fini par se structurer selon un double régime, avec d’un côté la technique qui s’empare de la vie biologique et sociale décomposant l’individu en une série d’actes et symptômes analysables de manière objective et neutre et le déprivant de toute maîtrise et sur soi-même et sur la réalité et, de l’autre côté, celle que j’appelle la «culture absolue», la production incessante d’images et d’événement qui, par la promesse d’un monde régénéré, redonne à l’individu une nouvelle intégrité au prix pourtant de sa croissante fictionalisation et dématérialisation. En gros, l’individu n’est souverain et libre qu’en tant que cristallisation momentanée d’images qui le traversent et qui ne lui appartiennent pas, en tant que subjectivité fictive donc. Il ne vit que dans et par cette temporalité de la promesse-attente-déception que nous avons à maintes reprises évoquée dans cet entretien. Ce double régime où la technique et la culture absolue travaillent séparées mais en couplage structurel se met en place de manière définitive après la fin de la Révolution française, événement qui représente la dernière tentative, certes maladroite car déjà abondamment compromise par la culture et la morale, faite par le politique pour devenir la principale force d’organisation de la société. C’est avec les pré-romantiques allemands que la rhétorique «révolutionnaire» de la culture absolue trouve sa première formulation, dans le «messianisme romantique» de la revue Athenaeum. C’est à ce moment même que la culture devient «absolue» c’est-à-dire qu’elle opère une séparation, une véritable apostasie de la société considérée comme moralement déficiente, société qu’elle soumet au procès d’une critique perpétuel dans l’intention d’aboutir à la rédemption mondaine de la réalité. Cette surenchère de promesses toujours déçues et toujours renouvelées trouvera avec les avant-gardes artistiques des années 1910-1920 un moment autoréflexif de critique interne (le «Royaume de Dieu» annoncé par Novalis tardait à arriver et les images commençaient à s’impatienter) mais cette critique réflexive ne remet pas du tout en question la double partition entre la technique et la culture absolue, tout au contraire, elle la renforce même, inaugurant une époque où la production des fictions n’a fait que s’accélérer. Ce n’est que récemment (et c’est le passage du «Traité anti-sentimental» que vous citez) que ce système à double moteur semble entrer dans une phase d’implosion qui pourrait lui être fatale, car les images ont commencé à vouloir se convaincre qu’elles étaient capables d’assurer la consistance du monde présent. Au lieu de pointer vers le futur, elles se font les garantes de la solidité du monde présent. Dans la quête forcenée d’une certitude impossible, elles ont fini par réintroduire dans la modernité des notions que celle-ci avait délaissées, comme la notion de vérité par exemple. Une vérité qui, en absence d’un critère transcendant, dans un monde qui continue malgré tout à être un produit de la pure contingence, ne peut être validée que par le savoir des «sentiments» qui, dans leur particularité et fragmentation impressionniste, restent la proie des fictions et des images contradictoires et conflictuelles. La vérité se confond ainsi avec une logorrhée morale qui réussit dans l’exploit de se présenter comme absolutiste et relativiste en même temps. La culture absolue essaie aussi, vainement, de soustraire le bios au domaine de la technique avec des trouvailles rhétoriques stériles et pernicieuses, le «vivant» ou la «vraie vie», dernières superstitions culturelles dans une société d’où toute trace de vie authentique paraît avoir complètement disparu. La modernité est désormais confrontée à un paradoxe majeur qu’elle ne semble (pour l’instant) pas capable de savoir résoudre, celui constitué par des fictions qui ont arrêté de «faire comme si», qui ne jouent plus, en accord structurel avec la technique, le pari de la promesse et du futur mais qui infectent le présent, un présent dont la maîtrise continue pourtant à leur échapper, d’un virus moral et identitaire. La société moderne semble alors rétrocéder dans un monde pré-hobbesien formé par des micro-communautés en perpétuelle guerre (imaginaire) entre elles. L’issue la plus envisageable de cette impasse est alors un débordement de la technique (qui ne connaît, elle, aucun répit dans son travail de démembrement de l’individu) et la fusion, sous la haute juridiction totalitaire de cette dernière, du bios avec le monde des images. La fin de la dichotomie technique/culture absolue dans un monde entièrement et uniquement géré par la technique. Le clone comme image parfaite bio-techniquement reproduite.
cavalier avec l’histoire et de faire l’impasse sur beaucoup de crises et de ruptures historiques internes qu’elle a connu dans son évolution. La modernité naît aux alentours de la fin du XIVe siècle, à cause d’un ensemble de raisons sur lesquelles il serait trop long de s’attarder ici, avec le passage d’une société structurée de manière verticale avec des rôles sociaux astreints à une très grande fixité à une société se déployant de manière horizontale et devenue extrêmement mobile. Elle est immédiatement confrontée à un paradoxe, le paradoxe original pourrait-on dire, le premier d’une longue série, car la modernité est essentiellement une machine à poser et à résoudre des paradoxes. Si d’un côté, par l’effondrement de la société verticale structurées par castes, elle donne naissance à l’individu comme sujet autonome pouvant prétendre à une liberté illimitée, d’un autre côté elle est aussi à l’origine d’une société qui n’aura de cesse, dans son évolution et fragmentation en sous-systèmes fonctionnellement différenciés et avec le concours de la technique, d’empiéter sur cette même liberté jusqu’à la nier complètement. Comment peut-on alors assurer la liberté à un individu qui se trouve de plus en plus pris dans les mailles fines d’une société vouée à la contingence radicale et à une technicisation rampante ? Pour résoudre ce paradoxe fondateur, la modernité a parié sur les images, c’est-dire sur une fictionnalisation du sujet. Avec un raccourci, on pourrait dire qu’elle a choisi la voie de l’Utopie de Thomas More, la voie de «la culture absolue» (je vais revenir sur ce concept) par rapport au réalisme très conflictuel du politique, la voie ouverte par Machiavel qui, à cause d’un coût trop élevé (en un sens élargi, je ne parle pas ici du marché) s’est révélée une voie non praticable dans une société qui devenait de plus en plus universelle et inclusive et a été rapidement abandonnée. La liberté de l’individu a été alors posée comme une liberté qui est toujours à venir et qui ne pourra se matérialiser pleinement que dans un monde autre appelé à remplacer ou mieux à sauver la réalité déficiente à laquelle l’individu est confronté dans le présent. La culture est chargée non pas seulement d’annoncer avec les images, les fictions et les événements qu’elle produit, ce nouveau monde mais aussi de le faire concrètement advenir. La société moderne a fini par se structurer selon un double régime, avec d’un côté la technique qui s’empare de la vie biologique et sociale décomposant l’individu en une série d’actes et symptômes analysables de manière objective et neutre et le déprivant de toute maîtrise et sur soi-même et sur la réalité et, de l’autre côté, celle que j’appelle la «culture absolue», la production incessante d’images et d’événement qui, par la promesse d’un monde régénéré, redonne à l’individu une nouvelle intégrité au prix pourtant de sa croissante fictionalisation et dématérialisation. En gros, l’individu n’est souverain et libre qu’en tant que cristallisation momentanée d’images qui le traversent et qui ne lui appartiennent pas, en tant que subjectivité fictive donc. Il ne vit que dans et par cette temporalité de la promesse-attente-déception que nous avons à maintes reprises évoquée dans cet entretien. Ce double régime où la technique et la culture absolue travaillent séparées mais en couplage structurel se met en place de manière définitive après la fin de la Révolution française, événement qui représente la dernière tentative, certes maladroite car déjà abondamment compromise par la culture et la morale, faite par le politique pour devenir la principale force d’organisation de la société. C’est avec les pré-romantiques allemands que la rhétorique «révolutionnaire» de la culture absolue trouve sa première formulation, dans le «messianisme romantique» de la revue Athenaeum. C’est à ce moment même que la culture devient «absolue» c’est-à-dire qu’elle opère une séparation, une véritable apostasie de la société considérée comme moralement déficiente, société qu’elle soumet au procès d’une critique perpétuel dans l’intention d’aboutir à la rédemption mondaine de la réalité. Cette surenchère de promesses toujours déçues et toujours renouvelées trouvera avec les avant-gardes artistiques des années 1910-1920 un moment autoréflexif de critique interne (le «Royaume de Dieu» annoncé par Novalis tardait à arriver et les images commençaient à s’impatienter) mais cette critique réflexive ne remet pas du tout en question la double partition entre la technique et la culture absolue, tout au contraire, elle la renforce même, inaugurant une époque où la production des fictions n’a fait que s’accélérer. Ce n’est que récemment (et c’est le passage du «Traité anti-sentimental» que vous citez) que ce système à double moteur semble entrer dans une phase d’implosion qui pourrait lui être fatale, car les images ont commencé à vouloir se convaincre qu’elles étaient capables d’assurer la consistance du monde présent. Au lieu de pointer vers le futur, elles se font les garantes de la solidité du monde présent. Dans la quête forcenée d’une certitude impossible, elles ont fini par réintroduire dans la modernité des notions que celle-ci avait délaissées, comme la notion de vérité par exemple. Une vérité qui, en absence d’un critère transcendant, dans un monde qui continue malgré tout à être un produit de la pure contingence, ne peut être validée que par le savoir des «sentiments» qui, dans leur particularité et fragmentation impressionniste, restent la proie des fictions et des images contradictoires et conflictuelles. La vérité se confond ainsi avec une logorrhée morale qui réussit dans l’exploit de se présenter comme absolutiste et relativiste en même temps. La culture absolue essaie aussi, vainement, de soustraire le bios au domaine de la technique avec des trouvailles rhétoriques stériles et pernicieuses, le «vivant» ou la «vraie vie», dernières superstitions culturelles dans une société d’où toute trace de vie authentique paraît avoir complètement disparu. La modernité est désormais confrontée à un paradoxe majeur qu’elle ne semble (pour l’instant) pas capable de savoir résoudre, celui constitué par des fictions qui ont arrêté de «faire comme si», qui ne jouent plus, en accord structurel avec la technique, le pari de la promesse et du futur mais qui infectent le présent, un présent dont la maîtrise continue pourtant à leur échapper, d’un virus moral et identitaire. La société moderne semble alors rétrocéder dans un monde pré-hobbesien formé par des micro-communautés en perpétuelle guerre (imaginaire) entre elles. L’issue la plus envisageable de cette impasse est alors un débordement de la technique (qui ne connaît, elle, aucun répit dans son travail de démembrement de l’individu) et la fusion, sous la haute juridiction totalitaire de cette dernière, du bios avec le monde des images. La fin de la dichotomie technique/culture absolue dans un monde entièrement et uniquement géré par la technique. Le clone comme image parfaite bio-techniquement reproduite.Baptiste Rappin
Revenons alors à la mode : puisqu’elle procède rituellement à l’élimination des images, doit-on dire d’elle qu’elle met en péril la modernité ou alors, tout au contraire, qu’elle fait partie des montages anthropologiques de sa stabilisation dynamique – c’est finalement par le sacrifice régulier des images présentes que les prochaines fictions peuvent entrer en scène ? Au fond : la désorganisation du monde engendrée par le rituel de la mode se réduit-elle, ou non, à un mécanisme de régulation homéostatique de la société moderne ?
Francesco Masci
Je vais (afin de compenser la longueur de ma réponse précédente), répondre de manière assez brève à cette question. La mode n’est un mécanisme de régulation homéostatique, comme vous le définissez, que de manière secondaire, je dirais même de manière tout-à-fait indirecte. Oui elle participe à la stabilisation dynamique de la modernité, à la gestion immanente du flux des contingences, mais elle n’a aucune fonction propre, en soi la mode ne sert à rien, elle sert le rien plutôt. Je préfère me focaliser sur ses différences et ses spécificités, la présentification du néant jamais dramatisée ni par la morale ni par la politique, qui en font, à l’intérieur de la modernité, un point d’observation privilégié sinon unique pour comprendre les mécanismes de celle-ci, son fonctionnement et ses impasses.
Baptiste Rappin
D’ailleurs, ce «rien» ne concerne pas seulement le monde et la temporalité : il caractérise de surcroît les corps qui se drapent des atours de la mode. Et vous heurtez ici encore le sens commun : pour beaucoup, la mode – qu’elle en soit le moteur ou le reflet est ici secondaire – a affaire avec une érotisation générale de la société, que l’on se réfère, entre autres, au capitalisme de la séduction de Michel Clouscard ou à la transparence pornographique des simulacres chez Jean Baudrillard. Mais si la mode vide le corps et que celui-ci n’est plus rien, c’est qu’il a alors perdu toute charge positive, toute chair, tout désir d’union. Vous en allez même jusqu’à voir dans le mannequin un « être-cyborg », c’est-à-dire un corps artificiel, mécanique, machinique. Comment expliquez-vous ce décharnement opéré par la mode sur les corps ?
Francesco Masci
Il y a peut-être une érotisation qui investit la mode, mais cela reste une érotisation toute publicitaire, une ruse de la raison marchande qui n’a strictement rien avoir avec le désir du corps et son exposition à une quelconque transcendance. Pornographie (si on revient à l’étymologie du mot, le grec pernanai vendre) plus qu’éros. Le corps n’est plus dans la mode, qui se révèle ici une institution parfaitement moderne, que le support neutre pour des identités fictives et transitoires. La mode, telle qu’on la connaît, ne pouvait se développer qu’à l’intérieur d’une société puritaine où la dissociation entre l’âme et le corps est enfin accomplie. Elle ne participe pas au processus de dépersonnalisation que la double gestion de la technique et de la culture absolue ont fait subir au sujet, mais, une fois ce processus achevé, elle ouvre au sujet un champ infini de possibilités pour jouer avec les mutations de son apparence sans qu’il ait à subir la sanction d’une perte d’identité. Même, c’est à travers ces mutations que le sujet essaie d’affirmer sa présence paradoxale au monde en tant qu’entité égale mais distincte des autres, en accomplissant un mouvement exactement contraire au mouvement de déperdition de soi qui caractérise l’éros. Les autres individus ne sont plus qu’un miroir sur lequel se réfléchit un sujet qui a été doublement dépossédé de son identité, par la technique qui a réduit son corps à une multiplicité de fonctions désorganisées et par la culture absolue qui lui octroie certes une nouvelle identité mais seulement en tant que cristallisation éphémère d’images universelles, d’images neutres qui appartiennent à tout le monde (comme les images «personnelles» mais aussi strictement identiques qui circulent sur les réseaux sociaux) et qui ne font que le traverser. Le mannequin porte à son paroxysme cette transformation de l’humain en artefact. Le mannequin est un sujet qui embrasse de plein gré son devenir-machine. C’est une femme à tout jamais séparée des autres, par laquelle cette séparation devient un geste assumé, elle ne demande rien, elle n’entretient avec les autres aucune relation de reconnaissance, elle n’a rien à prendre ni rien à dépasser, entièrement fermée dans la suspension d’une pure apparence. Son attitude affirme sans détours que ce qui est déjà rien ne peut pas s’offrir, comme dans l’éros, à l’expérience de l’anéantissement. Le cliché d’une certaine culture populaire qui fait du mannequin la compagne idéale du jeune loup de la finance dévoile, sans le vouloir, une petite vérité. La beauté du mannequin est un pur bien spéculatif qui a perdu sa valeur de référence matérielle, ne représente plus rien sinon la négation de toutes les valeurs incarnées, affirmation d’une singularité monadique, solitaire et interchangeable.
Baptiste Rappin
Ce que révèle le mannequin, c’est alors le rapport général que la mode entretient avec la nature et la réalité. On pourrait ici se risquer à détourner une célèbre expression de Heidegger et énoncer que le caractère essentiel de la mode se niche dans « l’oubli de l’être ». Nous commencions notre dialogue en pointant la place centrale du néant dans la mode, et nous voici à présent sur le point de le conclure en retrouvant le néant de l’artifice, ou mieux dit, le sempiternel procès de néantisation de l’artifice de la mode qui, contrairement à l’œuvre d’art, a coupé, de façon péremptoire, tous les ponts avec l’idée d’une référence. Pourtant, sauf inattention de ma part, vous ne prononcez pas le terme de «nihilisme» et cela, je crois, ne peut qu’être un choix délibéré de votre part. Voici donc mes dernières questions : diriez-vous que la mode accomplit une forme de nihilisme propre à l’histoire de l’Occident ? Et quelle attitude adopter face à la mode, si ce n’est celle tragique qui, ayant renoncé à toute attente, consiste à accepter la logique du néant ?
Francesco Masci
C’est une question, au mieux ce sont deux questions très complexes que vous posez là. Évoquer le problème du nihilisme en Occident signifie se confronter avec des difficultés presque inextricables. Je vais prendre à contre-pied votre citation heideggérienne, pour dire que plus que dans l’oubli de l’être, la mode telle qu’on la connaît, ou telle qu’on l’a connue jusqu’à nos jours (elle est train d’être réinscrite dans un circuit classique de négation-affirmation celui de la « critique » hypocrite du monde caractéristique de la « culture absolue »), bref, plus que dans l’oubli de l’être le caractère essentiel de la mode se trouve dans l’affirmation du néant. Un néant qui, justement, n’étant pas subordonné à l’Être n’est pas à même d’en infecter toutes ses manifestations ce qui est, à mon avis, la vraie substance du nihilisme. Le néant qui s’expose dans la mode est comme, dirait Anaximandre, le « principe des choses qui sont » (fragm. D.K. 12 B.1). Le concept de nihilisme, qui est sans doute central dans l’histoire de l’Occident, doit être manié avec une certaine précaution. Il faudrait alors faire la distinction entre deux sortes de nihilismes. Il y a un nihilisme présocratique (même si cette désignation est déjà en soi problématique), la vérité d’un monde dans lequel, comme Giorgio Colli l’a magnifiquement démontré, loin des mensonges du logos, l’Être et le Néant étant des principes séparés, les choses qui sont apparaissent dans la claire lumière d’une pure présence que rien ne justifie et qui n’est justifiée que par le rien. Tout autre est le nihilisme qui, à partir du parricide platonicien (la critique de Parménide par Platon qui correspond aussi à l’institutionnalisation du logos et de la dialectique comme les seules formes légitimes de la pensée philosophique) a introduit le néant dans l’être en condamnant la réalité du monde occidental à une carence ontologique chronique. Pour paradoxal que cela puisse paraître, la mode, cette activité futile et commerciale nichée au milieu de la modernité, réactive un néant qui est dépourvu de la puissance délétère que Platon lui a conférée dans une décision dramatique pour l’histoire de l’Occident. La mode fonctionne (ou elle a fonctionné jusqu’à maintenant) comme une chambre noire particulière où le monde retrouve, de manière éphémère, cette présence hasardeuse et évanescente que la lourdeur du mécanisme de dénégation fondée sur une ontologie foncièrement nihiliste lui avait déniée. Le monde est accepté pour ce qui est car, justement, il n’a aucune justification ontologique. Il est accepté tel qu’il est car il est proprement rien (ce n’est pas un hasard si deux écrivains aussi différents l’un de l’autre, mais également sensibles à la puissance du néant, comme Leopardi et Mallarmé, se sont intéressés à la mode). Le néant introduit par Platon pour justifier le devenir de l’être et ses changements, a fini par contaminer la réalité devenue ainsi une réalité minorée, l’ombre insignifiante (sinon mauvaise) d’un réel parfait qui se trouve toujours ailleurs (ailleurs qui peut se situer dans la partie supérieure et transcendante d’un ordre fixe ou dans l’avenir d’un ordre immanent mobile et temporel). Platon a opéré un dédoublement du réel qui, si dans Christianisme reste encore statique, sera mis en branle et rendu entièrement immanent par la modernité, sans que la dévalorisation du présent ne soit aucunement atténuée. L’acceptation tragique du néant dont vous parlez correspond alors exactement à toute l’histoire de l’Occident, comme à une destinée marquée par le signe du négatif et par l’emprise du rien. Malgré leurs énormes différences qui les séparent les unes des autres, les grandes doctrines (les -ismes-) qui ont tour à tour guidé ou essayé d’orienter cette histoire sont l’expression d’une même ontologie qui, liant ensemble l’être et le néant a contribué à la dévalorisation de notre réalité avec, comme conséquence inévitable, sa fictionnalisation moralisante d’un côté et sa technicisation totalitaire de l’autre. La mode telle qu’on l’a connaît, cette succession cataclysmique de présents absolus n’a peut-être été qu’une fantasmagorie née à la moitié du XIXe siècle au moment même au la bourgeoisie, cette classe sociale destinée à devenir une forme de vie universelle, se retrouvait prisonnière du présent (incapable de revenir au passé comme sa classe ennemie, l’aristocratie, et ayant perdu la maitrise du futur et de la Révolution au profit du prolétariat), fantasmagorie qui est aussi destinée à s’éteindre, submergée par l’ombre totalitaire d’un nihilisme bienveillant, progressiste (même quand il invoque la force de la tradition) et moralisateur, unique loi et justice de l’Occident.




























































 Imprimer
Imprimer