« Seiobo est descendue sur terre de László Krasznahorkai, par Gregory Mion | Page d'accueil | Exterminez toutes ces brutes ! de Sven Lindqvist »
20/09/2019
Journal de Belfort ou du mouvement et de l'immobilité de Béatrice Douvre
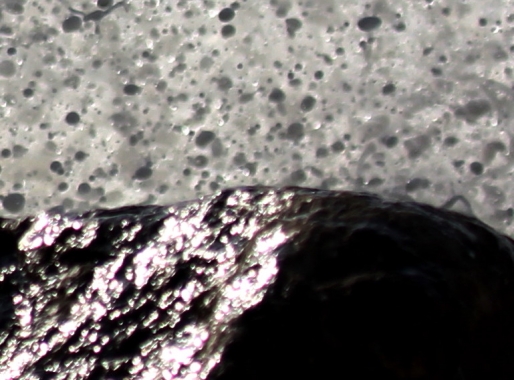
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Je ne savais strictement rien de Béatrice Douvre avant que Jean-Yves Masson, traducteur de l'onirique Jardin de la connaissance de Leopold Andrian évoqué dans la Zone, ne me contacte et n'ait l'amabilité de m'envoyer un exemplaire de ce Journal de Belfort paru aux éditions de La Coopérative qu'il dirige. L'avant-propos ne nous donne que quelques indications, assez fugaces, sur la vie de cette poétesse née en 1967 et morte en 1994, le texte ou, plutôt, les textes qui composent cet ouvrage ayant été écrits durant les six derniers mois de sa vie.
Je ne savais strictement rien de Béatrice Douvre avant que Jean-Yves Masson, traducteur de l'onirique Jardin de la connaissance de Leopold Andrian évoqué dans la Zone, ne me contacte et n'ait l'amabilité de m'envoyer un exemplaire de ce Journal de Belfort paru aux éditions de La Coopérative qu'il dirige. L'avant-propos ne nous donne que quelques indications, assez fugaces, sur la vie de cette poétesse née en 1967 et morte en 1994, le texte ou, plutôt, les textes qui composent cet ouvrage ayant été écrits durant les six derniers mois de sa vie.Il est assez difficile de caractériser le genre auquel appartient le Journal de Belfort qui, incontestablement, évoque les pensées de Béatrice Douvre, ses joies et ses peines, ses difficultés à se faire aimer d'un homme apparemment attiré par d'autres hommes alors qu'elle-même, plus d'une fois, ne semble pas être insensible aux femmes qui l'entourent, un texte pratiquement tenu chaque jour mais qui, par son écriture même, déborde très largement le cadre convenu du journal, comme celui d'Alejandra Pizarnik. Ce pourrait être le texte purement imaginaire, donné comme une suite de poèmes en prose, que cela conviendrait bien mieux à ce fascinant objet qu'est le journal de Béatrice Douvre qui, à notre sens, existe bel et bien, mais sous le titre Passante du péril, explicitement sous-titré Journal d'une anorexique, également contenu dans ce beau volume.
Je ne m'aventurerais pas à évoquer trop pesamment la singularité des textes de Béatrice Douvre, d'abord parce que je crains qu'il ne soit difficile d'en dire quoi que ce soit de juste et d'intelligent qui ne soit pas une explication maladroite et convenue, ensuite, et cette raison est la probable cause de la première, parce que, de toutes les paroles, la parole poétique est celle qui se suffit le plus amplement à elle-même, celle qui le moins souffre de langages seconds, critiques, bêtement ou même intelligemment explicatifs.
Bien sûr, me frappent toutefois plusieurs thématiques, non point originales, puisqu'il s'agit du travail sur l'écriture, de la quête de la réelle présence, de la recherche d'une certaine verte primitivité pour le dire avec Kierkegaard, de la souffrance physique, etc., non point originales donc, et aussi parce que Béatrice Douvre semble avoir beaucoup lu, elle qui n'est plus «que lecteur qui ouvre tous les livres» (25 mars 1994, p. 77), mais qu'il est toutefois intéressant d'évoquer dans leurs liens réciproques, leur entremêlement composant un motif dans le tapis assez fascinant.
Je crois que la figure qui le mieux résumerait ces thématiques, mais aussi la façon dont elles se nouent dans le corps et l'esprit de Béatrice Douvre, est celle de l'offrande : notre poétesse, littéralement, se donne, acceptant (la recherchant ?) par avance la souffrance entrevue, puisqu'il s'agit, dans tous les cas, de parvenir à une «écriture endurcie, resserrée», et d'accomplir le si dur «devoir des mots à chercher, dans l'offrande des gravats noirs à étreindre» (16 avril 1994, p. 19), cela alors même, paradoxalement, que le corps de Béatrice Douvre se refuse, ou plutôt : se dérobe, elle qui écrira ainsi «dans le sang du refus [son] corps absent» (21 février 1994, p. 24).
C'est l'ensemble du Journal de Belfort qui manifeste ce désarroi, d'autant plus poignant, et c'est le sens premier du terme offrande qui, dans ce cas, retient mon attention, que la poétesse avoue sans fard, bien des fois, qu'elle est «de celles qui lavent les pieds et les bénissent en pleurant sous les chevelures dorées» (23 février 1994, p. 27), cette quête, appelons-la quête de la réelle présence au sens spirituel sinon religieux de l'expression, ne pouvant bien évidemment pas être séparée d'une autre quête tout aussi essentielle pour qui prétend faire acte de poésie, et qui concerne le langage. C'est tout un d'ailleurs, puisque «chercher la trace du divin», c'est «perdre la trace de la ligne», comme si Béatrice Douvre, dans son implacable recherche, voulait non seulement «le mot rugueux, le verbe brisé, la phrase étrange» mais aussi «le salut dans [ses] mains de charité» (24 février 1994, p. 29).
Cette image, silencieuse pour ainsi dire car elle ressemble à une espèce d'icône, est somptueuse : «J'ai la transparence rousse des vitraux et les genoux glacés aux dalles d'adoration» (idem, p. 30), où est admirablement dite l'urgence de la rencontre indissociable de la perte du langage, que l'on a pourtant tordu dans tous les sens pour, justement, parvenir à cette rencontre, qui ne sera jamais mieux nommée que par l'irruption, non pas du Christ, mais, enfantinement, dans une bouleversante proximité, une naïve intimité, de Christ : «Christ au calvaire me creuse. J'ai son visage dans mes mains d'oblation. La Cène est salvatrice. Parole commune et communion des corps. Je suis sauvée par la douleur» (5 mars 1994, p. 45).
Comment ne le serait-elle pas, puisqu'elle se déclare «la servante du Verbe, feu liquide de Dieu-esprit tombant au sol pour marcher vers la ville promise» (8 mars 1994, p. 52) et, qu'après tout, le monde entier peut bien l'accabler puisque, évident rappel de Bernanos et de sainte Thérèse de Lisieux, «tout est grâce» (3 mars 1994, p. 41). Je n'aime pas convertir de force des écrivains, la lecture apologétique d'un texte ou de plusieurs textes me paraissant l'une des plus pauvres, mais nous serions après tout en droit d'imaginer bien des trajectoires possibles à Béatrice Douvre si elle eût encore été des nôtres, dont la possibilité de labourer ce sillon toujours plus profondément.
Nous pourrions multiplier les exemples tant ils abondent dans le Journal de Belfort (comme «J'irai aux dalles claires des églises babyloniennes, prier et demeurer auprès du Christ froid», 9 mars 1994, p. 55; «Encore, les infidélités me forment en louanges. Christ est plongé dans l'obscur des tables. Je suis imparfaite priante», entre le 15 et le 17 mars 1994, p. 63), que nous ne serions pas davantage convaincus par cette évidence : Béatrice Douvre, d'une façon bien moins métaphorique qu'on ne pourrait le supposer, s'est offerte, autrement dit a fait don d'elle-même, de son corps (1), de tous ses talents au sens biblique du terme et d'abord de celui qui la courbe, humblement, sur la pâte chaude du langage qu'il s'agira de pétrir et de faire gonfler, pour espérer pouvoir voir ce qu'il en sortira, peut-être même toucher, «le pain de présence et le vin de vigueur, levés sur la table de bois, de porphyre» (idem, p. 54).
Quête impossible même si, ici ou là, de lumineuses trouées se produisent, qui peuvent nous faire croire que la poétesse a trouvé une oasis où faire halte, dans une magnifique abolition des saisons et des âges, dans un temps suspendu, riche et plein comme un retour à l'âge d'or (2) ! Toucher de ces doigts la réelle présence qui, nous assure Béatrice Douvre, «est morte aujourd'hui comme une feuille sèche» (28 mars 1994, p. 83), en biffant son corps, en le détestant sûrement («Je suis l'anorexique aux lèvres refusées, dans le miroir et la balance, l'enfer glacé des sables», 31 mars 1994, p. 88), se considérer comme la femme, la servante délaissée, dont la «volupté est incapable» (7 avril 1994, p. 95), accéder au Verbe, du moins à son reflet, en rejetant, dans un geste qui nous rappelle celui, définitif, de Rimbaud, le langage dans la bassine où flottent pêle-mêle vieilleries poétiques et rinçures ! Béatrice Douvre, que l'on devine exténuée à mesure qu'on la lit, aurait-elle vraiment plus de force qu'Arthur Rimbaud, noir démon de vigueur et de force ? La réponse est évidente, tout autant que la parade qu'exécute la poétesse puisque, s'il est décidément impossible de parvenir à l'Être, autant tenter de le désigner par son contraire, selon les enseignements de la voie apophatique non seulement commune aux saints et aux mystiques, mais aux poètes quelque peu conséquents, et qui, plus que tant d'autres horribles travailleurs du verbe, savent la fragilité et l'imprécision de l'instrument qu'ils utilisent : «Délaisser le lieu, exténuer la pierre, ensemencer le temps de la route aride. Ne plus nommer; parler le langage des bohémiens, des voyants, des nomades», 17 mars 1994, p. 65), autrement dit se perdre, pourquoi pas dans un rêve primitif, Béatrice Douvre confiant plus d'une fois sa fascination pour «le rêve noir» qui monte en elle «comme un baiser, comme une lèvre» (23 février 1994, p. 27). Autre âge d'or en fin de compte, sauvage celui-ci, comme la noble et irrépressible envie de se débarrasser de la vieille peau morte occidentale, non seulement devenue inutile, mais qui ne peut que déranger, incommoder jusqu'au prurit, des personnes telles que Béatrice Douvre, bien incapables, et comme nous les comprenons, de trouver une place dans la société contemporaine, où elles apparaissent comme des monstres.
Puis c'est l'échec attendu, prévisible, d'autant plus douloureux que nous n'avions pas le droit de douter de ces saints mendiants du langage, nous contentant de notre si commode position pour les juger, comme c'est l'échec pour Vincent La Soudière dont, par bien des aspects, Béatrice Douvre pourrait être rapprochée, puisque «Rien ne remuera le silence ds oiseaux, ni ne froissera la tache de soleil, blanche sur le drap», 27 mais 1994, p. 105) qui sont les tous derniers mots de cet étrange et émouvant Journal de Belfort complété de Poèmes en prose et de Derniers poèmes très dépouillés (3), présentant les mêmes thématiques que le journal dont le nom me semble décidément moins adapté que ce n'est le cas pour le bref Passante du péril, sous-titré Journal d'une anorexique, bref, tendu, violent, parfois bouleversant.
Notes
(1) N'oublions pas la part essentielle de l'érotisme dans les textes de Béatrice Douvre même si cet érotisme peut être rejeté ou plutôt, retourné, de façon classique, dans la comédie plus ou moins conséquente de la dégradation assumée, volontaire, recherchée comme d'horribles verrues à cultiver sur soi-même : «J'ai connu tous les hommes, sans chair, sans sexe, sans jouissance. Aux gémissements inventés je priais la vierge aux seins de douleur. Comédie des cris rauques, j'ai joué l'érotisme comme on joue sous un masque. Mon corps est idolâtre sans désir. Butinant le corps mat j'ai joie de ma souffrance. Je suis malade de ma frigidité, inavouable, détestée», 12 mars 1994, p. 59).
(2) Et toujours ce même mouvement de présence et de retrait immédiat, comme dans ce très beau passage tout pétri de solennité : «En t'approchant, tu disparais, foyer de l'être, ouvert à l'inouïe de l'invisible. Tu te livres à la braise, le pied nu, au lieu saint. Sandales creuses, poussiéreuses, qui ont vaqué à la misère des pas bénis sous les buissons. Tu traînes le suaire lumineux et ta face inscrit des croix sur le sable. Te souviens-tu des vivres, te souviens-tu du boire dans les puits creusés du désert ? Paysage radieux dans les oasis claires, peuplades d’Égypte livrées aux mers. Génie de l'acte et du rouleau, manuscrit de la plèbe, telles des lettres d'or où tout un Dieu commande, du haut des monts, sur les vallées priantes» (20 mars 1994, p. 70).
(3) Voir le poème commençant par «Adieu aux mots sertis, aux mots de gloire» (p. 165) ou bien encore celui qui se termine par «Nous avons construit ici notre logis / Sur un escarpement de jours heureux», daté du 11 juillet 1994 (p. 174).




























































 Imprimer
Imprimer