« En relisant Monsieur Ouine de Georges Bernanos | Page d'accueil | Le dernier loup de László Krasznahorkai, par Gregory Mion »
13/09/2019
Orléans de Yann Moix, capitale du bonimenteur

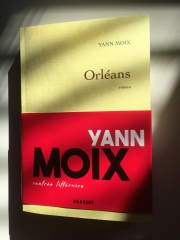 Selon beaucoup d'autorités journalistiques qui s'autorisent à dire et écrire, peut-être même penser beaucoup de stupidités, je songe ainsi, mais cette liste est fort loin d'être complète, à Jérôme Garcin, Nelly Kaprièlian, Marc Weitzmann, Laurent Joffrin, Claire Devarrieux, bien d'autres animalcules encore de la même pâleur méthodiquement punaisés sur cette page plus que complète, elle, consacrée à ce qu'il faut désormais appeler l'l'affaire Yann Moix sur le site de Marc-Édouard Nabe, selon, donc, ces entrelécheurs professionnels passant à la toilette intime, réciproque, en public, Yann Moix serait un écrivain et même, un écrivain dont le Prix Goncourt, cette merveille d'intelligence, de liberté, d'impertinence et de culture que le monde lettré tout entier nous envie, a salué l'immense talent. Yann Moix est un écrivain comme Bernard-Henri Lévy est un philosophe et comme Cécile Coulon est une poétesse, comme n'importe lequel des insectes journalistiques plus haut nommés est un critique littéraire. Comme si cette preuve pourtant amplement suffisante ne suffisait pas, comme si le fait de nous répéter, cinquante fois par jour, dans quelque média que ce soit, que Yann Moix est un écrivain, le voilà qu'on le récompense d'un Renaudot et, si du moins Cécile Coulon, ce chevau-léger de l'arrivisme le plus vulgairement décomplexé lui en laisse l'opportunité, il recevra le Prix Nobel de littérature. Yann Moix est écrivain. Yann Moix a reçu le Prix Nobel de littérature. Grasset en rêve, Yann Moix aussi et, l'homme ayant d'innombrables commis journalistiques, nul doute qu'il ne parviendra à exaucer son plus cher désir, à condition bien sûr qu'il organise lui-même l'autodafé de tous ses livres et, qu'en place publique, de préférence à une heure de grande écoute et non sans avoir invité au spectacle toute la presse parisienne et même orléanaise et que, en signe ostentatoire de rémission de ses péchés, il tourne le dos à son indéfectible protecteur Bernard-Henri Lévy et déverse un jerrican d'essence sur sa tête coupable, pour expier les fautes dont tout le monde l'accuse. Au train débridé où vont les choses, nul doute que tel conseiller en marketing ne pense, du moins secrètement et peut-être même, lorsqu'il rêve de ses éléments de langage, en chuchotant sur son oreiller, qu'il s'agirait là d'un fort bon moment de télévision, bien susceptible de gonfler l'audience.
Selon beaucoup d'autorités journalistiques qui s'autorisent à dire et écrire, peut-être même penser beaucoup de stupidités, je songe ainsi, mais cette liste est fort loin d'être complète, à Jérôme Garcin, Nelly Kaprièlian, Marc Weitzmann, Laurent Joffrin, Claire Devarrieux, bien d'autres animalcules encore de la même pâleur méthodiquement punaisés sur cette page plus que complète, elle, consacrée à ce qu'il faut désormais appeler l'l'affaire Yann Moix sur le site de Marc-Édouard Nabe, selon, donc, ces entrelécheurs professionnels passant à la toilette intime, réciproque, en public, Yann Moix serait un écrivain et même, un écrivain dont le Prix Goncourt, cette merveille d'intelligence, de liberté, d'impertinence et de culture que le monde lettré tout entier nous envie, a salué l'immense talent. Yann Moix est un écrivain comme Bernard-Henri Lévy est un philosophe et comme Cécile Coulon est une poétesse, comme n'importe lequel des insectes journalistiques plus haut nommés est un critique littéraire. Comme si cette preuve pourtant amplement suffisante ne suffisait pas, comme si le fait de nous répéter, cinquante fois par jour, dans quelque média que ce soit, que Yann Moix est un écrivain, le voilà qu'on le récompense d'un Renaudot et, si du moins Cécile Coulon, ce chevau-léger de l'arrivisme le plus vulgairement décomplexé lui en laisse l'opportunité, il recevra le Prix Nobel de littérature. Yann Moix est écrivain. Yann Moix a reçu le Prix Nobel de littérature. Grasset en rêve, Yann Moix aussi et, l'homme ayant d'innombrables commis journalistiques, nul doute qu'il ne parviendra à exaucer son plus cher désir, à condition bien sûr qu'il organise lui-même l'autodafé de tous ses livres et, qu'en place publique, de préférence à une heure de grande écoute et non sans avoir invité au spectacle toute la presse parisienne et même orléanaise et que, en signe ostentatoire de rémission de ses péchés, il tourne le dos à son indéfectible protecteur Bernard-Henri Lévy et déverse un jerrican d'essence sur sa tête coupable, pour expier les fautes dont tout le monde l'accuse. Au train débridé où vont les choses, nul doute que tel conseiller en marketing ne pense, du moins secrètement et peut-être même, lorsqu'il rêve de ses éléments de langage, en chuchotant sur son oreiller, qu'il s'agirait là d'un fort bon moment de télévision, bien susceptible de gonfler l'audience.Prenons cette proposition à la lettre, Yann Moix est un écrivain, que l'éditeur n'a pas craint, sobrement, d'indiquer en quatrième de couverture, comme une évidence qu'il faut pourtant rappeler de livre médiocre en livre médiocre : Yann Moix est un écrivain, comme Philippe Sollers est un clown, comme Cécile Coulon est une vendeuse chez un quelconque magasin Prisunic auvergnat, qui recevra, donc, elle, le Prix Nobel de littérature (car elle est blonde et impertinente, car elle avoue, avant de penser à écrire, avoir envie de pisser, et voilà que c'est bien assez pour les sages suédois !), proposition logiquement suivie de son corollaire fatidique : Orléans est un bon roman, ce qui est peu car Augustin Trapenard, dont on peut croiser la face perpétuellement souriante (c'est ça, d'être un homme constamment heureux, de tout trouver beau, bon et réjouissant), sans doute parce qu'il estime hautement sa mission d'ouverture perpétuelle à l'Autre, au tout Autre, à la brasserie Les Ondes tout près de la Maison de la Radio où il officie et ouvre tant d'esprits réactionnairement fermés, irait même jusqu'à penser que nous tenons un authentique chef-d’œuvre, le milliardième qu'il n'a pas manqué de saluer d'une de ses chroniques aussi ouvertes que molles et ineptes, incolores et insapides.
Je vends la mèche comme Yann Moix, lui, n'a pas craint de l'allumer, mais en rêve seulement, les mains encore endolories de la raclée qu'il avait administrée à son propre frère ou à d'autres gamins, le visage endolori de celles, innombrables selon ses dires, qu'il reçut de la part de son propre père, en récompense de son talent littéraire qu'il n'oublia pas de faire germer dans la jardinière précieuse d'André Gide en l'arrosant de sa copieuse prétention, je vends donc la mèche comme Moix, lui, n'a pas eu peur de l'allumer pour, maquisard imaginaire, tenter de faire dérailler le train interminable composé de wagons à bestiaux où s'entassaient des centaines de Juifs conduits vers Auschwitz mais hélas, ne parvenant à aucun résultat digne d'admiration ou seulement capable d'attirer l'attention bienveillante de Bernard-Henri Lévy encore lui (cet homme est comme un pur Esprit planant sur l'histoire d'Israël et même : sur tout ce qui est juif), se dépêchant, une fois réveillé de son cauchemar ou de son rêve on ne sait plus, de diriger sans aucune erreur d'aiguillage le convoi puant vers sa destination finale en crayonnant sans beaucoup de talent de petites saletés sur lesquelles le bon Lévy, ce véritable père de substitution, a froncé son impeccable sourcil martial, je vends donc la mèche à double brin reliée à aucun pétard : Yann Moix n'est pas un écrivain et, corollaire logique là encore, Orléans n'est évidemment pas un bon roman.
Sans même que la sordide polémique sur des textes et dessins antisémites ne fût venue troubler ma lecture, sans même que ses parents et son frère ne fussent venus atténuer quelque peu ses accusations de maltraitance à l'égard de ses géniteurs, n'importe quel lecteur d'un peu de consistance eût pu être troublé par Orléans, singulièrement par sa première partie, intitulée Dedans, qui raconte, à la première personne du singulier, la scolarité d'un enfant qui n'est autre que Yann Moix, sauf peut-être pour quelques imbéciles qui nous serviront l'écuelle du narrateur qui n'est pas le romancier, sa découverte de la littérature (Gide, Guitry, Céline, Kafka, Sartre et Péguy, Ponge aussi, dans l'ordre ou dans le désordre) ainsi que les innombrables brimades, railleries, insultes, punitions, mémorables raclées et véritables sévices que ses parents lui firent subir jusqu'au tout dernier chapitre de la première partie, narrant le moment où, enfin, l'enfant, devenu jeune homme, a osé affronter son père et l'a ridiculisé.
Le banal lecteur que je suis est gêné, car il faut bien constater que Yann Moix en fait trop, beaucoup trop même, et ne disons rien du décalque verbal de son livre, lorsqu'il passe devant des caméras ! et, tout à la fois pas assez : je ne veux pas dire que nous serions en droit de nous demander pour quelle drôle de raison personne, dans l'entourage plus ou moins direct de cet enfant battu selon ses propres dires, n'a visiblement rien remarqué, car nous savons bien que, dans ce genre d'affaire immonde, si beaucoup, parfois même tout le monde se doute de quelque chose personne, en revanche, jamais personne ne croit utile d'alerter les autorités compétentes comme on dit. Ce reproche serait futile, et le mien, ai-je tendance à le penser, va tout de même un peu plus loin, s'enfonce comme une écharde dans le flanc gras de prétention de Yann Moix, qui se veut, avant toute chose, créature absolument littéraire, pur littéraire dès l'origine comme Satan est dès l'origine le Père du mensonge et BHL celui de la vérité, à tel point qu'il a essayé par tous les moyens d'entrer en classe d'hypokhâgne, sans succès hélas.
En effet, Moix se contente de décrire, dans ces scènes violentes, ce que lui disent et lui infligent ses parents, sans jamais nous brosser la plus petite tentative de portrait psychologique de ses bourreaux qui n'ont du coup pas plus de consistance qu'un ectoplasme ou, c'est de mise ici, un poltergeist (un esprit frappeur); non pas admettre ni expliquer bien sûr, encore moins comprendre, mais tenter de proposer des mots plausibles, y compris inavouables, à de tels agissements. Il serait faux de croire qu'un salaud que l'on veillerait à doter d'une consistance romanesque et même d'une psychologie, bref : que l'on humaniserait, deviendrait plus humain pour ainsi dire, c'est-à-dire plus digne de pitié, plus excusable. C'est tout le contraire sans doute qui se produit, une ordure n'étant jamais plus malfaisante que lorsqu'un romancier s'avance à le doter d'une chair et d'un esprit, tente de dénouer ses motivations, d'évoquer ses peines, ses craintes, de dérouler la concaténation, fût-elle folle, entre les pensées et les coups qui ne manquent jamais de pleuvoir. Le père de Yann Moix n'est pas un personnage de roman : comme un deus ex machina, il surgit, beugle et frappe, puis disparaît pour ne revenir qu'à sa prochaine entrée en scène, pour recommencer la même besogne de démolition. Hélas ou heureusement, n'est pas Hawthorne, Melville, Dickens, Dostoïevski, Conrad ou Bernanos, de grands romanciers qui n'oublient pas qu'un personnage fictif doit être bien plus obsédant qu'un être bien réel, qui veut, car il est pour le moins difficile à un romancier, tout en haïssant telle ou telle maléfique de ses créatures, de la rendre crédible; non pas aimable mais crédible, alors que les guignols de papier que Yann Moix, pour les exposer au pilori de notre détestation, a couchés sur les pages de son roman sont trop grossiers, trop vulgaires, trop admirablement taillés pour n'être que des objets de répulsion, et donc pour s'animer ailleurs que dans un minuscule récipient rempli de formol, que Yann Moix agitera de temps à autres pour se prouver que, tel un véritable dieu romanesque, il parvient lui aussi à animer ses propres créatures.
Dans le livre de Yann Moix, le père n'existe pas, pas plus que la mère : l'un et l'autre sont dépourvus de la moindre épaisseur, fût-elle de chair, et sont donc réduits à n'être que des pantins inanimés qui, dès qu'on les met en branle, distribuent des insultes et des coups et, dès qu'on le décide, s'arrêtent tout aussi soudainement, sont rangés au placard, ce qui permet à Yann Moix de jouer, alors, à l'écrivain en devenir qu'il ne sera jamais malgré des leçons accélérées avec un bon répétiteur, André Gide qui, tout pédophile qu'on le voudra, donc point complètement hermétique à une certaine sensiblerie évoquée par François Augiéras, jamais ne se serait allé laissé aller jusqu'à écrire des platitudes comme des «blessures d'amour qui ne s'en vont qu'avec la mort» (p. 14), ce fragment de rire de petite fille que l'auteur «conserve encore dans [sa] poche, aujourd'hui, [s'il] serre le poing» (p. 28), cette lumière qu'il veut aspirer avec une paille (cf. p. 30), cette vue prodigieuse, réellement digne des plus grands moralistes, sur le fait que «la réalité biaise le désir» car «elle n'est jamais à la hauteur des sentiments qu'elle provoque ni des aspirations qu'elle suscite» (p. 91), ou encore cette admirable découverte qu'il ne craint pas de partager avec ses lecteurs, pauvres ignorants que nous sommes : «Celui qui n'est point passionné est un homme mort; il est une carpe qui sèche sur la pierre du bassin, se tordant de douleur sous les rayons du soleil d'août» (p. 98), et que dire, pour conclure car nous pourrions citer une sottise par page ou peu s'en faudrait, de ce bavardage pseudo lyrique, au moment où son père le conduit, en pleine nuit, dans une forêt où il va l'abandonner pour le punir : «Nous entrions dans le noir, un noir colossal et impénétrable, à peine troublé par les deux lasers jaunes des phares qui, tels des glaives tranchants, le perforaient, repoussant sans arrêt les frontières de l'infini» (p. 34); ma parole, j'ai cru lire le vieux père Hugo (d'ailleurs cité en exergue du roman) faisant tournoyer l'Ange déchu dans l'abîme !
Cet effet pour le moins fâcheux nous fait soupçonner que ce romanesque est non seulement riche d'une bien faible épaisseur, dût-elle être constituée par la souffrance et le souvenir de la souffrance endurée, mais trompeur voire mensonger. D'autres que mois l'on dit et écrit : Yann Moix a une relation toute particulière, élastique, jésuitique pour être poli, avec la vérité. Lui-même du reste sait parfaitement de quoi il en retourne puisque, évoquant ses premiers essais romanesques alors qu'il se trouvait en classe de quatrième, il avoue qu'il parvenait à être tout le monde sauf lui-même (cf. p. 210). Un roman n'est pas, d'abord, une arme de vengeance, ou alors il n'est que cela : une petite pierre s'échappant d'une fronde, dont celui qui l'a lancé n'est même pas certain qu'elle atteindra sa cible, mais une sonde jetée dans l'inconnu. Notre écrivain a rêvé d'écrire «un roman d'humiliation comme il existe des romans d'initiation» (p. 212) : conseillons-lui la lecture du magistral Absalon, Absalon ! de William Faulkner, prodigieux roman de l'humiliation d'un homme, Thomas Sutpen qui édifiera tout son domaine en réaction à une scène augurale où il s'est fait congédier comme un esclave, un roman qui, pour le coup et à la différence de ceux de notre auteur, présente l'aspect d'un texte supérieurement complexe «laissant bifurquer la narration, vaciller les psychologies et basculer l'intrigue» (p. 206), si tant est bien sûr que ces maigres catégories, pourtant hors de portée de Yann Moix, soient valables pour le génial écrivain nord-américain ! Yann Moix, exagérant (ou pas) les souffrances qu'il a endurées, nous livre un document froid, clinique, un procès-verbal tapé à deux doigts par un policier ennuyé consignant le morne babil rapportant les faits commis, et il n'y a pas grand-chose de plus, si ce n'est, comme je l'ai dit, de navrantes platitudes, parfois même affligeantes de sottise, comme celle-ci, qui donne, une fois pour toutes, la mesure du talent de notre écrivant qui, fort heureusement, apportera lui-même un démenti dans la seconde partie de son livre à ces inepties dignes d'une critique de Femme actuelle : parlant de la création, l'auteur affirme qu'elle «réclame ouverture aux autres et oxygène : pollués par la mélancolie, nous produisons des œuvres qui sentent le renfermé, s'affaissant sous le poids de leur propre gravité» (p. 39). Allez donc faire rire, avec de telles stupidités, les fantômes d'un Céline, d'un Sebald, d'un Paul Celan ou de tant d'autres grands écrivains, et rappelez donc à Yann Moix qu'Orléans, du moins sa première partie claustrophobe, n'est justement rien de plus qu'un texte qui sent le renfermé et même la merde que, selon Yann Moix, son père l'a obligé à renifler d'un peu trop près !
On se plaît à rêver de ce qu'un écrivain digne de ce nom eût pu nous livrer en lieu et place du besogneux cancre, qui n'hésite pas à se dire aliéné (cf. p. 76) comme n'importe quel imbécile journalistique, qui n'a pas honte d'écrire qu'il a senti, «instinctivement, qu'il y avait autant de sexualités que d'individus sur la terre» (p. 81), besogneux mais prétentieux (2) cancre qu'a été et, visiblement, est toujours Yann Moix, qui fût parvenu à mêler savamment les tortures parentales endurées et la découverte de la littérature, les extases devant Gide, dont il apprit par «cœur des passages» (p. 49), les coups blessant le pauvre corps de l'enfant qui se fût alors réfugié dans un monde imaginaire puis, une fois ses gammes faites (car Yann Moix nous apprend sans fard qu'il a beaucoup plagié Francis Ponge, et ce n'est sans doute pas le seul, comme il le confesse à la page 209; moi, j'ai plagié le plagiaire), qui fût parvenu à se délester de sa colère ou de sa haine par le moyen d'un livre de feu, de rage et de violence. Seulement, ce texte véritablement romanesque, qui me semble être hors de la portée de Yann Moix l'égotiste, le nombriliste, le moixiste ou moitrinaire, supposerait de s'oublier soi-même pour fondre ses peines, ses blessures et ses tourments dans le corps immense de la littérature et si, de l'aveu même de l'intéressé, «ce qui est beau est d'abord ce qui est bien écrit» (p. 50), alors c'est en vain que l'élève poussif s'applique à imiter qui l'on voudra, Gide puis Ponge, puisqu'il est bien incapable, à l'instar du créateur des Nourritures terrestres, de façonner des «phrases parfaites et spiralées» (p. 54), lui qui pourtant se targue de n'avoir jamais eu à passer les fourches caudines d'un comité de lecture, à l'exception d'une seule fois, et bien involontairement puisqu'il s'agissait de ses parents lisant ses premières proses pour lui en faire honte devant des amis invités ! (cf. p. 109).
Le secret de Yann Moix ? C'est encore lui qui le mieux sait nous l'avouer, alors même que nous n'avons pas vraiment songé à le soumettre à la question ! Il ne le chuchote pas mais, plutôt, nous le crache à la figure à chacune de ses pages mais jamais plus clairement que dans cet aveu, que nul, d'ailleurs, n'aurait songé à lui extorquer : «C'est en moi-même que je voulais faire carrière; devenir quelqu'un qui ne fût que moi. Ou plus exactement devenir un moi qui ne pût être quelqu'un d'autre» (p. 133). Pauvre Yann Moix se rêvant élève d'un maître, comme aux temps révolus des longs apprentissages sous de dures férules, qu'on aurait aimé qu'il découvre, en même temps que Charles Péguy pourquoi pas, Maurice Barrès ce qui, en même temps qu'une colonne vertébrale à sa molle théorie du Moi (et à son style, bien sûr !), l'eût certainement empêché de proposer telle monstrueuse filiation pour lesbienne transgenre et transhumaniste, avoir des enfants «dont nous ne serions pas les parents» (p. 134) !
L'un des princes journalistiques de la platitude, le très soporifique Bernard Pivot, a récemment exclu Orléans de la sélection du Prix Goncourt au prétexte, non seulement idiot mais faux, que sa seconde partie, intitulée Dehors, lui semblait moins réussie que la première. Gageons qu'il n'a fait que suivre l'avis ô combien éclairé de son illustre confrère et probable ami, Pierre Assouline qui, jamais avare d'une crétinerie, n'a pas peur d'affirmer, de l'écriture de cette première partie, qu'elle est «d’une force parfois insoutenable et [qu']on se dit à mi-chemin qu’on tient le grand livre de la rentrée tant la lecture en est impressionnante». Ce plumitif indigent continue à dévider sa grosse bobine à fadaises en nous assurant que l’écriture de Yann Moix, toujours dans cette première partie, «y est d’une tenue et d’une retenue d’autant plus remarquables que Moix est l’écrivain de tous les excès et de toutes les provocations, qu’il s’autorise d’ordinaire toutes les digressions et les plus folles envolées» alors qu'à ses yeux, c'est la seconde partie qui n'est pas à la hauteur de l'autre, car elle ne fit qu'aligner les platitudes, platitudes que nous avons montrer être tout aussi alignées, en rang dans le préau et au cordeau même, entre deux raclés, dans cette première partie. Ne soyons point trop durs avec le pauvre Pierre Assouline car il est une boussole comme une autre, à condition de tenir compte du fait qu'il ne faut jamais suivre ses indications de lecture et, même, qu'il faut comprendre que, lorsqu'il indique le nord, nous devons en fait aller vers le sud et vice-versa. Certains journalistes sont de lamentables critiques littéraires car ils n'ont rien lu. Pierre Assouline, lui, souffre d'un autre mal, bien plus pervers et difficile à détecter : il ne dit jamais que l'inverse de la vérité et, ma foi, il représente à ce titre un phare, un phare dont le sémaphore éclairerait les touffes d'herbe et les mottes de terre plutôt qu'il ne balaierait le ciel.
C'est donc bel et bien la seconde partie d'Orléans qui est la plus réussie des deux; je me contente de dire cela et rien d'autre : la plus réussie des deux, ce qui, en soi, n'est point on en conviendra un gage de haute tenue littéraire. Mais enfin, justement parce qu'elle n'évoque plus guère les fantoches parentaux et qu'elle permet donc à Yann Moix, si je puis dire, de s'exprimer pour de bon, d'écrire sans nous bassiner avec le thème qu'il illustre avec plus ou moins de bonheur dans presque chacun de ses romans, qu'il s'agisse du piètre Panthéon ou de l'apocalyptiquement ennuyeux Naissance, l'écrivain a les coudées franches, et, comme il l'écrit, il n'insiste pas, car nombre des «remarques faisandées» qu'il a faites «fourmillent sous la plume de trop d'écrivains» (p. 192), dont la sienne se voulant celle d'un écrivain. Ainsi, libéré d'un sujet qu'il aura campé probablement, d'une façon ou d'une autre, dans le moindre de ses textes, Yann Moix peut-il jouer à ce qu'il sait faire le mieux : l'écrivain, non sans quelque réussite d'ailleurs, tant le style est ciselé dans ces petites vignettes que nous pourrions considérer comme des poèmes en prose et qui, tous, suintent d'une réelle nostalgie, parfois touchante, mais, surtout, d'un découragement que nous pourrions prétendre absolument noir, princier, pour le coup digne d'une révolte d'enfant trop longtemps bafoué.
Le thème principal de cette seconde partie est le temps, qu'il s'agit bien sûr de reconquérir, et non pas répéter (3), puisqu'il est à tout jamais englouti, occasion de ce beau passage : «Déambuler dans l'avenir ne m'intéressait pas; je voulais me graver dans une anfractuosité où le temps, circulaire, ne s'écoulerait que pour faire renaître les mêmes aubes, les mêmes soleils et les mêmes pluies. Un temps-livre, en quelque sorte, au sein duquel recommencer Les Nourritures terrestres infiniment, et Paludes aussi bien» (p. 196). Dans telle autre de ces vignettes, Yann Moix écrit, là encore assez bellement bien que nous ne lisions là rien de bien plus que la copie appliquée d'un Léon Bloy eunuque : «L'histoire, vue par les romanciers, n'est pas un tapis de dates, déroulé, sur lequel se situent des batailles, des événements, des existences, des destructions, des naissances, des inventions ou des conquêtes : elle est la façon dont le temps transperce les hommes, qui ne sont que le tissu du motif et non plus la trame; c'est le temps qui va d'homme en homme, et non l'homme qui va d'époque en époque. Le temps se diffracte là, il se déforme ici, s'enroule sur lui-même, ralentit, accélère soudain, devient ligne droite, ou spirale, s'éteint, disparaît, revient, s'agite; ce qu'on nomme l'histoire est l'aventure de ces mouvements, de ces circonvolutions, de ces volutes. Nous ne traversons pas le temps; c'est le temps qui nous traverse» (p. 175). Ah, si Yann Moix nous avait donné, non pas quelques lignes de cette facture, mais tout un livre assez artificiellement scindé en deux parties dont la première, contrairement à ce que prétendent les imbéciles qui ne savent pas lire, est bien inférieure à la seconde je le répète, nous le tiendrions, notre écrivain, et le crétin pivotal eût dû chercher une autre excuse que la trouille de se faire mal voir pour exclure ce roman de sa liste ridicule ! Hélas pour Yann Moix rêvant complexité narrative et finalement parfaitement incapable, quel que soit celui de ces livres que nous considérons, d'évoquer un autre sujet que lui-même comme si, biberonnant Joyce et Proust, il ne se révélait capable que de plagier la nullité autofictive Christine Angot ou comme si, croyant bâtir une cathédrale verbale, il n'était capable que d'installer un bidet bancal dans lequel Édouard Louis prend grand soin de ses délicates fesses, le seul de ses organes qui, après tout, réussit à produire quelque chose, hélas pour Yann Moix car c'est non seulement à l'écriture qu'un écrivain se juge, mais aussi, du moins s'ils se prétend romancier, à sa capacité d'élever une maison qui, quelles que soient les labyrinthiques chambres qui la composent, les caves et les greniers où se tapissent des choses depuis des années, n'est tout de même pas coupée en deux, deux moignons ne composant jamais un membre, même chez les manchots.
Notes
(1) Orléans (Grasset, 2019).
(2) «Dans la légende que je me suis forgée de moi-même, on y trouvait toutes les preuves d'un don extraordinaire pour la littérature, d'une passion précoce pour les mots» (p. 84). Plus loin, à propos de Péguy, Yann Moix écrit : «Solide comme un bronze, fragile comme un enfant, Péguy ressemble à l'idée que je me fais de moi : injuste, irascible, caractériel, mais attachant, touchant», en un mot, «enfantin». L'auteur ajoute qu'il ne se jette pas des fleurs car il aspire, «comme sur un champ de bataille, à dire la vérité», et parce que «la modestie n'est rien au regard de l'humilité» et enfin parce que Péguy et lui sont «des humbles», «des humbles et des Orléanais» (p. 88). Le rapprochement qui suit entre Péguy et Gide n'est point complètement sot.
(3) Car alors, on ne sortirait pas du cercle infernal de la maudite répétition : «C'est soi qu'on continue de frapper quand on a été brutalisé : me propageant dans l'enfant, je me reconnais dans sa figure, je coule dans ses veines» écrit Yann Moix qui nous explique de la sorte, peut-être, quelle est l'espèce consumante de rage qui, le premier, le dévore, ajoutant «c'est moi, le défenestrant, que j'entends suicider» (p. 194).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, éditions grasset, yann moix |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































