« L’Amérique en guerre (10) : Des clairons dans l’après-midi d’Ernest Haycox, par Gregory Mion | Page d'accueil | Traité du rebelle d'Ernst Jünger »
25/02/2019
Millenium People et La cause du peuple : J. G. Ballard et Patrick Buisson ont-ils porté des gilets jaunes ?

Photographie (détail) de Juan Asensio.
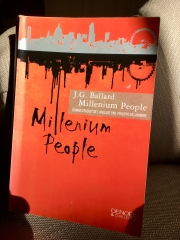 Les journalistes ont pour habitude solidement ancrée de dire un grand nombre de stupidités sans que jamais ils ne soient tenus de rendre des comptes. Ils ont ainsi pu nous assurer que le prophète Michel Houellebecq avait, dans son dernier roman, Sérotonine, anticipé la crise des Gilets jaunes. Il est vrai que ledit Isaïe à gueule torve avait anticipé la misère sexuelle de l'homme blanc occidental, le pullulement des mosquées sur le sol de France si fertile, jadis, en cathédrales et églises; il paraît même que, dans une pure vision béatifique, Michel Houellebecq avait clairement annoncé que le plus banal de ses clichés pourrait être consacré par une exposition au Palais de Tokyo, la plus infantile de ses rimailles être reprise dans l'écrin d'une collection de poche célèbre, la moindre de ses images à tropisme sexuel distendu se voir érigé en invention verbale prodigieuse.
Les journalistes ont pour habitude solidement ancrée de dire un grand nombre de stupidités sans que jamais ils ne soient tenus de rendre des comptes. Ils ont ainsi pu nous assurer que le prophète Michel Houellebecq avait, dans son dernier roman, Sérotonine, anticipé la crise des Gilets jaunes. Il est vrai que ledit Isaïe à gueule torve avait anticipé la misère sexuelle de l'homme blanc occidental, le pullulement des mosquées sur le sol de France si fertile, jadis, en cathédrales et églises; il paraît même que, dans une pure vision béatifique, Michel Houellebecq avait clairement annoncé que le plus banal de ses clichés pourrait être consacré par une exposition au Palais de Tokyo, la plus infantile de ses rimailles être reprise dans l'écrin d'une collection de poche célèbre, la moindre de ses images à tropisme sexuel distendu se voir érigé en invention verbale prodigieuse.Aucun de ces piètres journalistes ne semble toutefois s'être avisé du fait qu'en 2003, James Graham Ballard, en publiant Millenium People, avait parfaitement décrit les jacqueries des classes moyennes britanniques, et même imaginé une extrémisation (par des meurtres gratuits) du mouvement de révolte puis, comme il se doit, avait figuré la fin ridicule, logique dans le roman de l'auteur de Crash ! : un retour au calme et à l'insignifiance d'un quartier résidentiel, la Marina de Chelsea ayant connu quelques pavillons cossus brûlés par ceux-là même qui y vivaient et voitures retournées par leurs conducteurs en ayant assez du luxe et de l'ennui.
Les esprits tatillons auront beau jeu de me faire remarquer que la population composant les rangs si peu disciplinés des Gilets jaunes n'appartient pas forcément, dans sa totalité, à cette classe moyenne du reste peu commodément définissable qu'évoque avec beaucoup d'ironie et même de moquerie Ballard, devenue, selon ses termes, le «nouveau prolétariat, victime d'un complot séculaire, qui rejetait enfin les chaînes du devoir et de la responsabilité civique» (1). Il n'en reste pas moins que l'auteur décrit parfaitement les différentes caractéristiques de la société contemporaine dans laquelle de tels soulèvements peuvent voir le jour : paupérisation bien sûr, Ballard n'aura de cesse d'insister sur ce point (2) mais aussi, plus profondément, ennui, qualifié de «féroce» (cf. p. 39) régnant sur le monde (3), absence de sens légitimant a contrario la «violence gratuite» (p. 102) qui ne sera jamais mieux manifestée, dans notre roman, que par les meurtres n'obéissant qu'à une inspiration pour ainsi dire stochastique dont se rendra coupable Richard Gould, mélange de tragédie et de bouffonnerie, impossibilité finale de détruire une société qui récupérera immédiatement de toute façon la moindre poussière d'exaspération, de colère ou même de révolte pour la réinjecter dans la grande machine à bâtir du sens, mais uniquement capitalistique, ce sens fût-il totalement fallacieux et même labile.
La pseudo-révolution née dans la Marina de Chelsea n'est donc rien de plus que l'une des innombrables contradictions que s'amuse à relever Ballard, faisant dire à Richard Gould : «Nous sommes une classe de rentiers, un reste du siècle dernier. Nous tolérons tout, mais nous savons que les valeurs libérales sont conçues pour nous rendre passifs. Nous imaginons que nous croyons en Dieu, alors que nous sommes terrifiés par les mystères de la vie et de la mort. Profondément égocentriques, nous sommes incapables d'affronter l'idée de notre finitude. Nous croyons au progrès et au pouvoir de la raison, mais nous sommes hantés par les côtés sombres de la nature humaine. Nous sommes obsédés par le sexe, mais redoutons l'imagination sexuelle et devons être protégés par d'énormes tabous. Nous croyons à l'égalité, mais nous haïssons le prolétariat. Nous craignons notre corps et, par-dessus tout, nous craignons la mort. Nous sommes un accident de la nature, mais nous nous croyons au centre de l'univers» (pp. 174-5).
Bien des définitions peuvent être données, avec plus ou moins de bonheur, aux jacqueries des Gilets jaunes, et le moindre commentateur, vaguement expert en rien du tout, s'y aventure avec une impavidité qui forcerait le respect du plus endurci des explorateurs, mais il me semble que nous raterons toujours l'essentiel tant que nous ne dirons pas que c'est bel et bien l'homme médiocre, l'homme creux, l'homme des foules qui se cabre, une dernière fois peut-être, avant de retomber définitivement dans l'une de ces zones «sans passé ni avenir, sans devoirs ni responsabilités civiques, aux parkings vides hantés par des hôtesses de l'air entre deux avions et des employés de PMU", un de ces endroits «qui ne se rappelait jamais lui-même» (p. 212) écrit curieusement mais si justement Ballard qui, lui, ne semble pas avoir perdu la mémoire d'un monde qui n'est plus.
La révolte est impossible, même si, en raison de son caractère totalitaire, personne, en effet, «ne peut plus se tenir à l'écart» (p. 249) car, s'il s'agit aussi de se défier d'une pseudo-élite consanguine, quitte à abattre, comme le fera Richard Gould, l'une de ces célébrités éphémères «répandant un âme de notoriété alcoolisée dans les rues imperturbables de l'Ouest londonien» (p. 254), il n'en reste pas moins que révoltés et meurtriers, factieux et crevards, séditieux inadaptés à un monde sans âme tout pressé de se totaliser, une fois pour toute, dans quelques tableurs présentés devant un parterre de cadres enthousiastes et progressistes, tous, nous serons immédiatement récupérés par cette «infantilisante société de consommation» capable de combler «toutes les brèches dans le statu quo aussi vite que Kay [l'une des meneuses de la révolte de la Marina de Chelsea] avait précipité sa Polo dans la barricade en train de céder» (p. 292).
Ballard paraît s'amuser en jouant avec la vieille idée selon laquelle un meurtre absolument gratuit pourrait, seul, dans ce cas, nous faire sortir de notre léthargie bienheureuse, comme semble le penser le louche Richard Gould qui déclare que «les dieux sont morts, et nous nous méfions de nos rêves. Nous émergeons du vide et le contemplons un instant avant d'y replonger. Une jeune femme gît morte sur son seuil. Un crime gratuit, mais le monde s'interrompt. Nous écoutons, et l'univers n'a rien à dire. Il n'y a que le silence, nous devons donc parler» (p. 325).
Fausse piste bien sûr car, sitôt consommé, le meurtre, à condition même que nous le supposions entièrement gratuit, est oublié, puisque nous vivons à l'aise comme si nous étions devenus «une légion de nullités» [multipliant] les tables d'une mathématique nouvelle fondée sur le pouvoir du zéro, faisant surgir une psychopathologie virtuelle de leurs ombres» (p. 338).
Nous savons tous, à l'instar des personnages de Ballard, que la révolution est condamnée d'avance, la nature ayant «façonné la classe moyenne à la docilité, à la vertu et à l'esprit civique», Gould n'étant rien de plus qu'un de ces hommes désespérés essayant de «trouver un sens à l'époque la plus dénuée de sens, premier d'une nouvelle espèce de desperado qui refuse de s'incliner devant l'arrogance de l'existence et la tyrannie de l'espace-temps» (p. 363), tandis que la colère des habitants de la Marina de Chelsea peut être considérée comme «l'épure des protestations sociales de l'avenir, des soulèvements armés arbitraires et des révolutions condamnées, de la violence injustifiée et des manifestations sans raison» (p. 364). En somme, Ballard nous dit que, à moins de supposer l'existence d'un effondrement planétaire de la civilisation, il y a fort à parier que nous ne vivions plus qu'une série de hoquets et de renvois de bile plus ou moins espacés que nous aurons bien tort de considérer comme des manifestations d'une vie de plus en plus menacée, réduite aux gestes mécaniques d'une marionnette dont le marionnettiste même semble avoir disparu.
 Nous pourrions évoquer l'ouvrage de Patrick Buisson de bien des façons, en choisissant de privilégier telle ou telle thématique, de la plus intime (La cause du peuple lue comme le journal d'un homme blessé), à la plus visible (la critique de la droite la plus bête du monde, et, surtout, la plus lâche une fois au pouvoir) en passant par la gamme traditionnelle des petites vues journalistiques sur l'attachement inexorable à l'histoire, la culture et la langue de la France. Il me semble que le texte de Patrick Buisson illustre surtout, en profondeur, une méditation douloureuse, accablée, sur le déracinement de l'homme contemporain et la destruction de toute forme de «verticalité ou transcendance» (4), la perte de légitimité du pouvoir et l'isolement plein de morgue et de plus en plus radical de nos élites, autrement dit, pour suivre la leçon d'un des ouvrages les plus connus de Christopher Lasch, la révolte des élites ne se rendant même plus compte que le petit peuple, périphérique ou pas, se meurt, non sans convulsions plus ou moins importantes, mais qu'il sera cependant assez facile de mâter à coup de matraque, ou bien en éborgnant quelques manifestants pour l'exemple.
Nous pourrions évoquer l'ouvrage de Patrick Buisson de bien des façons, en choisissant de privilégier telle ou telle thématique, de la plus intime (La cause du peuple lue comme le journal d'un homme blessé), à la plus visible (la critique de la droite la plus bête du monde, et, surtout, la plus lâche une fois au pouvoir) en passant par la gamme traditionnelle des petites vues journalistiques sur l'attachement inexorable à l'histoire, la culture et la langue de la France. Il me semble que le texte de Patrick Buisson illustre surtout, en profondeur, une méditation douloureuse, accablée, sur le déracinement de l'homme contemporain et la destruction de toute forme de «verticalité ou transcendance» (4), la perte de légitimité du pouvoir et l'isolement plein de morgue et de plus en plus radical de nos élites, autrement dit, pour suivre la leçon d'un des ouvrages les plus connus de Christopher Lasch, la révolte des élites ne se rendant même plus compte que le petit peuple, périphérique ou pas, se meurt, non sans convulsions plus ou moins importantes, mais qu'il sera cependant assez facile de mâter à coup de matraque, ou bien en éborgnant quelques manifestants pour l'exemple.Patrick Buisson, qui se qualifie lui-même comme un «objecteur de modernité» (p. 35) et un spécialiste de «l'abattage de masse des vaches sacrées» (p. 54), nous livre une chronique de la minutieuse déroute de «l'homme de la radicalité» qu'il est, ce dernier terme devant être compris dans son acception étymologique : «le latin radix désigne l'axe de la plante qui croît du sol au sommet pour mieux renvoyer figurativement au fondement sans lequel aucune existence ne saurait subsister» (p. 23) et qui, de fait, ne subsiste plus guère puisque notre terreau est non seulement pollué par tout un tas de saloperies mais parce que le fumier du «devenir infini» ou du «progrès-croyance» (p. 32) ne possède aucune propriété susceptible de nourrir la plus petite radicelle, qu'il s'agisse de celles du «peuple-classe» ou du «peuple-nation» (p. 46). Dans tous les cas, «l'anomie fait vaciller les fondations» (p. 49), même si l'éclipse de la verticalité, «c'est-à-dire du rapport de l'homme à Dieu», n'a pas suffi à entamer «l'horizontalité du lien [unissant] les hommes entre eux autour d'un patrimoine symbolique et d'un minimum de sens à partager» (p. 56), ce minimum de sens qui permettra à quelques représentants appauvris de la classe moyenne de se rebeller dans le roman de Ballard, en rejetant la société de consommation par des actes tout simples, avant de passer à de plus gros expédients. Tous, néanmoins, seront inutiles et bien incapable de desserrer l'étau invisible qui nous enserre.
En creux, cette absence de verticalité est sans doute l'un des thèmes qu'explore Ballard, montrant dans Millenium People qu'une apocalypse, à notre époque, ne peut qu'emprunter les déguisements de cette dernière, qui sont de farce et de pastiche. Un point tout de même rapproche plus directement les deux ouvrages du, ou plutôt des mouvements des Gilets jaunes, que résume parfaitement Patrick Buisson dans les lignes qui suivent : «De l'actuel processus de reproduction et de cooptation des pseudo-élites ne peut sortir qu'un personnel façonné par l'étroit conformisme de l'idéologie ambiante, gouverné par l'anthropologie dérisoire de l'économisme qui prétend réduire les hommes à leurs seuls comportements sinon rationnels du moins rationalisables, dépourvu de toute vision autre que l'horizon indépassable de la matière et des chiffres, obsédé par le pondérable et le quantifiable, inaccessible à la dimension symbolique du pouvoir, imperméable aux legs de la tradition et de l'histoire nationale, réfractaire à l'idée même du bien commun» (p. 106).
Je ne tente évidemment pas de faire de Ballard un réactionnaire qui s'ignorerait, mais il est frappant de constater que les critiques acides que Buisson porte contre la droite française, accusée «d'adhérer à ce présupposé du libéralisme qui fait de la société une collection d'individus n'obéissant qu'aux lois mécaniques de la rationalité et de la poursuite de leur seul intérêt» (p. 236), ou son évocation d'une République qui «n'a plus rien à partager si ce n'est un vague règlement de copropriété» (p. 317) rejoignent celles que, fort discrètement et sans un trop grand a priori idéologique, Ballard, qui lui aussi aurait pu parler de la déliaison comme «grande figure du temps présent» (p. 433), jette contre le visage mou de la société britannique et, plus largement, occidentale. En forçant bien évidemment le trait, nous pourrions aussi affirmer que le portrait de l'homme contemporain, autrement dit l'homme creux soumis au règne des «communicants à l'action exclusivement horizontale» (p. 437), figure dans le roman de Ballard avant qu'il ne soit croqué, de façon fort peu flatteuse, par Buisson sous les traits de l'inconstant et inconsistant Nicolas Sarkozy, coûteusement parfumé de toutes «les fragrances de la modernité» (p. 360), comme nous autres à vrai dire, tous, riches et puissants ou humiliés et offensés, sans oublier l'immense troupeau du petit peuple d'une France périphérique parce qu'elle n'a absolument plus de centre, non point géographique mais spirituel.
 On complètera fort utilement cette lecture roborative par celle de La Droite buissonnière paru aux éditions du Rocher en 2017 sous la plume aussi envolée que bien renseignée, sans oublier, ce qui est essentiel dans ce type d'essai, méchante, de François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, qui a de forts beaux passages, comme celui consacré à Pasolini (cf. p. 36) ou au Bernanos de La Grande Peur des bien-pensants (cf. p. 62).
On complètera fort utilement cette lecture roborative par celle de La Droite buissonnière paru aux éditions du Rocher en 2017 sous la plume aussi envolée que bien renseignée, sans oublier, ce qui est essentiel dans ce type d'essai, méchante, de François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, qui a de forts beaux passages, comme celui consacré à Pasolini (cf. p. 36) ou au Bernanos de La Grande Peur des bien-pensants (cf. p. 62).Notes
(1) J. G. Ballard, Millenium People (traduction de Philippe Delamarre, Denoël & d'ailleurs, 2005), p. 14. Toutes les pages entre parenthèses, sauf mention contraire, renvoient à notre édition.
(2) Jusqu'à rappeler l'une des histoires les plus fameuse de Joseph Conrad, Cœur des ténèbres, Twickenham étant de fait qualifié de «zone d'intense pauvreté spirituelle» (p. 105).
(3) «Au bout d'un certain temps, nous allons commencer à casser nos jouets, même ceux que nous aimons le plus. Nous ne croyons en rien» (pp. 143-4).
(4) Patrick Buisson, La cause du peuple (Perrin, 2016), p. 11.




























































 Imprimer
Imprimer