« L'Ombre et la Nuit de Francis Giauque de Véronique Gonzalez et Vincent Teixeira | Page d'accueil | Jean de La Bruyère et la ville : je t’aime… moi non plus, par Gregory Mion »
23/04/2018
Lettres éditoriales de Roberto Bazlen

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Acheter Bartleby et compagnie sur Amazon.
Acheter Bartleby et compagnie sur Amazon.Enrique Vila-Matas n'a peut-être jamais été aussi intéressant, à nos yeux du moins, que dans son célèbre Bartleby et compagnie, où il a écrit, en pensant peut-être au Roberto Bazlen des fameuses Notes sans texte comprenant un certain nombre de textes, nombre assez chiche pour que cet auteur sans livre devienne célèbre et textes qui jamais n'ont été publiés de son vivant, ces mots caractérisant ce qu'il appelle le syndrome de Bartleby : «Cela fait longtemps que je quadrille le large spectre du syndrome de Bartleby en littérature, longtemps que j’étudie cette maladie, ce mal endémique des lettres contemporaines, cette pulsion négative ou cette attirance envers le néant, qui fait que certains créateurs, en dépit (ou peut-être précisément à cause) d’un haut niveau d’exigence littéraire, ne parviennent jamais à écrire» (1). Il faut être rigoureux cependant, car Roberto (dit Bobi) Bazlen n'a à proprement parler jamais refusé d'écrire, mais n'a pas cru bon devoir être publié, ce qui n'est tout de même pas du tout la même chose; ce qui est même, j'ose le dire, le témoignage d'une politesse d'un autre âge, à l'heure où n'importe quel imbécile est en droit de nous coller ses productions sous le regard (et même le nez, qui en est logiquement incommodé), parce qu'il doit probablement estimer que son témoignage est irremplaçable.
Ainsi, en tant que conseiller éditorial de légende pour les éditions Bompiani et Einaudi, et comme écrivain sans livre publié, Roberto Bazlen a pu faire sien ce beau mot de Juan Ramón Jiménez qui déclarait, tout en n'ayant jamais oublié, lui non plus, non seulement d'écrire mais aussi de publier : «Ma plus belle œuvre est le repentir de mon œuvre», comme si, à la différence de bien des modernes (qu'il s'agisse d'Enrique Vila-Matas, donc, mais aussi de Daniele Del Guidice dans son Stade de Wimbledon qui, merveilleusement conformé à son sujet, ne m'a laissé presque aucun souvenir, tout comme son adaptation cinématographique par Mathieu Amalric), Robert Bazlen savait que seul le texte publié, aussi imparfait qu'il soit, pouvait prétendre constituer une minuscule pierre à l'édifice se dressant au milieu d'un océan déchaîné menaçant de tout engloutir, et alors de disloquer et de faire disparaître définitivement le si fragile questionnement des hommes.
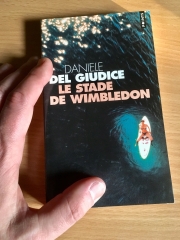 Acheter Le stade de Wimbledon sur Amazon.
Acheter Le stade de Wimbledon sur Amazon.Je me demande si la pierre jetée par L'Olivier à cet édifice que représentent toutes les créations produites par l'homme et pas seulement, donc, les livres, ne va pas passer totalement inaperçue, tant elle est modeste et, surtout, pas franchement originale. Le texte des lettres de Bobi Bazlen présenté sous une couverture que nous dirons minimaliste a en effet déjà paru en 1999 aux éditions Le Passeur-Cecofop, la traduction due à Adrien Pasquali n'ayant subi très probablement ne serait-ce que la plus minuscule retouche entre ces deux publications, accompagnée par un texte de Roberto Calasso dont, à la troisième relecture, je n'ai toujours pas compris le sens ni même l'intérêt (2), introduction elle-même point originale puisqu'elle avait parue en accompagnement d'un autre texte de Roberto Bazlen, Le capitaine au long cours paru chez Michel de Maule en 1987. Beaucoup de gloses donc, pour un auteur qui, ô surprise, n'a pas dédaigné utiliser de l'encre.
Il est frappant de constater que tous ces commentaires le plus souvent pseudo-universitaires ou, quand ils ne le sont pas, à tropisme énigmatique (Vila-Matas, Del Giudice, Calasso) brodant autour de l'impuissance consubstantielle à l'acte d'écriture et d'un auteur qui n'en est pas un, ou en est un au contraire, mais au sens le plus éminent du terme puisqu'il refuse de produire, est ironiquement contredite par les vifs propos eux-mêmes de Robert Bazlen qui, sur un certain nombre d'ouvrages et d'écrivains, émet des critiques implacables et, nous n'avons pas peur de le dire, définitives. Le style même de cet auteur sans texte publié est vif, n'hésitant jamais à entrecouper le texte par des mots étrangers (français, anglais ou allemands) qu'il ne prend pas la peine de traduire (cf. pp. 62, 66) ou des digressions elliptiques (cf. p. 84). Un exemple assez représentatif je crois de ce type d'écriture qui va à l'essentiel et ne s'embarrasse pas de précautions oratoires, au rebours même des textes si habiles à s'entourer autour des textes commentés par Charles Du Bos (qui lui aussi ne dédaigne jamais de passer sans transition trop marquée entre deux langues) : «C'est pourquoi je te les [quelques idées] écris à la hâte, et peut-être sont-elles plus empoisonnées qu'il n'est nécessaire, désordonnées, incohérentes, et avec des formulations extrêmes rendues nécessaires par la hâte, qui peuvent les faire paraître paradoxales : aphoristischer Beitrag [contribution aphoristique] pour créer une perspective à partir de laquelle juger les Bettelheim» (p. 102).
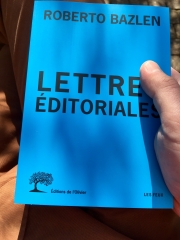 Acheter les Lettres éditoriales sur Amazon.
Acheter les Lettres éditoriales sur Amazon.Passons aux jugements émis par Bobi Bazlen sur les livres qu'il lit ou qu'il perd franchement patience à lire comme Les Reconnaissances de William Gaddis. Si le texte le plus connu de Sologoub, Un démon de petite envergure, présente au lecteur une intrigue qui se déroule «dans le véritable et grand monde de l'âme», texte qu'on «lit comme si nous étions séparés de nos rêves par une peau d’œuf très transparente» (p. 31), si Ferdydurke de Gombrowicz enthousiasme notre imparable critique, si l'évocation de Jarry est l'occasion d'évoquer les «rapports entre Huysmans et De Guaita» sur lesquels, à la connaissance de Bazlen, «il n'y a même pas un volume», alors même que ledit occultiste "était tout autre que falot : ami intime, dans sa jeunesse, de Barrès», mais aussi les rapports existant entre Rimbaud et Nerval et les auteurs de «traités initiatiques et alchimiques» qui seuls peuvent expliquer un «processus de consecutio d'états (pour ne pas les désigner par le terme trop incolore d'images» (p. 41, l'auteur souligne), Roberto Bazlen déteste Le Voyeur de Robe-Grillet, ne comprenant franchement pas «qu'un homme, sans doute assez jeune, véritablement intelligent, sensible et intuitif, doté d'yeux vraiment ouverts, puisse passer une ou deux années de sa vie dans le seul but de créer une «machine» qui mette le lecteur dans les conditions de revivre quelques journées d'un petit vendeur ambulant criminel qui rumine un alibi» (p. 34). Il ajoute, et nous constatons comme il a vu juste, que Robbe-Grillet n'aura jamais fait qu'exploiter «le problème» de la simultanéité des temps et des espaces (qui deviendra sans doute le slogan grâce auquel [l'écrivant en question] fera carrière)» (p. 33).
Imaginons, à notre époque, quelque moderne et insoupçonnable Bobi Bazlen faire de tels commentaires sur les rinçures de Christine Angot, Amélie Nothomb, Yann Moix ou Yannick Haenel ! Et imaginez un éditeur qui suivrait les yeux fermés les recommandations, positives ou négatives d'un tel lecteur implacable ! C'est tout bonnement impossible ! Imaginez un lecteur dire de Maurice Sachs que, comparé à Pierre Minet, il «n'est qu'un fils à papa vicelard et vicié, petit spéculateur et narcisse très, très cauteleux» (p. 57) ! Imaginez qu'il puisse dire, d'un Jouve ou de son équivalent contemporain, qu'il s'agit d'un «genevois [étant né et ayant grandi] dans un univers de très hauts idéaux parfumés» et qu'il a commencé par produire «une œuvre lyrique lavée à la lessive Omo et fourrée de pacifisme et de responsabilité européenne» (p. 62), de tel autre texte (L'Instant de vérité d'Edwin O'Connor qu'il s'agit d'un «Bernanos traduit en tiède» (p. 100), et tant d'autres saillies rigoureusement proscrite de nos jours, alors qu'il ne faut se contenter, en guise et lieu de jugement véritable, jugé prétentieux voire réactionnaire et même carrément fasciste, que d'un avis !
Sans doute que Roberto Bazlen, pour oser utiliser ainsi le couperet de la décision, est-il un homme d'un autre temps, pourtant point trop éloigné du nôtre, mais le prudent, lui, aura vite fait, pou expliquer ce coupable tropisme de lecteur radical, d'affirmer que le bon Bobi n'est justement point si bon que cela, qu'il a même quelque chose à se reprocher et, suivez mon regard, qu'il pourrait sans doute à bon droit être qualifié de passéiste, comme y invite d'ailleurs plus d'une de ses affirmations, par exemple lorsqu'il avoue qu'il vit «en un temps où l'homme n'a plus de profil» (pp. 45-6), ou que certains auteurs travaillent pour ainsi dire «avec un homme qui n'existe plus» (p. 64) sans doute parce que, comme Roberto Bazlen d'ailleurs, ce dernier montre un «besoin mégalomane de grands thèmes» (p. 78) alors que son époque (donc la nôtre) ne goûte que les petits personnages, «avec les drames uniquement descriptifs sur un plan unique, avec le microscope pointé sur le cœur de l'infection» (p. 79), vu qu'il est hélas parfaitement clair et évident que «tout ce qui se publie ne tient debout que sur des pieds vraiment trempés et puants» (p. 75) alors que, naguère, «avant donc les déconstructeurs» (p. 81), c'était l'ère grandiose des «écrivains de romans romans» (pp. 80-1), Dostoïevski, «Hardy ou Stevenson» (p. 80). Ailleurs, il n'hésite même pas à prétendre qu'il a «éprouvé une véritable compassion pour ces pauvres nazis, obligés par [Nelly] Sachs à être si inhumains» (p. 111, l'auteur souligne), propos qui choquera les femmelins mais qu'il faut comprendre, chez Bazlen, comme l'appel désespéré à une intensité de vie incarnée par exemple par les vies des sœurs Benoîte et Flora Groult, les «incommensurables de la vie [ne devant pas] être commensurés, puisqu'il y a un abîme «entre la médiocrité de la vie des pauvres Anne Frank et Simone Weil et la grandeur» (p. 125) desdites sœurs, mais aussi à de nouvelles expériences humaines, à de nouveaux concepts et de nouveaux textes, le nouveau ne pouvant «faire son chemin que dans un terrain moins solidifié, moins artériosclérosé que le nôtre" (pp. 119-20).
Nous sommes dans l'époque où les «mots sont usés, et maintenant ils sont dans la bouche d'un troupeau anti-troupeau qui réagit contre le monde préfabriqué avec des réactions préfabriquées» (p. 103), comme si toute possibilité de sauvetage nous était désormais refusée, le mauvais rêve s'enchâssant dans le mauvais rêve, dans un emboîtement dickien dont jamais nous ne pourrons sortir, condamnés à errer d'erstaz en ersatz et de mensonge en mensonge, dans un monde qui de toute façon n'aura plus besoin de lire (cf. p. 147, à propos de Strindberg).
Notes
(1) Enrique Vila-Matas, Bartleby et compagnie (Seuil, coll. 10/18, 2003), p. 12.
(2) Il doit du reste manquer un passage dans le texte de Calasso, car le propos évoquant le fait que Bazlen «avait prévu très tôt, par exemple, le début de la Troisième Guerre mondiale» et qui se poursuit par une citation de l'auteur est tout bonnement incompréhensible (p. 10).




























































 Imprimer
Imprimer