« Les Déracinés de Maurice Barrès | Page d'accueil | La fraternité de nos ruines de David Rousset, par Gregory Mion »
09/12/2016
Le Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier
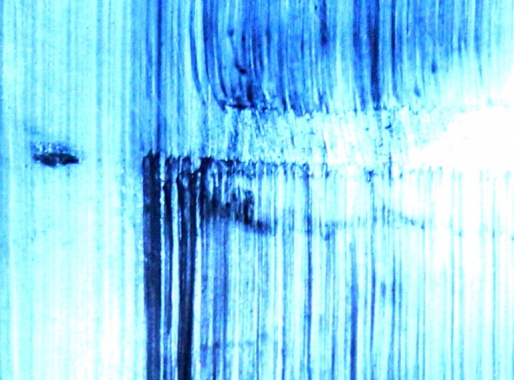
Photographie (détail) de Juan Asensio.
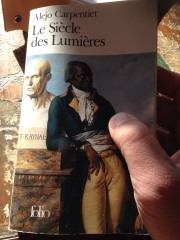 Pour se calibrer l’œil et même l'oreille, rien de tel que d'alterner les lectures d'un grand roman et d'un petit roman, et ainsi passer, pour ce qui me concerne, de Province de Richard Millet, étriqué comme un élastique de slip de crétin nationaliste, au Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier, un texte splendide où tout est ample et, si je ne craignais de commettre un jeu de mots faciles, où tout est temple.
Pour se calibrer l’œil et même l'oreille, rien de tel que d'alterner les lectures d'un grand roman et d'un petit roman, et ainsi passer, pour ce qui me concerne, de Province de Richard Millet, étriqué comme un élastique de slip de crétin nationaliste, au Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier, un texte splendide où tout est ample et, si je ne craignais de commettre un jeu de mots faciles, où tout est temple.La belle préface (1) signée de Jean Blanzat, qui a commis quelques ouvrages un peu trop étranges et aujourd'hui complètement oubliés, ne rend toutefois pas complètement justice à l'éblouissante profondeur du roman de Carpentier, qu'il conviendra d'indiquer, bientôt, dans la catégorie de mes monstres romanesques.
Le Siècle des Lumières a pour ambition affichée de tout dire, et la première épigraphe du texte, empruntée à l'énigmatique Zohar, nous l'indique suffisamment : non seulement, en effet, les «mots ne tombent pas dans le vide» (p. 17), mais ils ne cessent de résonner au travers des époques et des lieux, comme les coups que Victor Hugues a frappés à la porte des trois orphelins, «un certain soir» (p. 19), ne cessent de se répéter au cours du texte, et sont de prime abord annoncés par la scène d'ouverture (puis p. 104, où «son apparition, accompagnée d'un tonnerre de coups de marteau, avait eu quelque chose de diabolique») qui, chronologiquement, nous présente une action déjà bien engagée dans la trame du livre, au moment où Victor Hugue, désigné comme étant l'Investi de Pouvoirs, n'a plus rien du négociant à Port-au-Prince qu'il prétendait être, et initie sa terrifiante carrière d'exécuteur de l’Événement, la Révolution bien sûr.
 Il n'y a pas que les mots contenus dans les livres (plusieurs sont nommés, et tous ont leur importance) qui ne cessent de se renvoyer leur écho de page en page, de ville en ville, d'époque en époque mais aussi, ce que montre magnifiquement ce roman, de conscience en conscience, la Révolution (ou l’Événement) étant en premier lieu, n'étant peut-être même que cela, affaire de paroles, de mots écrits, imprimés sur des libelles ou des placards apportant les bienfaits révolutionnaires jusqu'aux coins les plus reculés du monde.
Il n'y a pas que les mots contenus dans les livres (plusieurs sont nommés, et tous ont leur importance) qui ne cessent de se renvoyer leur écho de page en page, de ville en ville, d'époque en époque mais aussi, ce que montre magnifiquement ce roman, de conscience en conscience, la Révolution (ou l’Événement) étant en premier lieu, n'étant peut-être même que cela, affaire de paroles, de mots écrits, imprimés sur des libelles ou des placards apportant les bienfaits révolutionnaires jusqu'aux coins les plus reculés du monde. Il y a, aussi, les images, indirectement évoquées par les nombreux commentaires que Goya donna à ses Désastres, singulièrement celle, fameuse, d'un tableau représentant une Explosion dans une cathédrale de Monsu Desiderio, un (double) peintre jamais nommé dans le texte de Carpentier, mais qui ponctue les grands mouvements du Siècle des Lumières. L'intention est claire, puisque le tableau, «une grande toile, venue de Naples, d'auteur inconnu», en contrariant «toutes les lois de la plastique», représente «l'apocalyptique immobilisation d'une catastrophe» (p. 31), en somme, l’Événement lui-même, qu'il sera si difficile d'apprécier à sa plus juste valeur et même, d'appréhender dans sa plus simple réalité, débordant de toutes parts, comme un grand tableau déborde de son cadre par trop étriqué, comme un meurtre, et quel meurtre !, défie les lois de l'entendement : «C'était quelque chose de si terrible, de si inattendu pour l'esprit, que les mots «roi» et «arrestation» n'arrivaient pas à s'accorder, à constituer une possibilité immédiatement admissible. Un monarque arrêté, couvert de honte, humilié, remis à la garde du peuple qu'il prétendait gouverner, alors qu'il était indigne de le faire. La couronne la plus majestueuse, le pouvoir le plus insigne, le plus noble sceptre de l'univers, amenés entre deux gendarmes» (p. 127). Ce n'est pas seulement le meurtre du Roi qu'il est impossible de comprendre, encore moins dans ses innombrables conséquences théologico-politiques au travers des siècles, mais la Révolution elle-même, comme s'il était tout bonnement illusoire de prétendre s'en approcher, la Révolution, ce qui porte ce nom grandiloquent, ne cachant finalement qu'une autre Révolution, plus intime, plus secrète, plus essentielle, au nom inconnu : «Plus qu'en une révolution, on eût dit qu'on était dans une gigantesque allégorie de la révolution; dans une métaphore de révolution, révolution faite ailleurs, centrée sur des pôles cachés, élaborée en des conciles occultes, invisibles pour ceux qui étaient anxieux de tout savoir» (p. 132). Mais, sur la Révolution, on ne sait rien, que l'on lise sur elle des centaines d'ouvrages ou bien qu'on la vive en tant que rouage plus ou moins important d'une Machine qui tout broiera, plus d'un million d'hommes s'il le faut (cf. p. 423), et c'est ainsi qu'«Esteban avait l'impression de décroître, de rapetisser, de perdre toute personnalité, d'être absorbé par l’Événement, en un lieu où sa très humble collaboration était irrémédiablement anonyme» (p. 152).
C'est peut-être la nature essentiellement verbale, langagière, de l’Événement qui le rend incompréhensible : c'est à mesure «que les navires s'éloignaient du continent» que la révolution, «qu'on laissait en arrière, se simplifiait dans les esprits désormais étrangers au tumulte des attroupements des rues, à la rhétorique des discours, aux batailles oratoires; l’Événement, réduit à des schémas, se délestait de ses contradictions» (p. 162). De ses contradictions peut-être, mais point de ses énigmes, qu'une autre histoire, cette fois-ci contre-révolutionnaire au sens le plus ésotérique de ce terme, pourrait peut-être démêler, tant elle semble constituer la trame réelle, le soubassement de tous les événements qui ont lieu sous les yeux de nos personnages qui, parfois, en soupçonnent l'existence sans pour autant se perdre dans les songes de la franc-maçonnerie et de la sorcellerie des esclaves noirs.
Le thème apocalyptique, et ses corollaires (l'attente d'une société plus juste, la terre promise, les signes qui y conduisent, la nostalgie du Paradis perdu (cf. pp. 367, 434), le déchaînement de la violence censée hâter l’Événement, les prédicateurs de ville, etc.) sont présents tout au long du grand roman d'Alejo Carpentier qui, je le disais, veut enserrer le vaste monde et, si possible, le formidable Événement, comparable à une explosion ébranlant l'univers entier. Tout est donc miroir, reflets de miroir, comme dans la maison de conte fantastique qu'habitent les trois adolescents (cf. p. 58), qu'arpente la jeune Sofia à la recherche d'un peu de fraîcheur ou d'un des innombrables livres qu'elle contient, maison de La Havane dans laquelle s'entassent tous les objets, tous les livres même, véritable cabinet de curiosités (cf. pp. 203, 259) et qui nous indique par avance le thème amplement développé durant les voyages d'Esteban, la gémellité symbolique des mots et des choses, des choses et des êtres, des vivants et des inertes, dans une communion universelle qui n'est cependant point animisme un peu sot et panthéisme désincarné : «Chaque être humain avait un double dans quelque créature végétale» (p. 66), et c'est finalement en vertu de ce principe si cher à tout occultiste ou, plus simplement, à tout enfant (2), qu'Esteban sera débarrassé de son terrible mal.
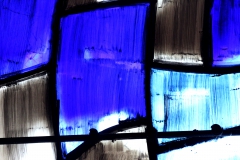 Dès qu'il sera guéri grâce aux connaissances peu avouables d'un ami de Victor Hugue, Esteban, le crâne tout farci des idées révolutionnaires «justifiant l'imminence d'un grand incendie» censé apporter une «purification nécessaire» et même, «une apocalypse à laquelle il était anxieux d'assister le plus tôt possible» (p. 101) pourra s'élancer, s'il est vrai que quand on s'est «employé à faire des révolutions, il est difficile de revenir en arrière» (p. 157), avec son ami Victor Hugue sur le théâtre des opérations, pourquoi pas dans les salles de tribunaux où, pour que la justice soit rendue plus rapidement, la guillotine peut, parfois, être installée (cf. p. 151).
Dès qu'il sera guéri grâce aux connaissances peu avouables d'un ami de Victor Hugue, Esteban, le crâne tout farci des idées révolutionnaires «justifiant l'imminence d'un grand incendie» censé apporter une «purification nécessaire» et même, «une apocalypse à laquelle il était anxieux d'assister le plus tôt possible» (p. 101) pourra s'élancer, s'il est vrai que quand on s'est «employé à faire des révolutions, il est difficile de revenir en arrière» (p. 157), avec son ami Victor Hugue sur le théâtre des opérations, pourquoi pas dans les salles de tribunaux où, pour que la justice soit rendue plus rapidement, la guillotine peut, parfois, être installée (cf. p. 151).Une fois lancés, les personnages, mais aussi, d'abord, l’Événement qu'est la Révolution française ne peuvent être arrêtés, comme si le déchirement du ciel qui s'encadre entre les hautes poutres de la terrible Machine ouvrant le roman (cf. p. 17) ne pouvait qu'être hâté par la grandeur du meurtre du Roi, la folie meurtrière des hommes massacrés, non seulement les anciens esclaves devenus libres qui, au gré des décisions politiques prises à Paris, retrouveront pourtant leurs chaînes (cf. p. 313 pour un résumé des différentes révoltes noires), mais aussi ceux qui, un temps, ont pu se croire grands en s'auréolant du prestige de l’Événement (à ce titre, la mort de Collot d'Herbois, dévoré par des porcs, est significative) : «Si les hommes avaient tant peiné, si tant d'entre eux avaient prophétisé, souffert, acclamé, étaient tombés, au milieu des incendies et des arcs de triomphe d'un vaste songe apocalyptique, il fallait qu'au moins le temps ne revînt pas en arrière» (p. 214). Pourtant, plus d'une fois même, il reviendra en arrière, ce temps que la narration fige, puis fait reculer jusqu'à l'aube d'une lointaine origine aussitôt enfuie qu'entrevue : «La brousse se refermait sur des hommes qui remontaient le cours de l'histoire, pour atteindre les temps où la création était régie par la Vénus féconde, aux grandes mamelles et au ventre large, adorée dans des cavernes profondes où la main avait balbutié en traits grossiers sa première figuration des besognes domestiques et des fêtes données en l'honneur des astres...» (p. 429).
Ainsi, Le Siècle des Lumières peut-il être lu comme le roman du dépouillement («le sentiment libérateur de ne rien posséder», p. 123) qui sera immédiatement suivi du départ, de l'emballement, d'une histoire non seulement protéiforme et incompréhensible, très souvent ironique dans ses voltes et contre-voltes (cf. p. 257 : un bateau négrier appartenant «à un armateur philosophe ami de Jean-Jacques» et s'appelant... Le Contrat Social), y compris même pour ceux qui en sont les exécutants, mais pleine de bruit et de fureur, ce bruit initié par les coups frappés par Victor Hugue à la porte de la demeure familiale des orphelins : «En ce temps-là une vitesse acquise, un élan toujours vif faisaient travailler beaucoup d'hommes dans un monde différent de celui qu'ils avaient voulu forger, déçus, aigris, mais incapables», affirme Carpentier, «de ne pas remplir parfaitement la tâche quotidienne» (p. 220).
Quelques haltes, tout de même, ponctuent la «tragédie transcendantale» (p. 151) qu'est la Révolution, comme celle, somptueuse, qu'évoque Esteban en mer, «transporté dans l'univers des symbioses», dans une nature prodigieusement riche en symboles, devenue temple et qui montre «une éternelle confusion entre ce qui appartenait à la plante et ce qui appartenait à l'animal» (p. 241), haltes éphémères sinon trompeuses, puisqu'on «allait à présent vers la mer, et au-delà de la mer vers l'immense océan des odyssées et des anabases» (p. 236), espace et temps mythique qui, tout en évoquant les premiers âges (3), convoquent une fois encore le déchaînement final, l’Événement donc, comparé pourtant à l'apparition énorme, lente, monstrueuse, d'un «poisson d'un autre âge, au museau mal placé à une extrémité de son corps massif enfermé dans une peur éternelle de sa propre lenteur, la peau couverte de végétations et de parasites, telle une coque non carénée», l'énorme animal montrant «son vaste dos dans un bouillonnement de rémoras, avec une solennité de galion renfloué, de patriarche abyssal, de Léviathan tiré à la lumière, soulevant autour de lui des flots d'écume, dans une remontée à la surface qui était peut-être la seconde depuis que l'astrolabe était arrivé dans ces parages» (p. 243), l'un et l'autre, passé le plus lointain et présent pourtant inconcevable dans sa singularité incompréhensible, se fondant dans un avenir qui est paradoxalement sous nos yeux, mais que nous ne pouvons voir ni comprendre, comme l'humanité a été aveugle, durant des millénaires, devant «la science des formes si longtemps déployée» que constituent «le flacon de l'oursin, l'hélice du couteau, les stries de la coquille Saint-Jacques», la question ne pouvant que se présenter à Esteban lui-même, à laquelle aucune réponse ne nous est donnée : «Que peut-il y avoir autour de moi qui soit désormais défini, inscrit, présent, et que je ne puisse pas encore comprendre ? Quel signe, quel message, quel avertissement, dans les boucles de la chicorée, l'alphabet des mousses, la géométrie de la pomme de rose ? Regarder un buccin. Un seul. Te Deum» (p. 245) conclut l'écrivain, rendre grâce, donc, du fait que l'infiniment petit n'est que le miroir réduit mais lui aussi vertigineux, pourvu que l'on s'y plonge, de l'infiniment grand, l'un et l'autre semblant d'une certaine façon plus perceptibles et même compréhensibles que les actions des hommes, et d'abord la première d'entre eux, cet Événement qui ne cesse de s'étendre, comme les coups frappés, un certain soir, par Victor Hugue qui lui aussi, sans être broyé par la Révolution, perdra sur le théâtre éloigné de la France où elle se déploie avec rage, ses plus hautes et nobles aspirations.
Temple rempli, des caves jusqu'aux plus hautes voûtes, de signes et de symboles, il eût été curieux que les personnages de Carpentier n'évoquent, pratiquement jamais, la question de Dieu, Esteban par exemple interprétant, non sans raison, la confusion de son époque qui n'est très visiblement pas faite pour les enfants de chœur (cf. p. 282) par le fait «qu'ils ont la nostalgie du crucifix. On ne peut être ni toréador ni corsaire sans avoir un temple pour rendre grâces à Quelqu'un d'être encore en vie» (pp. 271-2). Ailleurs, c'est une nouvelle fois par l'évocation du symbolisme, en l'occurrence celui d'un «grand crucifix, accroché face à une fenêtre ouverte sur la mer», qu'Alejo Carpentier affirme l'existence de l'invisible caché au plus secret du visible : «Entre ces quatre murs blanchis à la chaux, où il n'y avait en fait de meubles que deux tabourets, l'un en cuir poilu de bœuf, l'autre de crins d'âne tressés, le dialogue entre l'océan et la Figure devenait d'un pathétisme soutenu et éternel, situé hors de toute contingence et de tout lieu. Tout ce qui pouvait être dit de l'homme et de son monde, tout ce que pouvaient contenir lumières, monstres et ténèbres était dit, et dit à jamais, dans cet espace qui allait d'une lisse géométrie de bois noir à la fluide immensité du placenta universel, avec ce corps interposé, au moment suprême de son agonie et de sa résurrection...» (p. 300). La croix est à la fois «une ancre et un arbre, et il fallait que le fils de Dieu souffrît son agonie sur la forme qui symbolisait à la fois la terre et l'eau, le bois et la mer», cette universalité faisant naître ce soupçon dans l'esprit d'Esteban, qui «se mit brusquement à penser que la faiblesse de la révolution, qui faisait tant retentir le monde de clameurs d'un nouveau Dies Irae, résidait dans son manque de dieux valables. L'Être Suprême était un dieu sans histoire. On n'avait pas vu surgir un Moïse assez grand pour écouter les paroles du buisson ardent, et concerter une alliance entre l'éternel et les tribus de sa prédilection» (p. 301). Mais surtout, poursuit Alejo Carpentier, «il ne s'était pas fait chair et n'avait pas habité parmi nous. Aux cérémonies célébrées en son honneur manquait la sacralité : il manquait la continuité dans les intentions, la foi inébranlable devant le contingent et l'immédiat qui inscrivaient dans une trajectoire multiséculaire le lapidé de Jérusalem avec les quarante légionnaires de Sébactès» (pp. 301-2).
En fait d'incarnation, le roman d'Alejo Carpentier aurait plutôt tendance à décrire des corps pourrissant «dans l'atmosphère sordide et déprimante de Cayenne, monde dont l'histoire tout entière n'était qu'une série de rapines, d'épidémies, de meurtres, d'exils, d'agonies collectives» (p. 321), mais la petite histoire, en effet sordide, où les favoris d'un temps deviennent les conspués de celui qui le suit, cède comme toujours avec Carpentier la place à l'histoire longue, s'étendant sur plusieurs siècles voire plusieurs millénaires, comme la longue épopée des peuples des Caraïbes, s'élançant sur les océans pour enfin fouler «la terre de promission» (p. 333), restant cependant fidèles à un mythe changeant de caractère «selon la couleur des siècles», mythe «répondant à des désirs toujours renouvelés», mais restant toujours le même : «il y avait, il devait y avoir, il fallait qu'il y eût à l'époque présente», et «à n'importe quelle époque présente» ajoute l'auteur, «un monde meilleur» (pp. 333-4), les peuples des Caraïbes ayant imaginé ce monde meilleur à leur façon, «comme l'avait imaginé à son tour» «le Grand Amiral d'Isabelle et de Ferdinand», ou comme les Portugais ont rêvé «au royaume admirable du Prêtre Jean», comme devaient rêver, un jour, «au Pays de Cocagne, les enfants du haut plateau castillan après avoir dîné d'un maigre croûton de pain frotté d'huile et d'ail» (p. 334), le rêve se brisant sur la réalité, souvent sordide, les espoirs (les espérances ?) d'Esteban transformés en un «long cauchemar», traversé «d'incendies, de persécutions, de châtiments», cauchemar annoncé, nous dit l'auteur, «par le Cazotte dont les chameaux vomissaient des lévriers, par les nombreux augures de la fin des temps, qui avaient tant proliféré en ce siècle si long qu'il était aussi chargé d'actions que plusieurs siècles réunis» (p. 334).
La vision, grandiose, que déploie Alejo Carpentier se resserre toutefois aux dimensions d'un tableau, nous savons lequel, qu'Esteban sera frappé de revoir lorsqu'il reviendra dans la maison de son enfance, une fois ses illusions perdues sur la Révolution et ses idées grandiloquentes. Il y avait, dans ce tableau, nous dit l'écrivain, «comme une préfiguration de tant d'événements connus qu'il se sentait étourdi par la qualité d'interprétations auxquelles se prêtait cette toile prophétique, anti-plastique, étrangère à toute école de peinture, qui était parvenue dans cette maison par un hasard mystérieux» (pp. 339-40) car, si «la cathédrale symbolisait l'époque, une formidable explosion, en effet, avait jeté bas ses murs principaux, enterrant sous une avalanche de décombres ceux-là mêmes qui peut-être avaient construit la machine infernale. Si la cathédrale représentait l’Église chrétienne, Esteban remarquait qu'une rangée de fortes colonnes y demeurait intacte, devant celle qui, réduite en morceaux, s'écroulait dans le tableau apocalyptique, tel un présage de résistance, de pérennité et de reconstruction, après le temps de malheurs et d'étoiles annonciatrices d'abîmes» (p. 340). Avant d'être emprisonné, Esteban verra une dernière fois ce tableau, devant lequel il s'arrête : «Même les pierres que j'irai casser maintenant étaient déjà présentes dans ce tableau», affirme-t-il tout en saisissant, un tabouret que, de rage de se voir ainsi emprisonné dans une toile qui aura contenu toute l'histoire, la petite et la grande, la sienne et celle de l’Événement formidable, il lancera contre la toile, «y ouvrant une brèche et la faisant tomber avec fracas» (p. 398), cette toile pour le moins symbolique, puisqu'elle semble résumer l'aventure même de l'Occident, devant être détruite, à tout le moins déchirée, pour que s'écoule un temps beaucoup plus long, à vrai dire immémorial, et que s'ouvre une histoire non plus immédiate et incompréhensible, mais secrète, pleine d'une beauté inouïe, riche de formes innombrables qui feraient progresser les hommes qui, hardiment, s'y élanceraient, «Mer Première de la création, antérieure au murex et à l'argonaute» (p. 399), ouvrant elle-même un espace, «un ciel dont le simple énoncé verbal recouvrait l'écrasante majesté qu'avait eue un jour ce mot, pour ceux qui l'avaient inventé peut-être après ceux qui commençaient à peine à définir la douleur, la peur ou la faim» (pp. 399-400), le ciel prenant sur une mer déserte «un poids énorme, avec ces constellations vues depuis toujours, que l'être humain avait peu à peu isolées et nommées à travers les siècles, projetant ses propres mythes sur l'inaccessible, ajustant les positions des étoiles au contour des figures qui peuplaient ses pensées de perpétuel inventeur de fables» (p. 400). Une dernière fois, le langage des origines sera évoqué, à propos des amants, le langage de Sofia et de Victor Hugue retournant «à la parole nue, au balbutiement d'une parole antérieure à toute poésie, parole d'action de grâces devant le soleil qui brûlait, le fleuve qui débordait sur la terre défrichée, la graine reçue par le sillon, l'épi dressé tel un fuseau de fileuse. Le verbe naissait du toucher, élémentaire et pur, comme l'activité qui l'engendrait» (pp. 418-9).
Le mouvement d'expansion, c'est une règle dans ce roman épique, est immédiatement suivi par un mouvement de contraction, comme si l'espace de l'écriture ne pouvait que se tenir entre ces deux extrêmes que sont l'évocation d'une suite de siècles dont certains n'ont parfois même pas de nom et les quelques années où un homme, comme Victor Hugue rappelant le Kurtz de Conrad, était capable de «mûrir de grandes entreprises» (p. 389), atteignant même une dimension biblique lorsqu'il est qualifié d'homme «de la Grande Tâche» déjà en action, «écartant les fouillis des forêts, comme les Hébreux les eaux de la Mer Rouge» (p. 406). C'est donc ce même tableau bien sûr qui occupera les toutes dernières lignes du roman, dans une fin qui ne peut que rappeler celle du texte le plus célèbre d'Oscar Wilde, Carlos (l'un des trois du groupe des inséparables, qui finiront par l'être, séparés, avec Esteban et Sofia) fermant une maison désormais vide et, lorsque «la dernière porte eut été fermée, le tableau de L'Explosion dans une cathédrale oublié à sa place, peut-être volontairement, cessa d'avoir un sujet; il s'effaça, projetant son ombre sur l'incarnat foncé du brocart qui tapissait les murs du salon, et semblait saigner à l'endroit où l'humidité avait taché le tissu» (p. 464), cette fin mystérieuse à l'aura fantastique condensant les centaines de pages qui la précèdent, le tableau de Monsu Desiderio étant en fin de compte aussi peu réel que l’Événement qui a peut-être tenu dans ce «moment imprécis, indéterminable mais terrifiant, où s'était opéré dans les âmes un changement radical» (p. 349), mais qui en tout cas, fruit pourri d'un «obscur élan millénaire qui aboutissait à l'aventure la plus ambitieuse de l'être humain» (p. 350)Il n'y a pas d'autre terre promise que « celle que l'homme peut trouver en lui-même », affirme Esteban, et c'est sans doute pour cela qu'il disparaîtra, avec Sofia revenue de tout elle aussi, et d'abord de son grand amour secret pour Victor Hugue qui l'aura pourtant déçue ; Sofia est revenue de tout disais-je, de ses attentes d'une époque naissante « qui accomplirait, dans ces régions, ce qui avait échoué dans l'Europe caduque » (p. 407), mais pas de ses propres illusions sur l’Événement, en se battant contre les Français venus en Espagne, n'écoutant l'un et l'autre, Sofia et celui qui l'a aimée en secret, que leur cœur, dont on ne sait si la Révolution française est parvenue à entamer la chaude matière. mais qui a pourtant décimé les troupeaux, confondu les langues et dispersé les tribus (cf. p. 356), s'est écroulé comme une pure création de mots. Car il faut se garder des «trop belles paroles», tout comme il faut se garder des «mondes meilleurs créés par les mots», notre époque succombant «sous un excès de mots» (p. 351) et de paradoxes meurtriers puisque, «avec la liberté, la première guillotine [est arrivée] au Nouveau Monde» (p. 181), puisque, encore, «les meilleures intentions [ont] eu jusqu'à présent de terrifiants rebondissements» (pp. 216-7).
Il n'y a pas d'autre terre promise que «celle que l'homme peut trouver en lui-même», affirme Esteban, et c'est sans doute pour cela qu'il disparaîtra, avec Sofia revenue de tout elle aussi, et d'abord de son grand amour secret pour Victor Hugue qui l'aura pourtant déçue ; Sofia est revenue de tout disais-je, de ses attentes d'une époque naissante «qui accomplirait, dans ces régions, ce qui avait échoué dans l'Europe caduque» (p. 407), mais pas de ses propres illusions sur l’Événement, en se battant contre les Français venus en Espagne, n'écoutant l'un et l'autre, Sofia et celui qui l'a aimée en secret, que leur cœur, dont on ne sait si la Révolution française est parvenue à entamer la chaude matière.
Notes
(1) Alejo Carpentier, Le Siècle des Lumières (1962, traduction de l'espagnol par René L.-F. Durand, Gallimard, coll. Folio, 2005).
(2) «Le goût de l'adolescence pour le travesti, le mot de passe, les boîtes aux lettres ignorées, les cryptographies particulières, les cahiers intimes garnis de fermetures, prenait une vie nouvelle dans l'aventure entrevue» (pp. 94-5).
(3) Et il est alors de frappant de constater que la question du langage, et d'un langage étonnamment peu évolué, au rebours des représentations habituelles du langage adamique, du premier homme, se pose : «Esteban voyait dans les forêts de corail une image tangible, une figuration proche et pourtant si inaccessible du paradis perdu, où les arbres, mal nommés encore, et dans une langue malhabile et hésitante par un homme-enfant, avaient dû être doués de l'apparente immortalité de cette flore somptueuse, d'ostensoir, de buissons ardent, pour laquelle les automnes ou les printemps ne se manifestent qu'en variations de teintes ou en légers transferts d'ombres...» (p. 240). Quelques lignes plus bas, le langage adamique est de nouveau évoqué, Esteban étant «rempli d'étonnement» en remarquant que «le langage, en ces îles, avait dû utiliser l'agglutination, l'amalgame verbal et la métaphore, pour traduire l'ambiguïté formelle de choses qui participaient à plusieurs essences» (p. 242).



























































 Imprimer
Imprimer