« Actualités de la Gnose autour de La poésie et la gnose d’Yves Bonnefoy, par Baptiste Rappin | Page d'accueil | Le Siècle des Lumières d'Alejo Carpentier »
06/12/2016
Les Déracinés de Maurice Barrès

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures.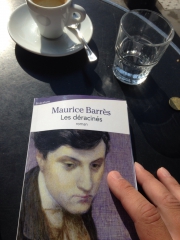 Acheter Les Déracinés sur Amazon.
Acheter Les Déracinés sur Amazon.Finalement, c'est dès les toutes premières pages des Déracinés de Maurice Barrès que le prophétisme de l'écrivain, sur lequel Michel Mourlet a écrit de justes pages (1), éclate : «La grande affaire pour les générations précédentes fut le passage de l'absolu au relatif; il s'agit aujourd'hui de passer des certitudes à la négation sans y perdre toute valeur morale» (2). Cette phrase résonne comme un puissant son de cloche sonnant la fin de la récréation métaphysique de l'homme du néant, Monsieur Bouteiller si l'on y tient qui, quelques espérances en plus, tout de même, par rapport à nous, était déjà le type commun, l'homme du commun plutôt à l'époque de Barrès. Cette phrase qui ressemble à une épitaphe me semble néanmoins quelque peu redondante, car l'absolu est le temps des certitudes, comme le relatif est celui de la négation. Il n'en reste pas moins vrai que Les Déracinés annoncent notre époque et, plus que notre époque, le type et le sur-type, le modèle de l'homme des foules, l'homme anonyme, l'anonyme même, l'homme du commun, sans toit ni loi, l'un de ces péquenots si parfaitement interchangeables que nul, en consommant ce qui fut autrefois sa substance comme nous le voyons, sans même éprouver beaucoup d'horreur, dans Soleil vert, ne s'aviserait de se soucier qu'il lui a peut-être serré la main avant qu'il ne termine dans son estomac.
Le déracinement est la grande affaire de Maurice Barrès, à laquelle Simone Weil répondra indirectement par son Enracinement, et que l'auteur impute à la philosophie kantienne et à son plus éminent représentant en lycée de région lorraine, Bouteiller, «produit pédagogique» et «fils de la raison», mauvais masseur en somme selon Barrès puisque, à la différence d'un bon praticien, celui-ci ne s'avisera jamais de traiter «les muscles de son client d'après le tempérament qu'il lui voit», et puisque encore ses propres «mœurs, ses attaches, il les a discutées, préférées et décidées» selon une vertu purement raisonnable, en se débarrassant de toute contingence par trop liée à la terre, au sol, à la lumière et à l'air des ancêtres : «Déraciner ces enfants, les détacher du sol et du groupe social où tout les relie, pour les placer hors de leurs préjugés dans la retraite abstraite, comment cela le gênerait-il, lui qui n'a pas de sol, ni de société, ni, pense-t-il, de préjugés ?» (p. 24). Il en a tellement peu, à vrai dire, qu'il en semble désincarné, et c'est frappant comme le fantôme de Bouteiller devient pâle une fois le livre de son maître refermé, alors que la silhouette d'un Racadot se détache sur une lumière de venelle qui en accroît l'épaisseur.
 Nous avons tous croisé, au cours de notre scolarité, un Bouteiller, un de ces hommes à «l'âme un peu basse», sorcier moderne en somme qui peut faire aux jeunes élèves «l'illusion d'un philosophe [alors qu'il] n'était qu'un administrateur», avertissant les enfants «sur leur emploi et non seul leur être» (p. 30), tandis que, nous dit Barrès avec une pointe d'ironique méchanceté, les «intérêts réels de l'enfant et de ce coin de France, le canton de Varennes, ont été étudiés de plus près par cette vieille dame que par un philosophe nomade» (p. 31). Notons que le nomadisme est affecté d'une étrange polarité, pour le moins contradictoire puisque, lorsqu'il est appliqué à Bouteiller, c'est une critique franche contre le représentant de tous les maux qu'incarne la France de l'époque de Barrès, croulant sous le «verbalisme administratif» et qui méprise «les réalités les plus aisément tangibles» (p. 33), mais, ailleurs, ce même nomadisme s'auréole des prestiges de l'Orient désertique (cf. p. 36) dans cette belle image : «...Rien de plus fort que le vent du matin qui s'engouffre au manteau du nomade, quand, sa tente pliée, il fuit dans le désert» (p. 36). C'est pourtant le désert que ne va pas tarder à devenir la France que fait progresser le très laïc zèle du serviteur de l'Idée qu'est Paul Bouteiller.
Nous avons tous croisé, au cours de notre scolarité, un Bouteiller, un de ces hommes à «l'âme un peu basse», sorcier moderne en somme qui peut faire aux jeunes élèves «l'illusion d'un philosophe [alors qu'il] n'était qu'un administrateur», avertissant les enfants «sur leur emploi et non seul leur être» (p. 30), tandis que, nous dit Barrès avec une pointe d'ironique méchanceté, les «intérêts réels de l'enfant et de ce coin de France, le canton de Varennes, ont été étudiés de plus près par cette vieille dame que par un philosophe nomade» (p. 31). Notons que le nomadisme est affecté d'une étrange polarité, pour le moins contradictoire puisque, lorsqu'il est appliqué à Bouteiller, c'est une critique franche contre le représentant de tous les maux qu'incarne la France de l'époque de Barrès, croulant sous le «verbalisme administratif» et qui méprise «les réalités les plus aisément tangibles» (p. 33), mais, ailleurs, ce même nomadisme s'auréole des prestiges de l'Orient désertique (cf. p. 36) dans cette belle image : «...Rien de plus fort que le vent du matin qui s'engouffre au manteau du nomade, quand, sa tente pliée, il fuit dans le désert» (p. 36). C'est pourtant le désert que ne va pas tarder à devenir la France que fait progresser le très laïc zèle du serviteur de l'Idée qu'est Paul Bouteiller. Revenons à celui-ci d'ailleurs qui, selon Maurice Barrès, serait coupable d'enfermer ses élèves dans «une clôture monacale et dans une vision décharnée des faits officiels et de quelques grands hommes à l'usage du baccalauréat», et qui ne comprendra guère «que la race de leur pays existe, que la terre de leur pays est une réalité et que, plus existant, plus réel encore que la terre ou la race, l'esprit de chaque petite patrie est pour ses fils instrument d'éducation et de vie» (p. 33). Paul Bouteiller a fait de ses élèves, cause de leurs infortunes futures, «des citoyens de l'humanité, des affranchis, des initiés de la raison pure», ce qui ne peut qu'accroître le désordre mis dans notre pays, déjà durement éprouvé «par des importations de vérités exotiques, quand il n'y a pour nous de vérités utiles que tirées de notre fonds» (p. 34). En somme, cet homme n'est qu'un «instrument de transmission» (p. 36) d'un déracinement qui touche toutes les sphères sociales de la France et, très certainement, toute l'Europe et même le monde occidental.
En voilà un, dont la description de la vie intérieure ne correspondrait pas à la description de «son pays qui seul l'anime» (p. 45), et qu'il est loin, aussi, le passé de la France féodale, «qui attachait l'homme au sol et le tournait à chercher sa loi et ses destinées dans les conditions de son lieu de naissance» (p. 47), alors même que nos déracinés seront vite obligés de se rendre à Paris pour réussir, n'étant plus dès lors que des corps qui tombent dans la foule, où ils ne cesseront pas de «gesticuler et de se transformer» jusqu'à ce qu'ils en sortent, dégradés ou ennoblis, cadavres dans tous les cas (cf. p. 53) !
Que deviendront les élèves de M. Bouteiller ? Il suffit de lire le roman de Maurice Barrès pour le savoir, mais leurs fortunes et infortunes romanesque nous importent bien moins que leur incapacité à se libérer de la matrice qui semble ne plus pouvoir générer autre chose qu'un «immense troupeau consum[ant] sa poésie à espérer» que l'un d'entre eux, l'heureux élu, soit un jour ou l'autre «fonctionnaire» (p. 65). Finalement, ce qu'offre la France, ce n'est rien de plus qu'une existence allant de la «naissance à la mort comme un petit sterlet descend la Volga, perdu parmi les bancs épais des sterlets», ou encore une existence «à mûrir au soleil comme un raisin dans les vignes, parmi tous les raisins». Mais ce n'est cependant pas en France, nous confie telle belle tentatrice orientale, qu'irait se rendre «qui ne veut pas suivre ses jours comme le sterlet descend son fleuve», mais «aux pentes de l'Ararat» : «Si tu luttais, Arménien, pour la nation arménienne, tu intéresserais un peuple qui peut encore se flatter d'illusions, faire de la gloire et récompenser. Tu courrais des risques réels. Et ce qui t'envelopperait de toutes manières, c'est le climat, la diversité des types, la sensation de la brièveté, de l'inépuisable fécondité de la vie, prodiguant des hommes braves, des belles femmes, des fleurs, des fruits, des animaux, tous d'un rapide éclat et qui ne passent pas comme ici leur temps à se disputer à la mort» (p. 92). Que pourrait faire un jeune Français dont l'enseignement universitaire «l'a conduit sur le plan de la raison universelle» et ayant délaissé «son domaine national», se détournant des «vraies propriétés psychiques» de ce dernier (p. 94) ? Rien de plus, supposons-nous, que de rêver à une gloire perdue, et s'imaginer sous les atours d'un Byron ou, pour les plus béjaunes ou les plus malchanceux, dans la peau affabulatrice d'un Richard Millet, aventurier de salon. Oui, les temps sont durs pour les jeunes hommes avides de modèles.
Il est désormais trop tard pour se rêver un destin à la Byron et nos grands hommes sont morts : «Sur cette haute terre, il est beau que soit installé le Panthéon, essai d'un culte qu'il faudrait rendre aux grandes ombres. Le voilà, le point suffisant de centralisation. Une chaire suprême, un cimetière et des génies font l'essentiel de la patrie» (p. 98). Dès lors, nos jeunes esprits qui «ne sont pas une démocratie qui monte, mais une aristocratie dégradée» (p. 114), une fois «déliés de leur pays et de toute société», «c'est à la liberté dont ils meurent qu'ils font appel pour vivre» (p. 105) écrit superbement Barrès, certains d'entre eux parvenant tout de même à s'emparer d'une carrière de publiciste puisque «le vrai moyen des êtres livresques» «pour mener, réclamer et divaguer» (p. 136) n'est autre que le journalisme.
Le «passage de l'absolu au relatif» (p. 147) hante décidément Barrès, qui le mentionne de nouveau, puis encore une fois, évoquant une «génération établie dans le relatif et qui constate pourtant la difficulté de se passer d'un absolu moral», difficulté qui elle-même «se marque», dans l'esprit d'un de ces jeunes hommes que nous suivons, par le sentiment de «répugnance au matérialisme amoral» (p. 148) qu'il éprouve.
Que serait donc le contraire de ce «matérialisme amoral» ? Certainement pas Dieu, si peu présent dans le roman de Barrès. L'arbre, si fameux chez les apôtres du nationalisme, de M. Taine alors, «masse puissante de verdure» qui «obéit à une raison secrète, à la plus sublime philosophie, qui est l'acceptation des nécessité de la vie» ? : «Sans se renier, sans s'abandonner, il a tiré des conditions fournies par la réalité le meilleur parti, le plus utile. Depuis les plus grandes branches jusqu'aux plus petites radicelles, tout entier il a opéré le même mouvement...» (p. 153). Rappelons que Taine compare lui-même la société française à un arbre dans ses Origines de la France contemporaine, arbre immense dont le tronc «épaissi par l’âge, garde dans ses couches superposées, dans ses nœuds, dans ses courbures, dans son branchage, tous les dépôts de sa sève et l’empreinte des innombrables saisons qu’il a traversées». Dans le meilleur des cas, cet arbre, lui aussi, a été déraciné, et reprendra peut-être racine. Dans le pire, il a été complètement tari, racines comprises.
Ni Dieu ni l'arbre de M. Taine, donc. Alors, quoi ou qui ? Napoléon, homme prodigieux qui, à la différence d'un Chateaubriand ou d'un Byron, ne flotte pas mais crée de l'ordre (cf. pp. 172-3), à la fois singulier et multiple, symbole encore d'une prodigieuse destinée comme l'est l'arbre de M. Taine ? Les nuages, affirme Maurice Barrès, «dont l'ensemble peut faire le ciel même», symbolisent magnifiquement «le sens universel qu'a pris, dans une époque où il ferme tous les horizons, cet homme singulier» et pourtant multiple disais-je, puisque, toujours comme les nuages, il se plaît à changer, et son action «se déploie tantôt en une demi-sphère magnifique, tantôt en figures innombrables» (p. 167). Les pages que Barrès consacre aux funérailles du grand Hugo, considéré comme «le maître des mots français» (p. 332) sont elles aussi célèbres, qui nous montrent l'attachement d'un écrivain à la puissance de langage d'un autre écrivain, poète de génie sachant utiliser les mots de la tribu, c'est le cas de le dire, pour les transformer en geste non seulement nationale au sens le plus épique de ce terme, mais elle aussi symbolique, en ceci qu'elle ne nous isole pas au sein de l'immense Création : «Les mots, tels que savait les disposer son prodigieux génie verbal, rendent sensibles d'innombrables fils secrets qui relient chacun de nous avec la nature entière» (p. 334). Finalement, quel que soit le domaine qu'aborde Barrès, c'est toujours une même exigence, une même cohérence quasiment organique qu'il recherche et, surtout, qui soit capable d'être transmise au cours des âges, d'homme à homme, de père en fils : «C'est ici, depuis les bégaiements du XIIe siècle, que se sont composées les formules où notre race a pris conscience et a donné communication au monde des bonnes choses qui lui sont propres» (p. 343).
S'agira-t-il encore d'opposer «la substance française» au matérialisme amoral, et qu'entend donc le romancier par ces termes ? Le voici qui déclare : «En principe, la personnalité doit être considérée comme un pur accident. Le véritable fonds du Français est une nature commune, un produit social et historique, possédé en participation par chacun de nous; c'est la somme des natures constituées dans chaque ordre, dans la classe des ruraux, dans la banque et l'industrie, dans les associations ouvrières, ou encore par les idéals religieux, et elle évolue lentement et continuellement» (pp. 182-3), comme l'arbre de M. Taine, serions-nous encore tentés de dire.
Et Barrès d'annoncer, le style d'un véritable écrivain en plus, les obsessions de Renaud Camus, lorsqu'il affirme, à la suite du passage que nous venons de citer, que, si «nous admettons que nos forces constitutives sont dissociées et contradictoires, le fonds de notre vie, notre vraie réalité, notre énergie, ne sont-ils pas gravement atteints ?», Barrès se faisant sociologue pour conclure ce passage important par ce constat qui, commenté aujourd'hui, lui vaudrait les foudres des prudents et des imbéciles, de finalement presque tout ce que compte Paris en pseudo-intelligences : «Ce qui nous confirme dans cette vue, c'est de constater que la puissance de reproduction est en baisse, et que la résistance faiblit sur les frontières de l'Est, d'où l'esprit allemand fuse dans tous les sens sur notre territoire et dans nos esprits» (p. 183). Plus loin, Barrès regrettera que les petites villes de l'Est de la France perdent leur âme, phénomène dont il rendra responsable le départ «des fils pour la ville» et «l'arrivée des Allemands», la «race germaine se substitu[ant]» (p. 238) à la française dans cette région. La question juive, mais à petite échelle, à échelle française si je puis dire, sera abordée (cf. p. 239), non sans quelque habituelle, hélas à cette époque, pente pour la caricature, l'auteur évoquant de nouveau cette idée qui sera reprise des milliers de fois à sa suite, et qui constituera, pour ses descendants, un véritable «Sedan intellectuel» : «La France débilitée n'a plus l'énergie de faire de la matière française avec les éléments étrangers. Je l'ai vu dans l'Est, où sont les principaux laboratoires de Français. C'est pourtant une condition nécessaire à la vie de ce pays : à toutes les époques la France fut une route, un chemin pour le Nord émigrant vers le Sud; elle ramassait ces étrangers pour s'en fortifier. Aujourd'hui, ces vagabonds nous transforment à leur ressemblance !» (pp. 240-1). Les derniers essais de Renaud Camus tiennent je l'ai dit tout entier dans ces quelques lignes. En excellent lecteur de Barrès, le si subtil Guy Dupré a pu écrire : «Renan à Déroulède : «Jeune homme, jeune homme, la France se meurt, ne troublez pas son agonie.» Perte de substance probablement sans exemple dans l’Histoire : au cours de la plus longue période pacifique qu’ait connue la France, de 1871 à 1914, le chiffre des Français s’élève de trente-sept à trente-neuf millions, alors que les Allemands passent de trente-sept à soixante-sept. À l’esprit qui se penche sur l’histoire pathétique du nationalisme français, ce manque à gagner de trente millions d’âmes doit toujours rester présent» (3).
Idées trop hautement désincarnées, cultivées hors-sol dirions-nous aujourd'hui, étrangers que le pays, perdant sa substance, est incapable d'agréger à son propre peuple, autant d'intrusions mortelles qui entament la «substance nationale» (p. 184), alors même que des «parties importantes du pays ne reçoivent plus d'impulsion, un cerveau leur manque qui remplisse près d'elles son rôle de protection, qui leur permette d'éviter un obstacle, d'écarter un danger» (p. 193), et que «ce déraciné supérieur Bouteiller» (p. 227), au lieu «d'atténuer ou de nationaliser» le moi de ses élèves, l'a exalté, les plaçant «dans des situations auxquelles nulle longue habitude ne les préparait» (p. 226). Car il eût fallu, plutôt qu'un trop sobre commentateur de Kant, un maître dont la politique découlerait «d'un principe religieux», à savoir, précise Barrès, une certitude affirmée en commun» (p. 228), autre façon de parler d'une «unité vitale» (p. 230) dont il faudra déterminer, ce qui sera l'objet d'une discussion passionnée entre nos jeunes amis, s'il s'agit d'un catholicisme point réduit au cléricalisme, «religion d'une puissance de vie sociale incomparable et qui depuis des siècles anime ce pays» qu'il ne faut donc pas confondre «avec sa caricature de sacristie» (p. 231) selon Saint-Phlin. Quelques lignes plus bas, Suret-Lefort, lui, préférera louer «le génie sentencieux de Robespierre» cherchant à «fortifier et unifier la nation par un sentiment religieux», tout en reconnaissant qu'il a échoué, car la «tradition de notre pays est politique, rien de plus. Nous sommes un pays de gouvernement. Que la République montre de l'autorité, voilà tout le nécessaire, c'est chimère de chercher une force dans je ne sais quel sentiment religieux qu'annulera toujours le sarcasme d'un Vadier» (p. 231).
Quoi qu'il en soit, nous pourrions évoquer les jeunes personnages imaginés par Barrès en parlant, à leur propos, de dépossession, la déchéance physique et morale d'un Racadot étant finalement due, dans sa racine la plus secrète, à sa transplantation parisienne : «Nous sommes des botanistes qui observons sept à huit plantes transplantées et leurs efforts pour reprendre racine» (p. 304).
Les jeunes hommes que nous avons suivis n'ont pas réussi à prendre racine, du moins Racadot et Mouchefrin, dont la déveine semble déjà inscrite dans la bassesse du patronyme. Mais il est étonnant de voir que Barrès ne condamne pas ces personnages, quels que soient leurs déboires et même crime, alors qu'il ne témoigne d'aucune pitié pour les maîtres de cette jeunesse déracinée : «Ceux qui avaient dirigé cette émigration avaient-ils senti qu'ils avaient charge d'âmes ? Avaient-ils vu la périlleuse gravité de leur acte ?». C'est à ces déracinés qu'un Bouteiller n'a pas su offrir «un bon terrain de replantement» car, ne sachant «s'ils voulaient en faire des citoyens de l'humanité, ou des Français de France, ils les tirèrent de leurs maisons séculaires, bien conditionnées, et ne s'en occupèrent pas davantage, ayant ainsi travaillé pour faire de jeunes bêtes sans tanières. De leur ordre naturel, peut-être humble, mais enfin social, ils sont passés à l'anarchie, à un désordre mortel» (p. 345).
Finalement, la France tout entière est vidée de ses forces vives car elle a voulu se placer à une hauteur qui lui a fait perdre de vue la modestie, mais aussi la vigueur, de ses origines, et c'est ainsi que Les Déracinés auraient pu s'intituler La France déracinée voire diluée, à savoir la France prétentieuse des Lumières, de la Révolution à vocation mondiale, prétendant faire de ses propres «enfants de la tradition» des «citoyens de l'univers», opération qui est finalement celle de toutes les utopies politiques, y compris violentes, le doux, mais, à sa façon, implacable Bouteiller, que nous ne manquerions pas d'étonner en affirmant cela, endossant assez vite et commodément les habits du dictateur n'hésitant pas à jeter en terre et comme s'il s'agissait de terreau, pour faire fructifier l'arbre étique de l'Idée, le nombre qu'il faudra de misérables, d'humiliés et d'offensés mais surtout, pour le dire avec Barrès qui, en tant qu'écrivain, sait parfaitement qu'il peut se dédouaner de sa responsabilité (cf. p. 357), de véritables «sacrifiés» (p. 354).
Notes
(1) Michel Mourlet, «Le prophétisme dans Les Déracinés» in Barrès, une tradition dans la modernité (Honoré Champion, 1991).
(2) Maurice Barrès, Les Déracinés (Bartillat, Coll. Omnia, 2010), pp. 20-1.
(3) Guy Dupré, La feue France (préface à La République ou le Roi, Correspondance Barrès-Maurras, Plon, 1970), in Je dis nous (La Table Ronde, 2007), pp. 113-4.



























































 Imprimer
Imprimer