« Les racines du mal de Maurice G. Dantec : l’implantation du Diable et le défrichement de Dieu, par Gregory Mion | Page d'accueil | Une génération perdue de Maurizio Serra »
29/09/2016
Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Gleb Garanich (Reuters).
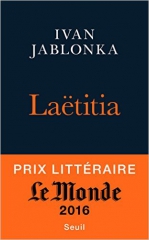 Acheter Laëtitia ou la fin des hommes sur Amazon.
Acheter Laëtitia ou la fin des hommes sur Amazon.«Moi aussi j’interprète, d’ailleurs, et je suis très loin d’être de taille à le faire comme il le faudrait. J’assiste à un drame et je n’y suis pas insensible».
Jean Giono, Notes sur l’affaire Dominici.
Un livre sérieux dont le propos a été négligemment rapporté : de l’oisiveté et du festivisme journalistiques
Au tout premier abord, on pourrait se demander pour quelles étranges raisons ce livre d’Ivan Jablonka fait des cabrioles et des entrechats sur de nombreuses listes de prix littéraires, unanimement soutenu par de non moins nombreuses salles de rédaction qui se sont empressées d’écrire sur Laëtitia ou la fin des hommes (1) des articles souvent simplistes, parfois niais, tenant davantage de la réclame pour mauvais catalogue de poiscaille des Pays de la Loire que d’une recension dûment réfléchie. La niaiserie et la superficialité ne sont certes pas des affections nouvelles dans le journalisme français, dont la consanguinité de plus en plus phénoménale permet à tous ces médiocres de sang-régulier de cotiser pour la retraite et de préparer tranquillement le recrutement de leur descendance, mais l’exacerbation de ces défaillances, en toute décontraction, constitue la suprême négation de ce que l’on est en droit d’attendre de la presse, et plus spécialement encore de la presse soi-disant littéraire. Que s’est-il donc passé avec ce livre ? Premièrement il a été mal lu, ce qui est le cas de tous les livres pré-canonisés que l’on s’est précipité d’escorter dans les chapelles journaleuses où se déclament des «santo subito» attendrissants, et secondement il a été apprécié par les pisseurs de copie dans la mesure où il leur est apparu comme un ouvrage facile d’accès, sans doute excitant, peut-être même divertissant (2). Sous la plume de ces chroniqueurs surannés, le fait divers investi par Ivan Jablonka n’a fait que persévérer dans sa nature de fait divers, c’est-à-dire un événement subit qui s’insère dans une succession d’événements, un micro-fait qui finit par faire une masse de réalité fantasmagorique avec le reste des objets événementiels, et, ce faisant, les journalistes ont fait de ce livre un événement de la rentrée littéraire qui sera vite remplacé par d’autres livres une fois que cet automne de littérature éphémère aura enfin rendu son âme. Or le temps court de l’histoire événementielle n’est pas ce que Jablonka défend lorsqu’il enquête sur Laëtitia Perrais, assassinée dans de terribles circonstances pendant la nuit du 18 au 19 janvier 2011 entre Nantes et Pornic. Au-delà des apparences à la fois récréatives et sidérantes du fait divers, Jablonka, en historien conséquent, s’applique à circonscrire le fait social, en l’occurrence une histoire de la longue durée qui s’oppose à la brièveté illusionniste et répétitive d’une rubrique des chiens écrasés (cf. p. 9). Autrement dit Jablonka rejette la tyrannie de l’événement, avec sa temporalité succincte, périssable et approximative, au profit d’une histoire temporellement agrandie qui ne se laisse pas duper par les caprices et les coups de tête du temps court, que Braudel identifiait comme «la plus trompeuse des durées» (3).
Pourquoi diable cette lecture bâclée ou franchement insuffisante de la part de ceux qui sont a priori mandatés pour étudier scrupuleusement les livres ? Parce que presque tout journaliste littéraire de notre présente époque est un cancre protégé, un fainéant auto-satisfait qui ne sait pas lire (sauf les dossiers de presse rapidement élaborés par les éditeurs) et qui tue le temps sur le caillebottis d’une terrasse balnéaire ou dans les «after» des innombrables festivals littéraires, raouts du crétinisme où les élus du népotisme journalistique sont invités pour venir marmonner une banalité lors d’une table ronde de caniches modérés, un soupçon régaliens, et pour se goinfrer ensuite de petits fours labélisés. En les observant de loin et avec un petit effort de déduction, on les voit parader avec les auteurs de la grosse tendance, remuer la queue et attraper des pompons, se faire des accolades avec les most valuable players de la compétition pseudo-livresque, bougeant leur gras sur la piste de danse, claquant le verre Lalique et le couvert d’argent, lorgnant tantôt sur le décolleté de telle pute de trente ans qui sort un énième roman insipide, forcément cousine ou nièce d’un faste caniche habile en manigances, échangeant quelquefois un numéro de chambre pour s’assurer une prochaine transaction selon l’habitude des bons procédés (une fellation contre un article, un cunnilingus contre la promesse que tu transmettras mon manuscrit de gnome à ton éditeur proxénète, le coït n’étant pas envisageable pour ces experts de la lèche). La vulgarité morale de cette meute d’arriérés est si incalculable qu’elle dame le pion à nos constatations ordinaires et légèrement impertinentes. Dans les couloirs de l’édition et du journalisme littéraires français, tout, quasiment, n’est que stupre et fornication, au propre comme au figuré, et qui ne peut endosser les sinistres façons de cette maison close se condamne à la mendicité. De temps à autre, par fausse commisération ou par désir fallacieux de rédemption, cette mafia joue à imiter la générosité d’esprit, se drapant de toutes les vertus de l’univers, et c’est à cet instant précis qu’on la voit porter aux nues des livres qui sont au-dessus des lois de la justice positive parce qu’ils sont du côté des lois morales. En ce sens, une larme a failli tomber de notre œil à l’écoute et à la lecture de ces journalistes qui ont évoqué Laëtitia ou la fin des hommes et qui nous donnaient presque envie de croire qu’ils avaient toujours eu, en ce monde dans tous les autres, de la compassion pour des gamines comme Laëtitia Perrais. Pour eux, soyons honnêtes, Laëtitia Perrais n’aurait tout au plus été qu’une boniche dans leur appartement ou ce genre de femme exotique qui vient nettoyer l’étage de la rédaction.
En outre, au-delà de cette vulgarité morale se dessine évidemment une vulgarité de la connaissance, une cuistrerie antédiluvienne, une sorte de sottise épistémologique immense, et cela fait que non seulement ces chieurs d’encre ne pouvaient pas correctement lire Laëtitia ou la fin des hommes, dont ils auront éventuellement tiré un maigre bénéfice en revendant le service de presse chez Gibert Joseph, mais, en plus de cela, ils ne pouvaient pas avoir lu Braudel ou avoir eu ne serait-ce que la vague intuition que le travail de Jablonka exigeait un peu plus qu’un trivial compte-rendu qui n’est rédigé qu’en vue d’attirer le chaland, dans l’objectif avéré de vendre à la multitude ignorante les reliques de nouveau frémissantes du cadavre de Laëtitia, transformant ainsi Jablonka en une espèce de pigiste surdoué qui nous offrirait davantage de glauque et toujours moins d’examen rigoureux de la situation pénible qui s’est abattue sur la famille Perrais au début de l’année 2011. Fort heureusement, le livre d’Ivan Jablonka n’est pas une compilation malsaine de descriptions voyeuristes et de facilités enchaînées, il est même tout le contraire d’une exploration inquisitrice et mystifiante de l’affaire Perrais : c’est le livre d’un historien qui sait disparaître derrière son sujet et qui fait remonter à la surface non pas le corps démembré de Laëtitia, mais l’épaisseur de son existence et tout ce qu’elle peut nous apprendre sur la vie d’une jeune femme moderne broyée par une quantité obscène de dispositifs sociaux (à commencer par le traitement journalistique de son cas !). En même temps que ce renforcement du domaine existentiel de Laëtitia, Ivan Jablonka remet en perspective ces éléments du contemporain en les associant à des réflexions érudites (4), sérieusement menées dans le secteur des sciences sociales d’aujourd’hui et d’hier, en somme tout ce que ne saurait faire un journaliste et qu’il devrait pourtant avoir le goût de faire s’il était adéquatement recruté.
Le succès de ce livre est par conséquent embarrassant, non pas tant parce qu’il est d’ores et déjà beaucoup relayé en dépit du fait que son contenu n’ait rien de fondamentalement attirant en première instance, mais parce qu’il semble remarqué moins pour ses nobles intentions que pour l’aubaine qu’il représente vis-à-vis de ceux qui sont appâtés par l’odeur du sang et l’occasion de se payer une excursion à bas prix dans la France interlope, avec bien sûr toute la condescendance et la perverse curiosité que cela suppose. Ainsi, par le biais de diverses consultations des journaux et des radios, nous avons vu émerger une singulière parenté éditoriale entre le projet de Jablonka et celui, résolument grotesque, d’Anne-Sophie Martin, qui a publié chez Ring, deux jours après Laëtitia ou la fin des hommes, un document-fiction autour de l’affaire Dupont de Ligonnès, également située dans la région de Nantes (5). À vrai dire, pour les rapaces du journalisme idiot et les amateurs de coïncidences, l’affaire Dupont de Ligonnès, jadis, a pris opportunément le relais tragique de l’affaire Perrais, et sitôt le cadavre de Laëtitia entièrement reconstitué, les macchabées de la famille Dupont de Ligonnès sont devenus les nouveaux squelettes à ronger des journaux, des magazines, des télévisions et des publics passionnés par les viandes humaines martyrisées, constellation d’émotions carnivores que le livre d’Anne-Sophie Martin recycle en les saupoudrant de fumigènes plaisants. Il est évident que Jablonka ne se réclamera jamais des méthodes d’Anne-Sophie Martin et que son livre est largement supérieur aux racolages malavisés de la maison Ring, cependant, dans le champ lexical du journalisme littéraire, on ne voit guère de différence entre les deux livres, qui, au final, apparaissent sur un même piédestal de sensationnalisme aguicheur. Pour les lecteurs inattentifs de la presse imbécile, Jablonka et Martin sont indiscernables, et tous les deux participent désormais à la ruée des ventes, avec cette nuance déconcertante que l’ouvrage de Jablonka se retrouve en lice pour l’obtention des prix littéraires parmi les plus éminemment corrompus de l’intérieur et les plus férocement assujettis aux relations intéressées. Ce n’était pas vraiment le destin que l’on envisageait pour ce travail qui eût mérité une médiatisation plus discrète, plus retenue, et, surtout, une lecture plus adaptée.
L’historien à l’œuvre : le fait divers méthodiquement investi
La véritable intention d’Ivan Jablonka n’a pas été d’écrire une histoire à suspense ou un roman de gare maculé de tripes et de boyaux. Il s’agit d’abord de constituer une méthodologie pour transcender l’instantanéité du fait divers afin d’en extraire l’impensé, l’invisible et l’extension temporelle (cf. pp. 342-350). En tant que tel néanmoins, et la chose est déplorable, le fait divers est chaque fois susceptible de faire «diversion» pour reprendre la formule de Bourdieu (cf. p. 342). De cette manière il se mue en instrument soit pour dissimuler des faits plus décisifs que ce qu’il draine dans son répugnant sillage, ou, à l’inverse, soit pour exacerber des sujets qui tombent à pic et dont les sillons doivent être stratégiquement creusés. Si le fait divers n’est pas examiné comme un objet qui nous commande de pressentir le fait social derrière le fait sordide, s’il n’est pas convenablement approfondi à l’instar d’une matière historique propre, alors il n’est guère plus qu’une histoire attrayante au milieu d’un réseau de «human interest stories» comme le diraient les sociologues de l’école de Chicago (cf. p. 344), c’est-à-dire une aventure dont la nature est certes bouleversante mais dont l’effet principal consiste principalement à fabriquer une identification spontanée avec les victimes. En cela, l’enquête historique doit se donner la peine de pulvériser la «baudruche du sensationnel» (p. 348). Pour y parvenir, Jablonka propose trois étapes méthodiques et toutes sont immanquablement appliquées à son appréciation de l’affaire Perrais (cf. p. 349) : premièrement, il faut se mettre dans les dispositions de «comprendre l’affaire», ce qui implique d’en découvrir les plus infimes ramifications, d’en révéler certains abîmes et certains non-dits, en l’occurrence il est nécessaire d’aller plus loin que les explications sommaires qui n’ont fait que décrire la situation de l’extérieur et qui ont parfois émis des jugements hâtifs contraires à la déontologie de la démarche historienne; deuxièmement, il est important de savoir «ouvrir l’affaire», de la voir avec un spectre oculaire beaucoup plus large qui nous permettra de ne pas la condamner à un territoire et à des individus surdéterminés; troisièmement, enfin, il est indispensable de «dissiper l’affaire», ce qui signifie qu’il faut apprendre à ne pas seulement se concentrer sur le terminus horrible des victimes, mais plutôt à se mettre en capacité de restituer aux victimes la densité de leurs antécédents d’existence. En réunissant ces trois conditions, nous pouvons faire du fait divers un fait démocratique, à savoir une histoire objectivement augmentée qui nous parle des personnes humaines et de la société, à l’inverse d’une histoire subjectivement exploitée qui articule des individus réifiés avec une fiction sociale anxiogène. En racontant le fait divers en suivant les façons d’une enquête historique, on en fait un objet d’intérêt général, un service rendu au public (cf. p. 350).
Ces précautions longuement précisées par Ivan Jablonka rappellent les devoirs de l’historien tels qu’ils pouvaient déjà être formulés autrefois par Marc Bloch (6). Très critique envers les dominants aux jugements péremptoires et guidés finalement par des instincts tout naturels, Bloch soulignait l’erreur souvent commise d’ériger en figures absolues des critères hautement relatifs dès lors qu’il fallait déposer un caractère prétendument définitif au milieu des actions d’un individu, d’une corporation ou d’une génération. Croire à l’inflexibilité d’un caractère autant qu’à l’ekphrasis des actes individuels ou collectifs, c’est s’autoriser à prononcer l’éloge ou à jeter le blâme sur telle ou telle personnalité du passé, et, pour emprunter l’exemple judicieux de Bloch, c’est être robespierriste ou anti-robespierriste pour des raisons qui ne sont nullement objectives, en conséquence de quoi ce n’est pas là nous renseigner sur l’homme que fut Robespierre. Heureusement pour lui, l’historien consciencieux se démarque de ces postures surplombantes parce que sa méthode de travail le situe entre l’arrogance présumée du savant et l’aberrante supériorité morale d’un juge qui règnerait illégitimement sur son tribunal. L’historien se positionne à distance très respectable de ces mauvaises impulsions, préservé par la volonté de faire revivre l’histoire et de comprendre le passé dans les stricts cheminements de ses méthodologies. À la fois prudent dans ses progressions et lucide quant à ses limites, l’historien ne vise que l’objectivité, toutefois, dans le même temps, il n’ignore pas qu’il demeure un interprète forcément subjectif. En fin de compte, c’est sa volonté implacable de comprendre le passé en profondeur qui légitime l’historien à exprimer des jugements, et ces jugements sont d’autant plus respectables qu’ils ne s’inscrivent pas dans un esprit d’éternité. En effet, s’il est une chose que l’historien ne peut contourner, c’est la certitude que ses interprétations ne sont pas des vérités immuables et qu’elles sont vouées à être complétées, discutées, voire invalidées. Par ailleurs, Hannah Arendt ajouterait que tout en sachant cela, l’historien doit savoir également qu’il n’a «pas le droit de porter atteinte à la matière factuelle» (7), car les faits ne sont ni les opinions ni les interprétations et que, de ce point de vue, ils ne peuvent se ré-agencer selon le bon vouloir de celui qui a la charge d’écrire l’histoire. On évite ainsi les attitudes vénéneuses de manipulation de l’histoire, en quoi il ne fait aucun doute que Arendt, lorsqu’elle nous alerte sur la qualité irrévocable de certains faits, anticipe les dérives du négationnisme concernant le génocide perpétré par les nazis.
Le respect de toutes ces recommandations de méthode fait que Jablonka redistribue les cartes de l’affaire Perrais avec une neutralité exemplaire. Il est bon historien, dirait Fénelon, en cela qu’il ne paraît être «d’aucun temps ni d’aucun pays» et qu’il nous laisse douter de ce qui est douteux, au même titre qu’il nous fournit tous les outils nécessaires à la compréhension, sans s’étaler inutilement en longues dissertations superflues (8). Il y a du reste une alternance entre le travail de l’historien et le métier d’homme dans cet ouvrage : les chapitres abordent tour à tour l’affaire proprement dite, avec une impartialité caractéristique, puis la manière dont Ivan Jablonka a rencontré les différents protagonistes de l’affaire (Jessica, la sœur jumelle de Laëtitia, ses amis, les policiers, les juristes, etc.), avec ses confessions affectives et ses impressions moins maîtrisées. Cette alternance accouche par exemple d’un chapitre assez maladroit, intitulé Laëtitia, c’est moi (pp. 357-9), dans lequel l’auteur se perd en considérations lyriques très accessoires. Outre cela, Jablonka n’est pas allé visiter le meurtrier de Laëtitia, Tony Meilhon, parce que celui-ci n’a jamais eu la volonté d’orienter les enquêteurs vers la vérité. Tout au contraire, Meilhon n’a cessé d’incarner un axe d’affabulation et d’infatuation (cf. pp. 308-9), si bien que lui rendre visite eût été probablement contre-productif et aurait retardé la bonne marche du livre. Sur France Culture, Jablonka s’est justifié en disant qu’il s’agissait sûrement d’une faute de méthode, mais sûrement pas d’une faute morale (9). C’est ici que se révèle l’autre véritable intention de l’historien : écrire un livre sur Laëtitia davantage que sur la Laëtitia Perrais du fait divers, lui redonner une dignité et une existence par-delà sa mort atroce qui aura paradoxalement constitué, pour la plupart d’entre nous, sa naissance, son surgissement fracassant dans le discours public. Vulgairement racontée d’un journal à un autre, politiquement récupérée par l’appareil mastodonte de l’État, Laëtitia Perrais a largement vérifié la formule de Sartre lorsque le philosophe affirme que celui qui est mort est «en proie aux vivants» (10). Bien qu’il soit possible de penser que la mort de Laëtitia n’a été que l’achèvement d’un processus de déterminations continues qui devait pour ainsi dire la conduire dans le giron de Meilhon, il n’empêche que sa vie ne peut être réduite à des catégories aussi fermées. Laëtitia n’a pas seulement été une jeune femme socialement dominée, corvéable à merci et soumise à la violence symbolique des évaluations juridico-psychologiques (cf. p. 64) (11), elle a aussi été un pôle de rébellion, une puissance de génération qui précède l’acte de corruption, une existence forcément antérieure à une essence trop facilement ratifiée.
Laëtitia et les hommes finis
Le sous-titre du livre (ou la fin des hommes) ne suscite aucune ambiguïté quant à son interprétation : d’une part la disparition épouvantable de Laëtitia souligne ô combien nous sommes entrés dans une «ère des ténèbres» (12), à quel point l’humanité se nie avec toujours plus de conviction et de bêtise crasse, et d’autre part il met en évidence l’agonie progressive d’un patriarcat qui ne parvient plus à convaincre, dont le modèle a semble-t-il trop vécu (13). Tout au long de sa vie difficile, Laëtitia s’est heurtée à la «griffe masculine» (p. 255) et elle a été prodigieusement dépendante de la législation des hommes (cf. p. 310). Elle a cependant osé dire «non» à la loi de Tony Meilhon, «non» au décret de la petite frappe qui exige que son pénis soit englouti par la bouche de la femme, et elle en a payé le prix de sa vie (cf. pp. 320-1). Lors de l’autopsie, la présence du seul liquide prostatique sur Laëtitia a prouvé l’absence d’éjaculation de son assassin, aussi a-t-on pu expliquer la possible frustration de ce dernier et la nature fondamentalement misogyne de son crime. Pour Meilhon, en effet, Laëtitia n’était qu’une femme à soumettre, un «dossier» parmi tant d’autres, une «salope» incidemment rencontrée dont il fallait soutirer le meilleur profit (cf. pp. 305-312).
La violence réelle de cet épisode est du reste parfaitement assortie à la violence symbolique de la récupération politique du meurtre : «l’onde de choc» (p. 81) est énorme, et si l’opportunisme de la gouvernance de Nicolas Sarkozy est patent, cela traduit aussi la satisfaction de certaines attentes populaires (cf. p. 82). Dans les termes de Jablonka, on pourrait même aller jusqu’à dire que Laëtitia fut «inventée» par Sarkozy (cf. p. 119) et qu’elle a fini par «[prêter] son corps à une démocratie» (p. 264). Son démembrement physique s’est peu à peu insidieusement transformé en un démembrement métaphysique – elle fut mutilée en elle-même et au-delà d’elle-même, à travers les bavardages politiciens, les allocutions retentissantes et l’accumulation des narrations journalistiques affligeantes, tout ceci étant rythmé par une course au pouvoir et à l’exclusivité. Alors qu’elle était morte, on fit de Laëtitia un bout de venaison que l’on se dispute à la curée. Tous les aspects de ce qu’elle avait réellement pu être durant sa vie furent occultés par l’expansion toujours plus indécente de sa mort. Par conséquent, le corps introuvable de Laëtitia était déjà en train de devenir pour l’historien le révélateur d’une double préoccupation sociale : d’abord le symbole général de la souffrance endurée par les individus les plus vulnérables, ensuite le symbole particulier de la violence subie par les femmes dans la France du XXIe siècle (14).
Si l’affaire Perrais a médiatiquement tenu pendant cinq semaines consécutives, c’est sans doute parce que le corps a été tardivement retrouvé par les policiers, mais aussi parce que le deuil de la famille fut nationalisé, comme si l’absence provisoire de sépulture, associée au renversement de l’intimité familiale en extimité, favorisa la construction d’une espèce de cénotaphe de Laëtitia (cf. pp. 89-97). Cette période insupportable durant laquelle le corps fut recueilli en deux temps (la tête, les jambes et les bras le 1er février 2011, le buste le 9 avril 2011 – cf. pp. 158-167 et 275-9) nous présente une démonstration de force de la société patriarcale à plusieurs niveaux. Elle met tout d’abord en exergue le comportement très autoritaire du président Sarkozy, dont les déclarations calculées provoquent un scandale dans les tribunaux de la France entière, spécifiquement dans la région nantaise. Elle met aussi dans la lumière le père d’accueil de Laëtitia et de sa sœur Jessica, Gilles Patron, qui bombe le torse devant les caméras, réclamant justice et fermeté par monts et par vaux. Son allure est tellement impérieuse que Jablonka évoque un «axe Patron-Sarkozy» (cf. 132-9), les deux hommes formant un binôme phallocrate apparemment indestructible. Par ailleurs, Gilles Patron occupe tant d’espace qu’il en vient à éliminer l’existence du père biologique de Laëtitia (Franck Perrais). On ne s’intéresse pas vraiment à Franck Perrais parce que son passé judiciaire est lourd et parce qu’il n’est pas à l’aise avec le langage, aussi n’est-il pas un bon client pour la télévision et les radios (15). Qui plus est, lors des marches blanches qui succèdent à la disparition de Laëtitia, on repère la famille Patron aux premières loges et la famille Perrais perdue dans la queue de la foule (16). Enfin, au registre de ce patriarcat tonitruant, il ne faut pas omettre de citer Tony Meilhon, dont l’attitude a constamment découvert un homme odieusement vaniteux et duplice, capable d’attirer les femmes dans ses pièges immondes.
Cette chaîne patriarcale dévoile selon Jablonka trois injustices subies par Laëtitia (cf. p. 146) : une enfance excessivement violente (un père qui violait sa mère, un père de substitution qui violait sa sœur et qui l’a probablement touchée), une mort effroyable (cf. pp. 224-6) et la métamorphose de sa vie en fait divers. Conformément à cela, Jablonka déduit trois types de viol : un viol intrafamilial (son père qui violait sa mère et qui pouvait la menacer avec une arme pour la forcer à consentir aux injonctions génitales), un viol semi-incestueux (Gilles Patron qui prétendait mener une histoire passionnelle avec Jessica), un viol extrafamilial (Meilhon qui l’assassine parce qu’elle n’est vraisemblablement pas allée au bout de la fellation).
On comprend aisément que cette agglomération de calamités a pu exciter les esprits médiocres et fasciner les journalistes avides de sensations fortes. Au rebours de ces documents terrifiants, que Jablonka n’a pas niés du reste, l’historien a voulu rendre à Laëtitia le temps long de sa vie, fût-elle, cette vie, écourtée par un homme infâme. Au milieu des tristesses et des infortunes de Laëtitia, Jablonka a guetté la joie, l’exubérance de la vie, ne serait-ce déjà que parce que Laëtitia, en latin, renvoie à la joie (17). Et pour rendre à Laëtitia son épaisseur existentielle par-delà ses épreuves, il a fallu se montrer exhaustif et patient. Pour ce faire, Ivan Jablonka n’a négligé aucune matière, tantôt développant la description du quotidien grâce aux témoignages variés de Jessica et des proches de Laëtitia, tantôt spéculant sur l’activité virtuelle de Laëtitia en consultant son compte Facebook (cf. pp. 183-192). Encore une fois, la démarche n’est pas systématiquement adroite, notamment lorsque Jablonka justifie de manière démagogique l’orthographe défectueuse de la jeune fille, mais elle a le mérite de se confronter à une collection impressionnante de sources. Il en résulte par exemple un portrait de Laëtitia (cf. pp. 168-172), qui oscille entre une pudeur de bon aloi et des enthousiasmes un peu ridicules. Ceci étant, malgré les mérites et les quelques démérites de cet ouvrage, Ivan Jablonka parvient à donner de la voix à Laëtitia, à lui donner des mots qui compensent la solitude verbale de son enfance, peuplée de silences accablants (cf. p. 46-51), tel un Jean Giono qui replaça Gaston Dominici sur le siège de la dignité en insistant sur le fait que cet homme, dominé par le vocabulaire de la justice et de tout un monde qui souhaitait le voir vaincu, ne pouvait pas participer à la guerre qu’on lui faisait, ne pouvait pas résister aux assauts sémantiques avec ses pauvres dizaines de mots à lui (18). À sa façon, l’affaire Perrais est une sorte d’affaire Dominici inversée : ce n’est pas tant que Laëtitia n’a pu s’exprimer durant sa vie, mais le peu de mots qu’elle avait, le peu de richesse verbale qui était la sienne, on les lui refusait fréquemment et sa mort n’a fait que la priver davantage de sa parole, du moins jusqu’à ce que ce livre la réintègre comme une jeune femme sachant questionner et répondre, écouter et parler, trop obéir et commander quelquefois.
Notes
(1) Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes (Éditions du Seuil, coll. La Librairie du XXIe siècle, 2016).
(2) Par conséquent, si le livre venait à être primé plusieurs fois (il a déjà reçu le prix littéraire du journal Le Monde), il le serait moins pour ses qualités réelles que pour ses qualités empruntées, et il ne serait lu que partiellement, pour de très mauvaises raisons, probablement par des lecteurs qui prennent autant de plaisir à s’enthousiasmer du dernier Laurent Obertone que de la dernière recette surgelée du rayon Monoprix Gourmet.
(3) Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire (1969).
(4) Une bibliographie est d’ailleurs disponible en fin d’ouvrage. Les titres et références cités sont tout à fait pertinents, à l’exception de quelques présences parasites comme Jérôme Garcin, Cécile Coulon et Edwy Plenel.
(5) Anne-Sophie Martin, Le disparu (Éditions Ring, 2016).
(6) Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1949).
(7) Hannah Arendt, La crise de la culture (1961).
(8) Fénelon, Lettre à l’Académie VIII. Projet d’un traité sur l’histoire (1714).
(9) France Culture, émission La Grande Table du 29 août 2016.
(10) Jean-Paul Sartre, L’être et le néant (1943).
(11) Jablonka avoue d’ailleurs qu’elle a pu également être soumise à sa violence à lui, en l’occurrence la violence de l’historien-sociologue qui vient se préoccuper d’une jeune fille assassinée avec toute sa panoplie conceptuelle (cf. p. 336).
(12) Nous reprenons ici l’expression de Michel Terestchenko (cf. L’ère des ténèbres, Éditions Le Bord de l’Eau, coll. La bibliothèque du Mauss, 2015).
(13) France Culture, op. cit.
(14) Ibid.
(15) Quant à la mère, Sylvie Larcher, elle a globalement toujours été diminuée psychiquement. Déjà molestée par un compagnon qui la violait et qui buvait abondamment, elle fit une dépression et ses filles durent être «placées» (Perrais était de toute façon en prison à cause de ses multiples actes de violence, ainsi n’aurait-il pas pu se soucier de ses filles, faute déjà d’en avoir le droit).
(16) Franck Perrais, par la suite, a pu se rétablir dans une certaine dignité lorsque Gilles Patron a été écroué pour viol. En effet, il a été juridiquement établi que Gilles Patron avait eu des relations sexuelles avec les enfants dont il avait professionnellement la charge (Jessica et Laëtitia en furent victimes à des degrés divers) ! Ce détail sordide révèle a posteriori que Patron avait le profil typique du prédateur sexuel : il profitait de ses mandats officiels auprès des enfants fragilisés par la vie pour les soumettre à son infâme loi.
(17) Ceci est d’emblée posé par l’épigraphe du livre : «Laetitia est hominis transitio a minore ad majorem perfectionem. La joie est le passage de l'homme d’une moindre perfection à une plus grande», Spinoza, L’Éthique.
(18) Jean Giono, Notes sur l’affaire Dominici (1955).


























































 Imprimer
Imprimer