« Analyse spectrale de la France de Renaud Camus | Page d'accueil | Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier »
13/03/2015
La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos
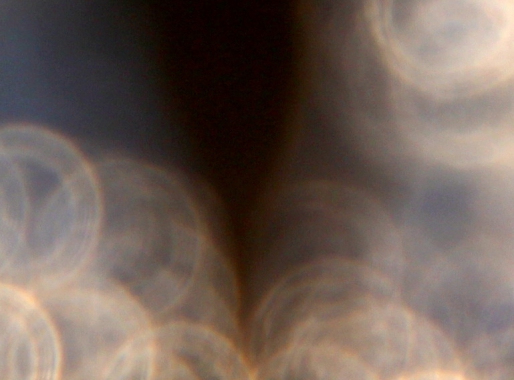
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone.«En somme, j'ai essayé de faire le livre que Drumont lui-même eût fait à l'intention des jeunes Français tombés comme de la lune en ce monde et grandis depuis 1914, c'est-à-dire entre deux cimetières. [...] J'ai envie de l'intituler : Au bord des prochains charniers [...].»
Correspondance inédite. Lettres retrouvées (Plon, 1983), à Louis Brun, juillet 1930, p. 193
 Acheter La Grande Peur des bien-pensants (version poche) sur Amazon.
Acheter La Grande Peur des bien-pensants (version poche) sur Amazon.La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos, que je continue de lire, l'ayant décidément lu trop jeune, après son premier roman, Sous le soleil de Satan, en 1988, et que n'importe lequel de ces innombrables radoteurs que l'on presse de questions banales sur les plateaux de télévision, en leur demandant de lâcher leur parole tiède comme un pet discret, devrait à tout prix relire ou plutôt : lire, pour se pénétrer de grand style, de colère, de littérature et de politique, de vie, ne cesse de m'étonner par la qualité de sa rage, la tessiture si particulière de son honneur blessé, son secret désespoir de gamin trahi, dont le vieux rêve de grandeur a été foulé aux pieds par les grands comme disent les gamins, mais pas par les grands hommes oh non, puisqu'il n'y en a plus et que Drumont lui-même, très probablement, n'a pas été un grand homme, n'en déplaise à Georges Bernanos. Édouard Drumont que l'exécrateur professionnel Laurent Tailhade, dans ses Imbéciles et gredins, qualifie de «Petit employé de l'Hôtel de Ville en 1867», ayant «gardé la crasse insaponifiable des bureaux [et qui] exerce l'imposture historique et la provocation à l'homicide, pour un sou par jour, au grand contentement des béates de province et des curés inquisitifs», auquel il donne, dans ses Pamphlets, de l'«entrepreneur de mensonges, fauteur d'assassinats et pasteur de solécismes», tandis que Georges Darien, dans ses Pharisiens, affirme, lui, que Drumont, «au moral et au physique», est «le plus grandiose échantillon de crétinisme illuminé qu'il fût possible de rencontrer». Je ne sais rien des «béates de province», mais il y a fort à parier que les «curés inquisitifs» qu'évoque Tailhade, détestaient, eux, la prose de Drumont qui n'hésita jamais à stigmatiser, comme il se doit d'ailleurs et pour le plus grand plaisir de Bernanos qui, contre le prêtre médiocre, a écrit des pages terribles, y compris dans ce livre (1), le parti des dévots et des calotins, toujours avide de claques sonores et de coups de pied au cul, qu'il a large et mou, comme sa théologie. Peu nous importe, en fin de compte, ce que fut Drumont, s'il fut petit ou grand, s'il fut petit et grand, comme tout homme ou presque, puisque La Grande Peur des bien-pensants, un texte qu'il serait tout simplement inimaginable de penser pouvoir être publié (ou même écrit !) à notre époque, est un grand texte de Georges Bernanos et, plus précisément, un grand roman, un livre qu'il convient de lire comme un roman, comme ne s'y trompa point le fulgurant Léon Daudet qui écrivit, dans L'Action française du 28 avril 1931, qu'il s'agissait d'un «chef-d’œuvre de style et de mouvement égal à Sous le soleil de Satan et qui aura au moins le même succès», affirmant en outre qu'il ne saurait trop recommander à ses lecteurs «des pages d'une éloquence inouïe et d'une bouleversante sincérité» (p. 1389). Du reste, c'est encore Georges Bernanos lui-même qui, en évoquant La France juive paru en 1886, critique le plus intelligemment son propre ouvrage : «Livre comparable à un très petit nombre, livre presque unique par on ne sait quel grondement intérieur, perceptible à mesure, de chapitre en chapitre, et qui, en dépit des sourires sceptiques ou de l'ennui, finit par résonner dans notre propre poitrine, en arrache un long soupir. Livre dont les véritables dimensions n'apparaissent pas d'abord, où l'on entre de plain-pied sans méfiance, comme dans une église obscure, jusqu'à ce qu'un mot prononcé à voix haute, par mégarde, fasse mugir les voûtes baignées d'ombre, se prolonge en tonnerre sous les arceaux invisibles. Livre dont la prodigieuse tristesse, malgré les cris de colère ou les défis, prend au dépourvu l'homme le plus vil, reste une sorte d'énigme pour tous» (p. 163).
 Je pourrais en effet citer bien des passages de ce livre romanesque que l'on dirait écrit d'un seul jet et où se montre un immense écrivain aux prises avec un si redoutable sujet, puisqu'il est intimement lié au jeune enfant devenu homme, jeune enfant auquel le père faisait quotidiennement la lecture de La Libre Parole : évoquer le maître, celui qui a formé votre esprit, l'évoquer mais aussi le servir, le saluer, le remercier en disant tout ce qu'il vous a apporté, puis transmettre ce flambeau à d'autres jeunes hommes un peu téméraires, un peu dignes, capables de goûter la geste d'hommes devenus poussière, et qui pourtant vivaient dangereusement à un siècle à peine de leur confort béat. Des années d'étude, un métier à la clé permettant de mettre quelques billes en sécurité, une gentille petite épouse, un gentil mari, une maîtresse discrète, un amant point trop passionné, la retraite en vue, puis l'ignoble vieillesse, mais, grâce aux lois modernes, désormais sédativable en cas de trop fortes douleurs, nous voici bien loin des fulgurances destinales d'un marquis de Morès, d'un Drumont même, qui mourut seul et oublié ! Quoi qu'il en soit, un tel mouvement, de piété au sens premier du terme, est aujourd'hui inimaginable, inconcevable, choquant même, car il faudrait imaginer des hommes à la fois humbles et orgueilleux, qui plus est doués de talent, rendant la monnaie de la pièce, du talent qu'ils ont reçu. Comment les nains contemporains pourraient-ils remercier celles et ceux qui ne les ont même pas influencés, puisqu'ils ne les ont tout simplement pas lus, et qu'ils ne savent rien, strictement rien, de ces noms pulvérulents, si ce n'est, pour les plus savants d'entre eux, que Drumont sonne un peu trop méchamment comme un ennemi acharné des Juifs ? Comment les écrivants actuels pourraient-ils imaginer devoir s'abaisser jusqu'à rendre un hommage à celles et ceux dont ils s'estiment les élèves, eux qui ne croient plus en rien, et surtout pas aux vertus, réputés réactionnaires, de la transmission, de l'héritage et, je le disais, de la piété ? Nous avons vu, récemment, le ridicule Yannick Haenel évoquant Jan Karski, et son livre fut une imposture, historique et littéraire.
Je pourrais en effet citer bien des passages de ce livre romanesque que l'on dirait écrit d'un seul jet et où se montre un immense écrivain aux prises avec un si redoutable sujet, puisqu'il est intimement lié au jeune enfant devenu homme, jeune enfant auquel le père faisait quotidiennement la lecture de La Libre Parole : évoquer le maître, celui qui a formé votre esprit, l'évoquer mais aussi le servir, le saluer, le remercier en disant tout ce qu'il vous a apporté, puis transmettre ce flambeau à d'autres jeunes hommes un peu téméraires, un peu dignes, capables de goûter la geste d'hommes devenus poussière, et qui pourtant vivaient dangereusement à un siècle à peine de leur confort béat. Des années d'étude, un métier à la clé permettant de mettre quelques billes en sécurité, une gentille petite épouse, un gentil mari, une maîtresse discrète, un amant point trop passionné, la retraite en vue, puis l'ignoble vieillesse, mais, grâce aux lois modernes, désormais sédativable en cas de trop fortes douleurs, nous voici bien loin des fulgurances destinales d'un marquis de Morès, d'un Drumont même, qui mourut seul et oublié ! Quoi qu'il en soit, un tel mouvement, de piété au sens premier du terme, est aujourd'hui inimaginable, inconcevable, choquant même, car il faudrait imaginer des hommes à la fois humbles et orgueilleux, qui plus est doués de talent, rendant la monnaie de la pièce, du talent qu'ils ont reçu. Comment les nains contemporains pourraient-ils remercier celles et ceux qui ne les ont même pas influencés, puisqu'ils ne les ont tout simplement pas lus, et qu'ils ne savent rien, strictement rien, de ces noms pulvérulents, si ce n'est, pour les plus savants d'entre eux, que Drumont sonne un peu trop méchamment comme un ennemi acharné des Juifs ? Comment les écrivants actuels pourraient-ils imaginer devoir s'abaisser jusqu'à rendre un hommage à celles et ceux dont ils s'estiment les élèves, eux qui ne croient plus en rien, et surtout pas aux vertus, réputés réactionnaires, de la transmission, de l'héritage et, je le disais, de la piété ? Nous avons vu, récemment, le ridicule Yannick Haenel évoquant Jan Karski, et son livre fut une imposture, historique et littéraire.Voici un de ces passages frappants, parmi tant d'autres, où peut se lire, je crois, ce qui n'existe plus dans les livres de langue française, ou bien à l'état d'avorton, de chimère hâtivement composée, dernière trace d'un organisme autrefois grand, puissant, vivant, dangereux, que Bernanos, quelques autres valeureux, n'hésitèrent pas à enfourcher pour de furieuses cavalcades à la brune de la France qu'ils avaient connue et aimée, du monde, tout simplement : «Mais celui que nous verrons aller si loin dans l'analyse d'une certaine dégradation profonde, à peine visible à d'autres yeux que les siens, croit encore que le mal ne s'impose que par la force, qu'une majorité de Français n'endurent le joug que par lâcheté, qu'il y a dans ce pays, enfin, selon le mot célèbre de Guizot, «plus de servilité que de servitude». «La Révolution, écrit-il, a tellement avili ces hommes jadis si fiers, si jaloux de leurs droits, si prompts à réclamer ce qui leur était dû, qu'ils n'osent même plus demander à vérifier le texte en vertu duquel on les frappe. Ils ne regardent pas plus les pièces de procédure que le musulman ne regarde un firman, ils voient un griffonnage de greffier, et se prosternent dans la poussière.» Sans doute, ils n'osent plus. Mais ils ne voudraient plus oser. Ils ne redoutent qu'un vrai maître, capable de vouloir, d'entreprendre, un maître au cerveau et au cœur d'homme, un maître humain. Quiconque entreprend de les libérer, leur paraît devoir être un jour ce maître-là, et ils se défendent de lui avec une haine sournoise, poussent tout doucement le héros dans les filets de la Loi, se pressent pour le regarder manger par l'idole aveugle qui, faisant elle-même le bien et le mal, les dispense d'avoir une âme, les décharge de ce fardeau» (p. 127).
Il y a dans ces lignes une tristesse véritable, une saturation de tristesse écrit Bernanos (cf. p. 80) et aussi un désespoir profond, ce que l'écrivain appellera d'une expression, magnifique, la «somme des déceptions d'un cœur français» (p. 123). C'est, selon Bernanos, la double marque qui caractérise les pages les plus belles et puissantes que Drumont a écrites. Ainsi, l'écrivain dont François Mauriac, dans Les Paroles restent, affirme qu'il est lui-même un «être irrité, désespéré quelquefois et d'une extrême injustice», ne cesse de répéter que Drumont est non seulement un homme triste mais, beaucoup plus intéressant, un homme désespéré, «le maître du désespoir lucide» (p. 239) ou plutôt, dont le désespoir est le matériau le plus essentiel de l’œuvre, son ciment le plus solide. Georges Bernanos va même, dès les toutes premières pages de son livre, jusqu'à dissiper toute forme de suspens pourrions-nous dire, en nous livrant ce qu'il suppose être la clé de la pensée et même de la vie de son cher vieux maître, formule qui ne peut que nous rappeler tel jugement fulgurant du romancier sur l'un des personnages de Sous le soleil de Satan : «Le signe était déjà sur lui d'une mort presque désespérée, au moins consommée dans l'humiliation et le silence, face à Dieu seul, d'une mort que Dieu seul voit jusqu'au fond» (p. 48). Ce désespoir est encore un mot imparfait, fallacieux, car il ne désigne qu'assez imprécisément l'espèce de sérénité, plus dure qu'un diamant, de l'homme qui a mesuré le risque, estimé ses chances et, d'un seul bond de sa volonté formidable, s'est jeté dans la mêlée, s'est jeté en avant (cette expression revient plusieurs fois, notamment pp. 126 et 132), comme un vassal obéit au moindre geste de son suzerain (cf. p. 132), le précède, même, d'une attente bienveillante et efficace. Il est ainsi frappant de constater quels sont les termes que l'auteur utilise lorsque, dans ses lettres, il évoque l'écriture de son livre : «J'espère bien avoir terminé Drumont le 1er juillet. Je crois que vous serez content, je m'y engage à fond, tout ou rien», écrit-il ainsi à Grasset le 23 avril 1929 (Correspondance inédite 1904-1934. Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 356).
Laissons ici la parole à Drumont, comme tant de fois Bernanos la lui laisse dans son livre : «J'étais guidé uniquement par la haine de l'oppression qui fait le fond de ma nature. L'oppression me rend malade physiquement. Obligé, pendant de longues années, pour subvenir à mes charges de famille, de refouler ce que je pensais j'avais fini par attraper des crampes d'estomac, une anorexie qui me contractait la gorge au moment du repas. Cette douleur a complètement disparu du jour où j'ai pu exprimer librement ma manière de voir, proférer mon verbe (pro, en avant, ferre, porter), ce que je fis dans La France juive et dans La Fin d'un monde» (pp. 162-3). Ces lignes sont émouvantes sinon magnifiques et, du moins je le crois, pourraient être appliquées à l'exemple même de Georges Bernanos, tout pressé de délivrer son furieux rêve qui a grossi dans la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale, et qui lui aussi, bien plus d'une fois, a dû jouer sa vie sur un raidissement de toute sa volonté, commandant au corps, rétif, de s'élancer dans le paysage défoncé par les obus et qui lui aussi, nous le savons par de nombreux témoignages, fut bien près, plus d'une fois encore, d'écouter le chant des sirènes du désespoir, qui sont sans pitié pour l'imprudent. C'est un échec qui a attiré Georges Bernanos et, plus qu'un échec, l'aura mystérieuse dont le désespoir enveloppe un destin exceptionnel, mais obscur : «Non, il n'attendra pas le bon plaisir des professeurs, l'homme mort le nez au mur, par un glacial soir d'hiver, seul, absolument seul, las de jouer la comédie de la résignation, d'une résignation impuissante à détendre son dur vieux cœur crispé. Il était oublié et ruiné, deux formes à peine différentes d'un même oubli; il était retombé dans le silence et la pauvreté, avec cette grave rumeur de la rue à son oreille, la rue désormais vide d'amis, vide d'ennemis, la rue d'où rien ne monte, d'où rien ne montera plus» (p. 54). Je ne sais si Bernanos, à dessein, a exagéré la solitude d'un homme qui a toujours été entouré d'hommes, mais c'est dans cette solitude en tout cas que l'écrivain doit s'enfoncer s'il désire écrire un livre qui ne mente pas, quelles que soient d'ailleurs les imprécisions historiques que les petites professeurs à lunettes rondes n'auront pas manqué de lui reprocher. C'est que Georges Bernanos est un être qu'ils ne comprennent absolument pas : un écrivain, pas un historien.
Édouard Drumont, comme d'ailleurs l'aventurier Morès très bellement évoqué (cf. pp. 211 ou 252), n'avait donc rien à perdre et il le savait, il connaissait en somme le prix de sa liberté : «Le cher Bloy, remarque à juste raison Bernanos, a payé beaucoup plus cher d'admirables mais au fond de plus inoffensives invectives» (p. 162). Le prix de la liberté de Drumont, si énorme qu'elle ne peut qu'effrayer nos pâles pisseurs de copie et les petits professeurs d'université, «gidiens, gidettes et gidoyères, oui mes belles» (p. 159. Gide est encore moqué à la page 213) qui, prudemment, d'une note, condamneront les propos et les idées de cette force de la nature qu'était un homme n'ayant jamais craint de défendre son honneur les armes à la main, s'explique par la gravité de la décision qu'il a prise une fois pour toute : «Ceci dit, écoutez-moi bien : tout homme qui est décidé à mourir peut agir sur les événements. Derrière tous les événements il y a un homme qui a décidé de mourir» (p. 160). Georges Bernanos nous rappelle cette évidence, tellement oubliée de nos jours par nos petites houris germanopratines qu'elle ressemble à une monstruosité : un texte puissant est, toujours, un texte qui s'est affranchi de ses contraintes, matérielles aussi bien qu'artistiques, intellectuelles, formelles, spirituelles. Un grand texte est un texte qui ne se rend jamais, qui, le liriez-vous pour la centième fois, vous donne l'impression qu'il se bat, qu'il ne s'arrêtera jamais de se battre, que son écriture est l'image même de sa lutte. Un grand texte est un texte qui a tout prix, fût-ce au prix de sa propre disparition, lutte contre la persécution : «Ménager de son bien, à la manière d'un paysan, avaricieux sinon avare, chaque page bien venue est grosse du risque d'un procès, menace son petit avoir. Elle porte aussi la chance d'un duel. Il ne pose la plume que lorsqu'il sent cette double menace braquée sur sa poitrine et le tiroir de la commode où il tient rangés ses quatre sous. Alors seulement il va prendre l'air du soir dans son jardin, piétine en rêvant la pelouse, la tête un peu chaude» (p. 158). «Qui dispose de sa mort, résume Georges Bernanos, peut tenir n'importe quel enjeu» (p. 150).
Cette colère, ce désespoir, même, cette «haine de l'oppression» sont non seulement la marque, ou plutôt, la vocation, ce mot tant répété par l'auteur (cf. p. 149), de Drumont mais aussi de celui qui le commente. Multiples sont les raisons, y compris dues à des motifs psychologiques qui ne peuvent pas vraiment nous intéresser, qui expliquent le désespoir de ces deux auteurs. J'en vois une qui me semble essentielle et qui, au fil des années, est allée grandissant, jusqu'à atteindre, de nos jours, les dimensions d'un cirque planétaire. Drumont et Bernanos se sont révoltés, le désespoir chevillé au corps et à l'âme mais bien décidés à tenter coûte que coûte le coup de force, parce qu'ils vivaient dans une société qui avait érigé l'imposture et le mensonge en vertus souveraines, parce qu'ils estimaient tous deux qu'ils barraient l'Histoire, mais qu'ils la barraient pour rien (cf. p. 59). Drumont écrit ainsi : «Lorsqu'on étudiera de près les années qui viennent de s'écouler, on s'apercevra que ce qui les caractérise, c'est la fiction, l'imposture, le mensonge général, l'étalage verbal et scripturaire de sentiments qu'on n'éprouvait pas réellement, la perpétuelle menace d'accomplir des actes qu'on n'avait nullement l'intention d'exécuter» (p. 154). Drumont encore : «Le cadavre social est naturellement plus récalcitrant, moins facile à enterrer que le cadavre humain. Le cadavre humain va pourrir seul au ventre du cercueil, image régressive de la gestation; le cadavre social continue à marcher sans qu'on s'aperçoive qu'il est cadavre, jusqu'au jour où le plus léger heurt brise cette survivance factice et montre de la cendre au lieu de sang. L'union des hommes crée le mensonge et l'entretient; une société peut cacher longtemps ses lésions mortelles, masquer son agonie, faire croire qu'elle est vivante, alors qu'elle est morte déjà, qu'il ne reste plus qu'à l'inhumer...» (p. 156).
Des pages entières de Drumont annoncent la critique radicale de la société consistant à «aller au-delà des apparences et des simulacres [pour] atteindre les causes» (p. 100), que mènera, tambour battant, Céline dans ses principaux romans et, bien sûr, dans ses pamphlets. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'un et l'autre, mais aussi Bernanos qui admira, à tout le moins, le romancier de génie qu'était l'auteur du Voyage au bout de la nuit, sont hantés par la nécessité, avant de crever, de gueuler leur horreur de l'imposture dans laquelle se repaissent leurs contemporains, de redonner aussi, du moins pour Bernanos, leur honneur aux morts (2), dont nous portons le poids des péchés (cf. p. 120), alors que n'importe quel «voyou, entre ses dynamos et ses piles, coiffé du casque écouteur, prétendra faussement être à lui-même son propre passé» (p. 74). Il s'agit de leur ouvrir les yeux, à ces imbéciles adeptes de loisirs et de santé physique, ne devant rien à personne et surtout pas, grands dieux non !, à celles et ceux qui les ont précédés et peut-être même enfantés, ne se doutant guère qu'ils mettaient au monde des bonhommes sans entrailles, la caboche pleine de bourre, il s'agit de les obliger à regarder, ne serait-ce que durant une seconde, quitte à ce que les placides pourceaux, dessillés, crèvent du spectacle qu'il auront sous les yeux : une société, un pays qui agonisent, et nous savons que nulle agonie n'est belle à voir, encore moins lorsque vous êtes forcés de planter votre regard sur le plus petit de ses hideux mécanismes : «Mais entre temps, l'autre France était morte... Tradition politique, religieuse, sociale ou familiale, tout avait été minutieusement vidé, comme l'embaumeur pompe un cerveau par les narines. Non seulement ce malheureux pays n'avait plus de substance grise, mais la tumeur s'était si parfaitement substituée à l'organe qu'elle avait détruit, que la France ne semblait pas s'apercevoir du changement, et pensait avec son cancer !» (p. 133).
Ainsi révolté, désespéré mais prêt à tout pour crever la baudruche, rendre leur honneur aux morts, laver ce qu'il considère comme un affront, une tache (3), Édouard Drumont est-il selon Georges Bernanos animé d'une violence qui fait de l'ordre (cf. p. 143), La France juive étant ainsi décrit comme un livre apparu «tout à coup alors que nul ne croyait [l']attendre» (pp. 74-5), surchargé, «comme on bourre d'explosifs un navire dont on n'attend plus rien, sinon qu'il se traîne jusqu'au but avec le tonnerre dans ses soutes, et qu'il saute contre l'obstacle» (p. 164). Ce livre, passé les premières semaines de stupéfaction, explosera en effet, et en profondeur, y compris dans le cloaque duveteux des catholiques, que moque une fois de plus Bernanos (cf. p. 129) : «L'oreille exercée avait pu entendre le bruit sourd de l'explosion, et déjà le regard cherchait à la surface le point exact d'où jaillirait le colonne de feu et d'écume...» (p. 166).
Il est vrai que le succès du livre de Drumont sera phénoménal, même si peu nombreux seront ceux qui, à l'instar de Bernanos, accorderont quelque crédit à la pensée de cet auteur, le plaçant résolument entre Maistre et Maurras, caractérisant son œuvre comme «une véritable entreprise de contre-révolution» (p. 103), évoquant les «puissantes synthèses» (p. 84), attentif à la «replacer sans parti pris, sans violence, dans le courant des faits, des idées, des impressions, des étonnements et des colères, où elle s'est insensiblement formée avant que de paraître au jour» (p. 96). Non, en effet, il ne s'agit pas, absolument pas, d'écrire un cours d'Histoire (cf. p. 83) mais, en évoquant la haute figure de Drumont, sa lutte contre les apparences, de critiquer le régime honni, «cette prétendue évolution démocratique, dont on voudrait faire on ne sait quel phénomène cosmique», n'étant en fait qu'un «médiocre incident de notre histoire, le signe extérieur d'une conquête politique qui ne saurait tenir éternellement les âmes asservies, et dont il reste l'espoir de briser la force, un jour, par le fer et par le feu» (p. 84), en quelques mots, en tentant le coup de force qui sera tant de fois tenté durant ces années, comme le rappelle Jeannine Verdès-Leroux dans son remarquable ouvrage intitulé Refus et violences dont j'avais longuement rendu compte.
Si Georges Bernanos parle de contre-révolution, à propos de l’œuvre de Drumont, c'est parce qu'il estime que l'Histoire est une chute, qu'il vit à une «époque où tout semble glisser le long d'un plan incliné avec une vitesse chaque jour accrue» (p. 72), mais aussi, parce qu'il faut lutter contre cette accélération, même si le combat est perdu d'avance, même si aussi, je l'ai dit, qui ne craint pas la mort, qui «part avec ce silencieux camarade» qu'est le désespoir «ne combat plus pour sa vie, mais pour sa haine, et ne se rendra pas» (p. 55) : «Pour moi, j'aurai fait ma tâche, servi selon mes forces le vieux maître mort, si je peux transmettre à quelques jeunes gens de ma race la leçon d'héroïsme que je reçus jadis quand je n'étais qu'un petit garçon. Sera-t-elle entendue, je ne sais. Cette grave tristesse, ce mépris qui brûle sans flamme, ainsi qu'un tison sous la cendre, cette colère sans éclat, ce rauque soupir de lion qui tant de fois m'a serré le cœur, trouveront-ils aujourd'hui leur écho ? Le trouveront-ils demain ? Cette génération est-elle encore assez vivante pour soutenir l'épreuve d'une clairvoyance désespérée ?» (p. 56).
Le désespoir, encore une fois, est la notion, je n'oserais écrire la vertu, cardinale, ayant permis à Drumont de poursuivre son combat acharné contre ce qu'il estimait être les puissances implacables de l'argent.
Nous y venons, au thème de l'argent, d'un «système social qui ne peut aboutir qu'à la dictature de l'Argent» (p. 180), dans des pages éblouissantes de Bernanos consacrées au scandale de Panama et intitulées Gogo idéaliste ou les cadavres dans le remblai (cf. pp. 205-21) qui, une fois de plus, me font songer à la verve insatiable et destructrice de Céline. Le thème de l'Argent a pour corollaire celui de l'antisémitisme et du Juif, comme l'avait développé Benoît Mérand dans sa belle et longue note sur La Grande Peur des bien-pensants et, s'il est clair que certains des termes que Bernanos emploie l'auraient conduit une bonne vingtaine de fois, s'il avait vécu à notre époque, devant tous les procureurs et gardiens du temple antiraciste, s'il est vrai que certains de ces termes (4) sont aujourd'hui difficiles à admettre ou même à lire, il est absolument impossible de faire de Georges Bernanos, comme le fut sans conteste Édouard Drumont, un antisémite. La question a été plusieurs fois abordée par les exégètes de Bernanos mais lui-même a tenu, à une époque, à mettre comme on dit les points sur les i, en écrivant : «Aucun de ceux qui m'ont fait l'honneur de me lire ne peut me croire associé à la hideuse propagande antisémite qui se déchaîne aujourd'hui dans la presse dite nationale, sur l'ordre de l'étranger» ou encore «S'il plaît à M. Hitler de déshonorer en ce moment la cause que mon vieux maître a servie, qu'importe ? Le nationalisme ne dégrade-t-il pas l'idée de Patrie, le militarisme militaire, la tradition militaire ? Le général Franco, et leurs Excellences le nom de la Croisade ? Quiconque a lu Les Grands cimetières sait quel cas je peux faire des politiciens et des assassins» (5). Certes, Georges Bernanos ne craint pas d'écrire que l'antisémitisme apparaîtra un jour «ce qu'il est réellement : non pas une marotte, une vue de l'esprit, mais une grande pensée politique» (p. 144) et il n'en est pas moins clair que c'est très probablement lorsque Bernanos, assistant au triomphe de la politique racialiste nazie, a compris que ce pouvait être la réalisation politique d'une telle «marotte» qu'il a fermement condamné les atrocités commises en son nom. Nous pourrions considérer que l'antisémitisme que Georges Bernanos défend dans son livre sur Drumont a une double visée : de critique sociale bien évidemment, puisque derrière le Juif, c'est le triomphe de l'Argent qu'il faut tenter de combattre, mais aussi métaphysique, dans les brisées du Léon Bloy du Salut par les Juifs, comme un Michel Estève n'a pas manqué de le relever : «Au plan spirituel, l'antisémitisme de Drumont et de Bernanos se veut volonté de lutte contre la «dictature de l'Argent», qui se révèle comme l'un des obstacles fondamentaux dressés, dans la vie des hommes, contre l'irruption du surnaturel, contre la fidélité au message de pauvreté du Christ» (Bernanos. Un triple itinéraire, titre repris par Minard en distribution, 1987, p. 239).
En effet, le Juif, pour lequel il n'est témoigné aucune sympathie, Bernanos reprenant, en les modérant certes, quelques-uns des termes des auteurs antisémites (6), n'est en fin de compte que le masque grimaçant de l'idole qu'il s'agit d'abattre, l'Argent, «la force immense, informe de l'argent» (p. 273), puisque le triomphe sans partage de ce dernier est l'une des causes de la dégradation morale et spirituelle, mais tout autant bien réelle, effective, militaire par exemple, de la France. Le lecteur pressé, journalistique, qui lirait ainsi La Grande Peur des bien-pensants pour y trouver des insultes contre les Juifs serait finalement déçu : ce qui intéresse Bernanos, ce qui a sans doute intéressé son maître Drumont, au-delà de l'outrance de trop de ses textes, c'est la possibilité d'analyser les causes de l'étrange défaite d'un grand pays autrefois chrétien, qui bradera son honneur à de multiples reprises. L'une de ces causes, inscrites en filigrane dans le texte bernanosien, semble être la véritable cassure qu'a constituée la Révolution française, ou plutôt son surgeon le plus hideux, la Terreur mais, beaucoup plus près de nous, et sous le nez et les yeux de Drumont, l'Affaire Dreyfus, sur laquelle Bernanos a écrit des pages superbes (7) : «Culte de l'armée, religion patriotique à peu près vidée de sa substance, et qui donnait encore, à la majorité des Français, l'illusion d'une unité spirituelle déjà détruite dans les cerveaux, entamée dans les cœurs. Au reste, depuis Gambetta, la République assistait sans déplaisir à la lente métamorphose de l'esprit national (dont le loyalisme monarchique avait été sans doute la plus haute expression), réduit peu à peu à la superstition pure, au fétichisme des midinettes, à une espèce de toquade, de béguin pour les militaires» (p. 246-7), Bernanos concluant ce constat par ces mots : «À la veille de la crise dreyfusienne, l'idolâtrie du petit soldat comme celle du Poilu Inconnu, autre invention de la démocratie, semble avoir présenté tous les caractères de ces écœurants accès de sensiblerie qui préludent à la plupart des profondes défaillances morales» (p. 247).
Georges Bernanos dépeint deux flanchements, celui de l'armée et celui de l’Église, du moins de ses représentants français, mais, en sourdine, ne nous y trompons pas, La Grande Peur des bien-pensants est un cri de révolte des derniers hommes libres face à la démission de la France (qui fut le premier titre de ce livre, avant que Grasset ne convainque Bernanos d'en changer), la massification, des moyens financiers, de la propagande journalistique, Drumont ressemblant parfois à Kraus (8), naïf idéaliste plutôt qu'habile homme politique, ayant seulement compté, du moins selon son exégète, "sur le fabuleux miracle d'une alliance des nobles et des paysans levés ensemble contre l'étranger, l'or juif devant solder les frais de la Croisade, ou plutôt il n'a compté que sur la justice d'une telle cause» (p. 274). Cette alliance fut chimérique, comme furent chimériques les actions du boulangisme de 1885 à 1889, de Déroulède marchant avec le général Roget en 1889 sur l’Élysée, de Jules Guérin s'enfermant avec une poignée de compagnons dans le bâtiment fortifié de la rue de Chabrol, comme furent en fin de compte chimériques le scandale de Panama ayant fait trembler la IIIe République et chimériques, malgré le succès éclatant de nombre de ses livres, les milliers de phrases écrites par Drumont que Bernanos décrit seul, revenu de tout, mourant assez misérablement, comme un prophète moqué ou, plus simplement encore, oublié de tous, y compris de ses ennemis.
En 1910, l'énorme crue de la Seine ravage des milliers d'habitations de Parisiens, et détruit la très belle bibliothèque de Drumont («L'admirable bibliothèque, riche de tant de souvenirs, était entièrement détruite», p. 310) et c'est cette même année que le fameux journal de Drumont, La Libre Parole, passe aux mains de l'Action libérale, que Bernanos stigmatisera dans une conférence sur Drumont, tenue le 28 mai 1929, en s'attaquant à la personne du médiocre Jacques Piou, l'un des thuriféraires du Ralliement à la République, conseillé dès 1892 par Léon XIII. C'en est fini de Drumont, que Bernanos nous présente une fois encore désespéré : «C'est que le muet désespoir qu'il exprimera jusqu'au bout avec une pudeur sacrée [...] est désormais entré dans le rythme de sa vie, et la moindre fausse note délivre brusquement l'angoisse secrète, le fait hurler d'une morsure en plein cœur» (p. 303), termes que nous avons lus bien des fois sous la plume de l'écrivain, mais appliqués à ses créatures romanesques.
Comment, d'ailleurs, Drumont pourrait-il ne pas se désespérer, puisqu'il a échoué dans tous les domaines où il a exercé son magistère imprécatoire, ou bien qu'il est arrivé trop tôt ou trop tard (cf. p. 300) ? Selon Bernanos qui plus d'une fois le compare à un prophète, il a annoncé dans sa Fin d'un monde l'Affaire Dreyfus : «Ou plutôt, le premier fait posé», à savoir la «trahison d'un Juif allié aux meilleures familles de sa race», «le reste semble aller de soi, paraît se déduire logiquement de la situation des partis, de leurs mœurs. Car c'est moins sans doute dans la légendaire ténacité juive que dans sa profonde entente de la société moderne, de ses ressorts secrets, de sa prodigieuse inconstance qu'il faut chercher les raisons d'une victoire, autrement incompréhensible» (p. 283). Georges Bernanos, quelques pages plus loin, évoque de nouveau la mainmise des Juifs sur la France, mais une France de toute façon déjà vaincue, dans des lignes qui, de nos jours, et si nous en jugeons par le précédent de l'Affaire (la première, celle de l'année 2000) dite Camus, lui auraient valu l'opprobre et surtout la haine immédiats, spontanés, de tous les bien-pensants de France et de Navarre. Alain Soral, l'obsédé du complot et du réseau occulte, s'il avait quelque style et puissance intellectuelle susceptibles de dépasser la hauteur d'une mangeoire à pourceaux, aurait pu les signer, du moins les contresigner : Drumont, selon Bernanos, «est parti d'un fait que son érudition prodigieuse a rendu évident pour tous : la conquête juive. Un petit nombre d'étrangers, d'une activité convulsive, tenus des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société aux cadres rompus, appauvrie par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs. Devenus maîtres de l'or ils s'assurent bientôt qu'en pleine démocratie égalitaire, ils peuvent être du même coup maîtres de l'opinion, c'est-à-dire des mœurs» (p. 328).
Une démission, à la lettre, une mystérieuse absence de la France à sa propre vie intérieure, un effondrement de l'intérieur d'un édifice dont la charpente est totalement vermoulue, alors que la façade, elle, continue de donner l'apparence de la santé, de la solidité, de la vie. Est-ce le moment ou plutôt, la mystérieuse vague de fond qui transforme, selon Péguy, la mystique en politique, événement qu'il datait de 1881, soit la naissance du monde moderne ? : «Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne [...]. C'est-à-dire : le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement : le monde de ceux qui n'ont pas de mystique [...]. Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même que le mouvement de sa déchristianisation. C'est ensemble un même, un seul mouvement profond de démystification. [...] le débat n'est pas proprement entre la République et la Monarchie [...]. L'intérêt, la question, l'essentiel est que, dans chaque ordre, dans chaque système LA MYSTIQUE NE SOIT POINT PAR LA POLITIQUE À LAQUELLE ELLE A DONNÉ NAISSANCE» (in Notre jeunesse, Œuvres en prose (1909-1914), Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1961, t. II, pp. 508, 509 et 518, l'auteur souligne). Drumont, lui, n'a donc rien pu faire pour empêcher les Juifs de profiter, plutôt qu'ils ne l'ont causé, de cet effondrement, tout comme il n'a pu empêcher les riches d'être encore plus riches, l'Argent de devenir plus lourd qu'il ne l'était, plus écrasant, envahissant toutes les strates de la société et, en particulier, l’Église : «Les riches tiennent maintenant la place prépondérante dans cette Église qui a été fondé par les pauvres; ils ont peu à peu relégué au second plan ce Christ qui apparaissait à nos ancêtres comme une image de miséricorde et d'amour. Je n'ai jamais rencontré parmi eux un bon mouvement, un acte de sympathie et de cordialité. Les legs faits au socialiste Bebel se montent à plusieurs millions. Jamais on n'a fait un legs à Veuillot. Un de ces privilégiés de la fortune, un possesseur d'immenses domaines, n'a jamais songé à me dire : «Vous avez beaucoup travaillé, vous devez avoir besoin de vous reposer. Je vous lègue une cabane et ces arbres pour vous abriter»» (p. 312).
Comment, d'ailleurs, notre pauvre lutteur aurait-il pu triompher face aux différents colosses qu'évoque Bernanos, comme la presse, devenue selon Kraus le goitre du monde et dont l'auteur de La Grande Peur des bien-pensants évoque avec force le rôle immonde et essentiel durant la Première Guerre mondiale, matrice de tant de mensonges et d'impostures ? : «J'accepte encore volontiers que pour la première fois dans l'histoire du monde, les gouvernements, maîtres absolus de millions d'hommes, aient tenu cinq années l'impossible gageure de substituer aux événements réels, à l'ensemble des faits quotidiens, une espèce de féérie, finalement acceptée de tous, grâce, il est vrai, à la complicité des puissances spirituelles, mobilisées les premières, et à l'énorme pouvoir de l'argent» (pp. 317-8). Bernanos ne cesse d'ailleurs de revenir sur les innombrables mensonges, éclos comme des larves de mouche, de la presse, qui allaient contaminer toutes les cervelles ou presque, mais en tout cas celles, si friables, des hommes politiques, eux-mêmes ne sachant plus à quel mot, à quel slogan, à quelle appellation se vouer : «Lorsque, au cours d'un siècle, de braves gens ses sont appelés eux-mêmes, tour à tour, Conservateurs, Libéraux, ou Modérés, dans l'espoir que ces sobriquets, qui suent la paresse et la peur, allaient leur assurer infailliblement l'estime et l'amour du peuple français, il ne faut s'étonner de rien», et Bernanos, terrible, pour le coup prophète, de conclure ce passage ainsi : «Nos prochains cimetières connaîtront un autre dévoiement d'éloquence. Espérons seulement que les municipalités futures se contenteront d'inscrire nos noms à la suite, qu'on fera du moins l'économie, sur la place du village natal, d'une autre Victoire aux tétons de zinc» (p. 325). Bernanos met en garde la jeunesse contre toute forme d'«étalage verbal et scripturaire qui ne signifie absolument plus rien, n'est qu'une détestable imposture» (p. 327), la Presse, comme la Guerre dont elle n'est peut-être que la face la moins scandaleusement horrible, la plus policée, disons la moins susceptible de faire fuir le gentil bonhomme démocrate et républicain, étant la pourvoyeuse acharnée «d'images cocasses toujours prêtes à devenir brusquement carnassières, prodigieuses consommatrices d'espérances et des vies humaines» (p. 330).
Les dernières pages du livre de Bernanos résument ce que fut le combat, bien évidemment perdu d'avance, de Drumont, mais annoncent, surtout, ce que d'autres ont appelé l'arraisonnement du monde, son écrasement sous l'empire d'une technique devenue folle, tout ensemble alliée et, tôt ou tard, maître implacable de l’État moderne, lui-même «simple agent de transmission entre la finance et l'industrie» (p. 320).
La critique de Bernanos s'affine dans la Conclusion, délaisse la thématique de l'antisémitisme à laquelle il ne semble pas avoir beaucoup cru, pour évoquer la disparition de l'empreinte chrétienne sur la France (cf. p. 344), en même temps que sa colère gronde, le voilà qui désigne l'ennemi et donne sa portée réelle à ce grand roman apocalyptique qu'est La Grande Peur des bien-pensants : le rêve de l'homme total, qui sera homme de fer ou ne sera pas, et survivra dans un monde devenu «l'Usine universelle, l'Usine intégrale» (p. 349) : «D'ailleurs, cette discipline elle-même doit se relâcher sans cesse, à mesure qu'approche le jour attendu, infaillible, de la libération absolue de l'homme, non pas de l'homo sapiens du philosophe antique, mais de l'homme total, qui ne se connaît ni Dieu ni maître, étant à soi seul sa propre fin – l'affranchissement de l'homme, c'est-à-dire de tous les instincts de l'homme, de l'animal humain divinisé» (p. 331). Ce sont de telles lignes, d'autres encore (9) où il annonce la folie à venir, les massacres à venir, les charniers futurs, l'état de guerre permanent (10), la nature immonde d'un monde sans Dieu (11), où «la brusque défaillance du Spirituel semble avoir dégagé brusquement, rendu libres de prodigieuses forces d'espérance, momentanément sans objet» (p. 333), d'une société ayant remplacé la pauvreté par la misère (12) et ayant aboli la douleur (13) et qui finira même par abolir l'humanité en tant que telle (14) soumise à une loi de fer, qui font de Georges Bernanos un écrivain insurpassable, à quelques lointaines années-lumières de nos deux histrions paranoïaques plus haut nommés, spectres remplis de mots putanisés, pitoyables représentants, de la pseudo-analyse politique, de l'écriture absente et du racisme ordinaire, et, aussi, pour le coup, une espèce de prophète qui bien évidemment ne s'est jamais revendiqué comme tel, seuls les faux prophètes acceptant sans rechigner de livrer la teneur de leur vision, alors que les vrais refusent de toute leur force ce qu'ils savent n'être qu'un fardeau, en somme, une vocation, un appel (vocatus). Oui, il faut se jeter en avant, et les lettres de Georges Bernanos témoignent de la violence, des doutes, de la colère qui furent siens lorsqu'il écrivit, laborieusement comme toujours, son livre sur Drumont. Mais il fallait l'écrire bien sûr, car il fallait témoigner du combat désespéré de cet homme contre les puissances de l'Argent, des «forces anonymes de l'Industrie et de la Banque», renversant «l'ordre des valeurs humaines» et mettant en péril «tout l'essentiel de notre civilisation», Drumont, comme tant d'autres témoins (songeons à Péguy, mais aussi à Bloy, tous deux cités par Bernanos dans son livre) ayant contemplé la «transformation réellement prodigieuse d'une société hier encore imprégnée de christianisme jusqu'aux moelles» à cause d'une «nouvelle forme de barbarie» qui «disposera d'assez de moyens assez puissants pour imposer à des milliers d'esclaves la discipline strictement biologique de la ruche ou de la termitière» (p. 342).
L'enseignement de Georges Bernanos ne peut être oublié et, si décidément il pouvait l'être à notre époque de femmelins et d'imbéciles, de pleutres et de pleurnichards, de journalistes écoutés comme des augures et d'intellectuels abâtardis jusqu'à se prostituer comme des journalistes, il ne saurait être toléré, qui fait d’Édouard Drumont, comme le cher Péguy écrit Bernanos, un maître de lecture, un déchiffreur de ce qui s'est tramé sous ses yeux, c'est-à-dire un homme libre : «Le vieux maître peut rendre demain le même service à nos fils. Apprendre à lire, Dieu l'a visiblement fait pour ça. Il y a chez lui, comme chez Péguy, du magistère de village, avec ce besoin de tout expliquer, ligne à ligne, de poser son gros doigt sur le texte obscur, en levant les yeux par-dessus les lunettes. Sa plus grande crainte est d'aller trop vite, de laisser en arrière le paresseux ou l'imbécile» (pp. 327-8).
À notre tour, donc, d'être des lecteurs, et de nous jeter en avant, quoi qu'il nous en coûte.
Notes
(1) L'édition utilisée est celle disponible dans le premier volume des Essais et écrits de combat (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1971), sous la direction de Michel Estève, p. 205. La notice de ce livre, excellente, ainsi que son apparat critique, sont de Joseph Jurt. Sauf indication contraire, toutes les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) Comme tous les grands livres de Georges Bernanos, La Grande peur des bien-pensants est pleine de morts et ne cesse d'évoquer le lien indéfectible, invisible, qui nous lie à ces derniers. Il est tout autant clair que c'est le péché de nos pères qui continue de nous poursuivre, le mensonge de nos pères qui continuent de nous gâter les dents : «Nous nous vantions d'être les hommes de l'avenir que déjà nous n'osions plus regarder notre victoire en face, la guettant de biais, prudemment, avant de lui tourner le dos. Ainsi lorsque nos fils parlent aujourd'hui avec un innocent dédain de l'époque désormais préhistorique où la bicyclette, sous le nom de vélocipède, ressemblait à une girafe suivie de son petit, quand l'automobile n'était encore qu'une effrayante machine aux quatre roues grêles, tenant de la sauterelle et de la tortue, avec ce reniflement lamentable, le spasme de son pauvre petit ventre de cuivre, et l'éternuement convulsif qui préludait à d'illusoires départs, nos fils, dis-je, oublient qu'ils risquent de rompre inutilement, dangereusement, avec un passé trop proche, trop étroitement uni par des liens secrets à leurs épreuves, à leurs déceptions, à leurs malheurs, au tragique de leur propre destin» (p. 62).
(3) «Une classe, comme un homme, peut être victime de ses fautes, mais elle n'est réellement déshonorée que par son cœur» (p. 106).
(4) «L'antisémitisme du vieux maître, quoi qu'on en ait pu dire, ferme le cycle de ses expériences, leur apporte une conclusion» (p. 95). Déjà, dans une conférence intitulée Édouard Drumont donnée à l'Institut d'Action Française le 28 mai 1929, Georges Bernanos affirme qu'il n'esquivera pas «ici ni ailleurs, aujourd'hui et demain, cette question de l'antisémitisme» (p. 1167), évoquant celui de Drumont, pour le moins incontestable, en ces termes où perce une nouvelle fois la puissance de l'Argent et du mensonge généralisé, mais aussi de la déconfiture profonde de la France : «Pour Drumont, l'homme juif est le grand exploiteur de nos vices, et s'il favorise la royauté de l'argent, c'est que l'argent est son roi. S'il affaiblit en nous le sens de la race, c'est que la sienne ne prospère qu'auprès des races surmenées, épuisées. S'il pousse à la révolution, c'est parce qu'il rêve d'asservir un prolétariat définitivement coupé de ses racines nationales, politiques, sociales, une poussière d'hommes ignorants et curieux. Drumont n'a pas inventé le Juif, le Juif était là, et sitôt qu'il l'eut désigné, tout le monde le vite» (p. 1171). Nous pourrions également évoquer les nombreuses mentions du terme «race» (cf. pp. 96, 105), qu'il faudrait tout autant se garder de comprendre sous un éclairage racialiste ou eugéniste, totalement étranger à la pensée de Bernanos : «L'affreux malheur des catholiques depuis cinquante ans, notre unique et affreux malheur, est de n'avoir pas reconnu en lui [le Français], sous des manières jadis aisées, devenues trop faciles, presque triviales, cette qualité profonde, ce signe mystérieux, indélébile, qui se nomme la race» (p. 142). Bernanos, citant Daudet, explique le sens de la race selon Drumont : «chez un Drumont, le sens de la race prime tout. Libérer la race, c'est-à-dire détruire d'urgence, par n'importe quel moyen, les forces étrangères, ces forces de décomposition nationale qui, après l'avoir arrachée à ses traditions séculaires, brisé ses racines, achèvent d'en tarir la sève. Tel est le but. Après quoi la race retrouvera d'elle-même, ira d'elle-même à sa destinée» (p. 281).
(5) Bulletin, n°47, septembre-décembre 1962, p. 7, cité dans la Notice de notre édition, p. 1380. Ajoutons que cette dernière, sous la plume de Joseph Jurt, apporte un éclairage juste sur la question de l'antisémitisme dans La Grande Peur des bien-pensants et donc, plus largement, le supposé antisémitisme de son auteur.
(6) C'est ainsi qu'il parlera de Benjamin Crémieux comme d'un «affreux petit Juif», Bernanos ayant des mots très durs contre la politique ayant consisté à «naturaliser en bloc, par décret, tous les Juifs d'Algérie, qui n'avaient pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de Français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisés qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur retrouvera d'elle-même, ira d'elle-même à sa destinée» (p. 270). Bernanos évoquera encore «la presse juive» (p. 269) ou «la finance juive» (pp. 263-4).
(7) Qui se conclut par l'évocation du duel entre Drumont et Clemenceau, cf. pp. 250-70, Trois balles à vingt pas.
(8) «Il est clair que si on pouvait supprimer tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été imprimé depuis deux cents ans, effacer des cerveaux toutes les impressions qu'ils ont reçues, on aurait affaire à des âmes plus respectueuses et plus dociles» (p. 241).
(9) «L'histoire tout entière du XIXe siècle est celle de ses déceptions, de ses fureurs paniques, de ses longues somnolences coupées d'accès sanguinaires dont on l'a vue chaque fois sortir exténuée, amollie, ruisselante de larmes. Nulle peut-être ne fut plus essentiellement, au sens total du mot, conservatrice. La haine du spirituel qui l'inspire d'ordinaire, cette passion où l'on serait tenté de reconnaître le signe d'une sorte de grandeur sauvage, démoniaque, n'est que la somme de ses ignorances, de ses rancunes, de ses envies. Elle a pris ses précautions contre le divin, simplement. Elle assiste sans comprendre à ce phénomène capital, unique: l'altération, peut-être désormais sans remède, du sens religieux dans l'homme moderne, qui fausse l'équilibre de la vie sociale, commence à développer d'énormes passions collectives dont la contagion menace de s'étendre d'un bout à l'autre de la planète» (p. 332). Ou encore : «En substituant l'homme à Dieu, nous avons mis par terre du même coup la notion de la Loi, et elle a entraîné dans sa chute les fonctions désormais frivoles qui ne tenaient que d'elle, et d'elle seule, leur caractère sacré» (p. 333).
(10) «Nul homme capable de pitié n’aurait le triste courage de cacher à la jeunesse de notre pays une vérité désormais trop évidente, qui vise entre les deux yeux ainsi que la bouche noire d’un browning : la guerre est l'état normal, naturel, nécessaire, d'une société qui se flatte de ne devoir absolument rien aux expériences du passé, s'organise pour suivre pas à pas la science dans ses perpétuelles transformations» (p. 336).
(11) «[L]a Société qui se créé peu à peu sous nos yeux réalisera aussi parfaitement que possible, avec une sorte de rigueur mathématique, l'idéal d'une société sans Dieu. Seulement, nous n'y vivrons pas. L'air va manquer à nos poumons. L'air manque. Le monde qui nous observe avec une méfiance grandissante s'étonne de lire dans nos yeux la même angoisse obscure» (p. 350).
(12) «Celle qui fut, deux mille ans, parmi les hommes, une autre présence réelle, l'enfance divine elle-même, le mystère d'un regard triste et pur, vous l'aurez chassée du monde, poursuivie à travers toutes les routes du monde, comme une bête enragée, idiots que vous êtes. Et à sa place vous avez vu soudain paraître la Misère, c'est-à-dire la pauvreté devenue folle. La Misère s'est mise à hurler à chaque carrefour de nos villes de fer, la Misère avec son linge haillonneux et ses bas de soie, son indéfrisable, ses bijoux de cuivre et ses atroces parfums, la Misère au cœur féroce et frivole, la Misère des dancings et des cinémas, grimaçante parodie de la pauvreté, qui crache sur le pain et le vin» (p. 340).
(13) «Dans une société qui a complètement perdu le sens chrétien de la Douleur, au point de la haïr, et même de ne haïr qu'elle, il est juste que le pauvre reprenne sa place aux côtés du milliardaire, puisqu'ils appartiennent désormais l'un et l'autre à ce monde pour lequel le Christ a refusé de prier […]» (pp. 341-2).
(14) «Plus encore que l'expérience russe ou américaine, la première des guerres universelles que notre espèce vient de subir avec une extraordinaire passivité peut donner quelque idée d'un progrès obtenu par les méthodes de laboratoire, grâce à une impitoyable sélection. Le temps viendra, le temps va venir où notre répugnance à sacrifier le matériel humain [...] paraîtra non moins ingénue que le scrupule des chirurgiens du XIIIe siècle à disséquer les morts. Il est déjà trop évident qu'une société digne de ce nom, sans préjugés de sensibilité ni de morale, est seule capable de triompher du plus tenace des fléaux, la misère, grâce à une rigoureuse hygiène sociale, c'est-à-dire en limitant les naissances et supprimant les infirmes ou les paresseux. Alors l'idée démocratique aura achevé de se libérer d'un vocabulaire religieux ou sentimental, désormais inutile, pourra se montrer telle quelle, ainsi qu'une conception entièrement neuve et totale de la vie» (pp. 335-6). Günther Anders ou Giorgio Agamben, on ne voit à la lecture de ces phrases, n'ont strictement rien inventé.



























































 Imprimer
Imprimer