« Le quart de Nikos Kavvadias | Page d'accueil | In memoriam : Anna Karénine, sublime au-dessus des hommes, par Grégory Mion »
28/07/2014
Histoire et Lumières de Zeev Sternhell et Nicolas Weill

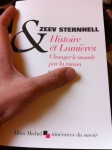 À propos de Zeev Sternhell et Nicolas Weill, Histoire et Lumières. Changer le monde par la raison Éditions Albin Michel, coll. Itinéraires du savoir, 2014.
À propos de Zeev Sternhell et Nicolas Weill, Histoire et Lumières. Changer le monde par la raison Éditions Albin Michel, coll. Itinéraires du savoir, 2014.Zeev Sternhell est un historien aussi controversé voire sèchement réfuté, par exemple par l'excellent Pierre-André Taguieff, que passionnant. Dans ce beau livre fort contestable d'entretiens avec Nicolas Weill, lui-même d'ailleurs n'hésite jamais à rappeler ses désaccords, sans doute parce que, par chance, il n'appartient pas au petit monde sclérosé de l'Université française, sans doute aussi parce qu'il ne craint pas d'appeler un chat un chat, un imbécile un imbécile, celui qui a combattu sur plusieurs champs de bataille pour défendre Israël en ayant vu, comme on dit, bien d'autres.
Si Nicolas Weill peut affirmer que c'est Georges Levitte, qualifié de «maître de tradition orale», qui le premier évoqua les travaux sur Barrès d'un «jeune professeur israélien» (p. 8), c'est son ouvrage sur les Anti-Lumières qui me le fit découvrir, et c'est donc en m'appuyant sur l'un de ses ouvrages les plus connus, La Droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, que j'ai récemment tenté de situer la pseudo-pensée politique de Renaud Camus.
La pensée de Zeev Sternhell semble moins complexe (2) que l'homme lui-même, un temps catholique (1) mais viscéralement juif (p. 69), puis étudiant en France qui se déclare profondément de gauche (ses détracteurs diraient même : gauchiste athée) (3) et rappelle systématiquement son très profond attachement à l'existence même d'Israël, qui «n'est pas seulement une question politique. Elle touche à quelque chose de bien plus fondamental que l'on pourrait définir comme un retour à l'humanité de l'homme et à sa dignité» (p. 26), existence éminemment problématique, car, où qu'ils aillent, les «Juifs emportaient le virus antisémite dans leur ballot» (p. 36), pays dont l'existence tient du miracle qu'il n'a en tout cas pas hésité à défendre en prenant les armes et en faisant la guerre, celle des Six Jours en 1967, celle du Kippour en 1973 (4). Nous sommes là, fort heureusement, bien loin de l'exemple de l'universitaire ou du professeur français, dont la seule expérience guerrière se limite au fait d'assister à un conseil de classe.
Cette pensée se distingue, d'abord, de celle d'un Zygmunt Bauman établissant des parallèles entre Auschwitz et le goulag, ou bien, plus connu, Ernst Nolte, «qui considère le nazisme comme une imitation du stalinisme voire du léninisme» (pp. 124-5), sans oublier François Furet qui, selon Sternhell, a aussi «joué ce jeu-là, en France, en cheville avec Nolte», ce qui l'a personnellement attristé, car il déclare avoir eu beaucoup d'amitié pour cet historien (cf. p. 125). Une fois de plus, nous ne pouvons qu'apprécier le franc-parler de Zeev Sternhell : «Que le stalinisme fût une dictature immonde, je le savais avant Furet. Quand lui était membre du Parti communiste français, moi je barbouillais les murs de Cracovie» (p. 125), Sternhell ayant également fait un sort, selon ses dires, à la thèse selon laquelle Mussolini aurait été un disciple de Lénine, dans sa Naissance de l'idéologie fasciste paru en 1989.
Bien évidemment, Zeev Sternhell ne peut qu'être en total désaccord avec Isaiah Berlin qu'il n'aime visiblement pas beaucoup et qui, à ses yeux, n'a écrit dans les années 50 que des «pamphlets de guerre froide» (p. 126), selon le mot de Leo Strauss et dont l’œuvre, toujours selon Sternhell, si elle devait tomber dans l'oubli, ne constituerait pas une grande perte (cf. p. 127).
Cette pensée se fonde sur une thèse plusieurs fois étayée : un fascisme français existe, et bien avant sa réalisation «politique et institutionnelle en France» (p. 288), c'est-à-dire Vichy, Maurice Barrès par exemple devenant «une sorte de récipient, de fleuve dont de nombreux affluents nourrissent la pensée : le «platane de Monsieur Taine» [allégorie qui se trouve dans Les Déracinés et exprime le déterminisme où se trouve englué l'individu], La Réforme intellectuelle et morale de Renan, le darwinisme social de Jules Soury dont personne auparavant n'avait entendu parler, les fureur antijuives du marquis de Morès [un aristocrate ruiné partant dans les colonies], etc.» (p. 160). Sternhell a consacré un travail important à Barrès, «écrivain, homme politique, publiciste et journaliste devenu, avant Maurras, idéologue et penseur du nationalisme. Il se situait aux confluents de champs d'activité divers et véhiculait une synthèse archimoderne de nationalisme organique et de socialisme antimarxiste sur fond de violent antisémitisme. Théoricien de l'antidreyfusisme, il était aussi propagandiste et agitateur : une figure en somme très moderne» (p. 161), dont certains aspects se retrouvent dans la prose politique d'un Renaud Camus ayant remplacé le rationalisme, l'universalisme, l'individualisme et l'humanisme détestés par Barrès et considérés comme les ennemis des racines provinciales et nationales de ses figures de déracinés par l'antiracisme et l'immigration incontrôlée et, comme le prouvent de plus en plus certains de ses propos tombant sous le coup, je le suppose du moins, de la loi, la simple présence de populations arabes (pas toutes nécessairement musulmanes) sur le sol français.
Ce n'est là qu'un des aspects, peut-être le moins profond, de la pensée sternhellienne, même s'il a provoqué beaucoup de remous, on s'en doute, dans le petit univers de la recherche historique française (5) supportant assez mal qu'on lui fasse la leçon herméneutique, l'autre étant sa défense acharnée de la raison, du progrès (6), partant des Lumières, contre le mal qui peut toucher n'importe quelle société, y compris la société juive qui, après avoir tant souffert, est capable d'infliger des «souffrances aussi dures aux Palestiniens occupés» (p. 189). De fait, «le mouvement intellectuel, culturel et politique associé à la révolte contre les Lumières ne constitue pas une contre-révolution, mais une autre révolution : ce n'est pas une contre-modernité qui se fait jour, mais une autre modernité, fondée, comme le voulait Herder, sur le culte de tout ce qui distingue et sépare les hommes – l'histoire, la culture, la langue –, et cette culture politique refuse à la raison aussi bien la capacité que le droit de façonner la vie des hommes» (p. 198).
Plus loin, Sternhell définit classiquement le fascisme (7), dont la droite révolutionnaire française a constitué le chaudron (8), comme étant «la mise de toute l'autorité, de toute la puissance de l’État, concentrée entre les mains du chef, au service de nouvelles valeurs», puis, plus originalement tout de même, comme une révolte justement «contre le principe des Lumières, ou plus concrètement contre la démocratie, le socialisme d'origine marxiste et le libéralisme. Vichy n'était rien d'autre. La dictature de Vichy n'était ni plus ni moins pluraliste que le régime mussolinien, et l'ascension de Pétain a été plus facile que celle d'un Mussolini ou d'un Hitler» (p. 325).
Une proposition qui, une fois encore, ne plaira sans doute guère à tout ce que notre pays, qui céda si facilement, quoi qu'on en dise, aux sirènes de la Collaboration et qui, maintenant, se prépare, peut-être, à de nouveaux troubles, compte d'historiens, de penseurs et de pseudo-penseurs politiques.
Notes
(1) Cf. p. 34, où l'auteur évoque son enfance en Pologne : «Il fallait avoir le polonais pour langue maternelle, il fallait jouer le jeu du Polonais croyant, du Polonais avec sa foi dans le Christ, du Polonais avec un autel à la maison ! Nous en avions un chez nous, dont je m'occupais personnellement, avec l'effigie de la Vierge et du petit Jésus. Je l'entretenais en le garnissant de fleurs. Aucune erreur n'était permise. Aucune allusion ne devait transpirer. Aucun élément de culture étrangère, en particulier de culture yiddish, ne devait affleurer. Je me suis d'ailleurs pris au jeu et suis devenu un petit catholique. C'est la seule période de ma vie où j'ai eu la foi religieuse» (p. 34). La leçon polonaise, résumée par Zeev Sternhell : «Dans la Pologne de cette époque, j'ai appris une importante leçon : en dictature, le mensonge vient d'abord, la peur ensuite» (p. 53).
(2) Pensée qui ne se départit pourtant jamais des bases de tout travail historique sérieux : la lecture des archives, celle des «œuvres des idéologues du mouvement, leur presse et leurs publications et en comparant leur pensée aux réalités économiques et sociales de l'époque» (p. 91), cette remarque concernant Ni droite ni gauche vaut pour les autres ouvrages de l'auteur. Ailleurs, il écrit : «La recherche, dans un domaine comme le mien, est un champ idéal : je travaille seul, personne ne peut lire ni écrire à ma place, je n'ai besoin ni de gros budgets de recherche, ni d'assistants qui feraient autre chose que du travail technique, ni de travail en équipe» (p. 121).
(3) «J'ai toujours été à gauche, je n'ai pas changé. J'ai toujours été pour la laïcité et toujours eu horreur des bigots. J'ai toujours été pour les droits de l'homme, pour la Révolution française et la Commune, pour le peuple et les petites gens qui travaillent dur pour vivre. Je pense toujours que le concept d'«exploitation» englobe une réalité sociale et économique, je vois les inégalités se creuser partout autour de moi et je pense qu'il faut les combattre avec la dernière énergie» (p. 77). De cette position politique découle, logiquement, sa critique très vite de la politique israélienne, clairement de droite à ses yeux, et sa volonté de voir les Palestiniens durablement s'émanciper : «Je veux par conséquent, disons-le une fois encore, une large majorité juive mais qui assure aux minorités arabes l'égalité absolue, non seulement formelle mais réelle. Tel est l'objectif de l'existence de l’État d'Israël que la droite au pouvoir aujourd'hui récuse. Elle cherche en fait, par tous les moyens possibles, à affirmer l'infériorité légale, juridique des Arabes citoyens d'Israël» (p. 130). Concluons par les propos de l'auteur : «La seule armature conceptuelle qui permette d'envisager un monde plus juste et plus humain reste le socialisme enraciné dans un marxisme modernisé, parce que seul le marxisme remet en cause le capitalisme» (p. 353).
(4) Respect de la virilité guerrière que l'on voit encore lorsque Sternhell évoque un garagiste américain, qui «avait été dans les «bérets verts» et avec lequel il a tout de suite sympathisé, parce qu'il venait du peuple et que, «en gros, c'était le peuple qui s'était battu, la bourgeoisie», elle, ayant «vaqué à ses affaires, fait des études, gagné de l'argent» (p. 313).
(5) «Cette génération refusait que l'on regardât en face les problèmes tels qu'ils se posaient dans les années 1930, leurs réactions avant la guerre et leurs réactions sous Vichy. Elle refusait d'affronter la logique de la continuité entre l'entre-deux-guerres et Vichy. Elle était passée dans la Résistance, après avoir tout fait pour participer à la Révolution nationale» (pp. 260-1). Sternhell évoque ainsi la querelle qui l'opposa aux disciples de René Rémond : «Il n'y a aucune trace de racisme [à la différence de celui qui existe dans les livres d'André Siegfried] dans sa démonstration et, s'il puise son cadre conceptuel de La Droite en France (1954) chez Siegfried, il le traduit en termes politiques, historiques (chez Siegfried, l'analyse se fait davantage sur un mode sociologique et anthropologique). D'où la fameuse théorie des «trois droites» de Rémond (légitimiste, orléaniste, bonapartiste). Derechef, elle a fini par constituer un système fermé, aussi intouchable que l’Évangile. Ce système-là ne permet pas d'envisager l'existence même d'une droite plus extrême que la droite bonapartiste (le fascisme par exemple). Il s'agissait d'un dogme qu'il fallait défendre, faute de quoi tout tombait en morceaux ! Alors, comme personne n'aime abandonner une œuvre qui est considérée comme l'excellence même, les élèves, les disciples de René Rémond, Pierre Milza, Michel Winock et Serge Berstein, à mon sens le plus faible des trois, ont eux aussi fait «bloc» contre Ni droite ni gauche» (pp. 272-3).
(6) Voici les toutes dernières lignes du livre de Zeev Sternhell : «L'être humain est toujours capable de se construire un avenir meilleur. Le monde tel qu'il est n'est pas le seul possible. Je ne crois nullement que l'idée de progrès soit morte ou nocive. Il faut s'y accrocher, il faut la défendre. Pour elle, il faut combattre» (p. 355). Ces lignes ne peuvent que nous rappeler celles qui concluent Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide (Fayard, coll. L'espace du politique, 2006, p. 580 : «Pour éviter à l'homme du XXIe siècle de sombrer dans un nouvel âge glacé de la résignation, la vision prospective créée par les Lumières d'un individu acteur de son présent, voire de son avenir, reste irremplaçable»
(7) Si le fascisme «constitue l'expression la plus extrême du combat contre les Lumières», le nazisme, lui, «fut un assaut total contre le genre humain» (p. 329).
(8) «C'est pourquoi je pense que le fascisme représente une invention inouïe, un révolution d'un type nouveau, intellectuelle, morale et politique, mais non pas économique et sociale. En effet, la droite révolutionnaire, en France comme ailleurs, s'appliquait à détruire les valeurs intellectuelles et morales des Lumières françaises, et non pas le capitalisme» (p. 330).
Lien permanent | Tags : histoire, israël, judaïsme, fascisme, nazisme, zeev sternhell, nicolas weill, renaud camus, maurice barrès, charles maurras, ernst nolte |  |
|  Imprimer
Imprimer

























































