« Raskolnikov, une ombre de surhumanité sous le soleil de Saint-Pétersbourg, par Gregory Mion | Page d'accueil | Le Chemin des morts de François Sureau »
25/08/2013
Masante de Wolfgang Hildesheimer

Crédits photographiques : Andy Wong (Associated Press).
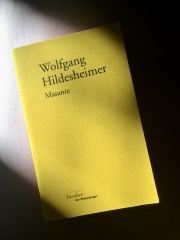 Acheter Masante sur Amazon.
Acheter Masante sur Amazon.Masante publié en 1973 et traduit par les Éditions Verdier en 1999, est un long monologue qui se développe en tentant de cerner deux vides, sans jamais prétendre pouvoir les remplir : Masante d'abord, la ville quittée, sonorité (1) plus que lieu véritable, et quittée pour Meona, un lieu qu'on ne choisit pas (cf. p. 41), encore moins ce bistrot de La Dernière Chance tenu par Alain, prêtre défroqué, et sa vampirique compagne, Maxine, intarissable pourvoyeuse, (comme le narrateur d'ailleurs, qui semble tout savoir, cf. p. 113) d'histoires et d'anecdotes, de vies (cf. p. 179) et, nous le soupçonnons, de plaisirs plus ou moins inquiétants, comme ceux que dispense les succubes (cf. p. 232); l'horreur ensuite, qui sidère le narrateur tout le long de son monologue intarissable et n'est jamais autrement évoquée que par la description de mystérieux hommes de main aux noms interchangeables, comme le sont tous les noms de bourreaux, comme le sont tous les noms qui tentent de signifier le mal, dans une relation d'extériorité clinique avec l'horreur (cf. p. 197).
Le mal n'est jamais précisément détaillé, mais il est clair que c'est le goût de l'auteur pour la question de l'origine (2), y compris étymologique puisque les noms sont ses repères (cf. p. 64; voir encore sa méditation sur le nom d'Hamlet, p. 147), qui peut lui permettre de remonter toutes les pistes mémorielles, où s'enfuient les êtres jadis aimés, les instants de bonheur et de grâce, les anecdotes peut-être pas toutes vraies racontées par Maxine, les objets enfin, dont la mystérieuse matérialité semble poreuse, comme si elle était infusée par le temps (3).
Il y a urgence, d'ailleurs car, comme le narrateur d'Agonie d'Agapè de William Gaddis, celui de Masante estime que la fuite des temps n'est pas simplement un phénomène d'entropie inéluctable, mais qu'il touche, dégrade l'être même des choses dont il détricote l'essence, ajoutant que ce phénomène semble même s'accélérer, comme si un mystérieux principe de désorganisation ne se contentait pas de défaire ce qui a été fait mais prétendait, aussi, le corrompre : «Bien sûr, il faudrait savoir lire Bach, mais les grandes partitions pâlissent, le beau devient un palimpseste, recouvert par autre chose, par de sobres formules de survie ou des instructions pour apprendre à survivre, mais les indications sont insuffisantes, à quoi bon ?» (p. 55) et puis, constat plus inquiétant car il résonne lugubrement aux oreilles des hommes hantés par Auschwitz et le Goulag, par les expériences qui furent menées sur le bétail humain, dont sa propre consommation, évoquée dans telle fable qui nous paraît de moins en moins imaginaire : «Les astronautes boivent déjà leur propre urine rendue goûteuse par une pincée de chimie, le cycle se trouve ainsi radicalement raccourci, le métabolisme du corps fonctionne en circuit fermé, l'homme nourrit l'homme, bientôt il commencera à se grignoter les oreilles et sera obligé de se réchauffer à sa propre haleine» (p. 151).
Évoquant les pratiques d'un homme dont le seul plaisir consistait à offrir aux très beaux enfants une cuiller d'argent, le narrateur affirme : «C'est ainsi que prit fin la prédilection d'un homme relativement bon pour la beauté, un homme qui ne désirait rien d'autre que de laisser chez les destinataires de ses cadeaux, certes peu opulents, le souvenir d'un mécène, d'un admirateur d'une qualité qu'il prenait, avec quelque exagération peut-être, pour un don des dieux. Il s'était certainement considéré comme un mécène, comme l'instigateur d'un modeste mythe destiné à mettre un peu de lumière dans un monde qui s'obscurcissait et qu'il voulait illuminer selon ses possibilités, car lui aussi, et il en souffrait, se sentait enraciné dans l'obscurité; pour finir il y succomba : pas de tragédie ici, pas d'histoire» (p. 66).
Quelle que soit sa secrète nostalgie, bien visible dans une multitude de remarques évoquant la décadence du monde (4), cette quête de l'origine ne peut être qualifiée de réactionnaire puisque l'effacement de ce qui a été laisse la place à ce qui va être : «Les emblèmes légendaires de la fondation de certaines villes, l'ours et le Kindl, le temps a bien fait d'en effacer l'origine, tout est ouvert, sans énigme, rien ici n'attend d'être déchiffré, tout est là, recouvert en partie de la poussière du désert [...]» (p. 64). C'est d'ailleurs pour cette raison que le narrateur a quitté Masante, dont la riche sonorité évoque la plénitude d'un passé aboli, sans cesse revécu (5) et exploré dans des digressions qui semblent, parfois, fort éloignées du sujet du roman d'Hildesheimer, pour se retrouver au beau milieu de nulle part, l'indigente localité de Meona, avant-poste du désert qui recouvre tout, mais, en le recouvrant, le conserve pour de futures explorateurs qui eux, peut-être, auront plus de goût que le narrateur pour le déchiffrement des signes à moitié effacés (6).
Il est certain, aussi, qu'il serait dangereux de vouloir fantasmer un hypothétique âge d'or, fût-il celui que la mémoire d'un homme parvient à incarner à mesure que l'âge l'éloigne de l'enfant qu'il a été et ne sera jamais plus, étant donné que l'essence même de toute narration réside dans le recommencement plutôt que dans le commencement, réservé à Dieu : «Une vraie histoire après tout, c'est toujours l'histoire de recommencements, seules les fausses histoires continuent et se développent selon une loi ou selon les règles de l'art» (p. 94), alors même que le véritable narrateur ne doit pas craindre, avant de tenter de captiver et capturer les souvenirs, de les laisser s'enfuir (7).
C'est ainsi qu'il est persuadé qu'il retournera, un jour, à Masante, comme si le retour était indissociablement lié, pour un écrivain, à la découverte puis l'exploitation d'un filon, c'est-à-dire d'un fil qu'il faut ne pas casser, d'un récit qu'il faut sans cesse reprendre : «Quant à moi, je n'ai pas voulu l'emprunter [l'issue à travers les sables], je ne suis pas en fuite, je ne suis pas un martyr non plus, je ne cherche pas le danger, je retournerai à Masante – le retour se met à briller devant moi – dès que j'aurai trouvé un seul fil, un qui vaudra la peine d'être filé» (p. 118).
Dans le monde du roman d'Hildesheimer qui semble être obsédé par la question d'une réelle présence qu'il serait loisible à l'auteur de conquérir par l'évocation du passé dont il s'agirait de trouver ou retrouver la cohérence, «cette cohérence entre tout ce qu'il est possible d'exprimer» (p. 125) le mal, sans être vide ou privation, n'est que masque de médiocrité dérisoire, attachée par exemple à l'honneur ou à «la disparition des bergers allemands» (p. 133), attachée encore à établir sans fin des listes de «noms et [de] numéros» (p. 120), méthodique «réseau des planificateurs et des mesureurs» (p. 118), «assassin» ou «coupeur d'oreille» (p. 127), «invisibles voleurs de cadavres, voleurs de squelettes, fossoyeurs et profanateurs» (p. 149), simples «exécutants» (p. 160) ou bien encore «fauteurs de terreur de ce monde, suants et puants» (p. 237).
L'horreur est évoquée sans la moindre emphase, comme découpée en petites vignettes qui ne présentent aucune cohérence symbolique ou fictionnelle les unes avec les autres, comme si le spectacle du mal (8) ne pouvait jamais s'offrir dans sa plénière cohérence ainsi que l'a analysé Enrico Castelli dans Le démoniaque dans l'art, cette faculté étant réservée au diable ou plutôt à Dieu, comme si la terreur (9) qu'il provoque dans l'esprit et la chair du narrateur était décuplée par la sobriété même de telle ou telle notation : «Il [un parapluie] n'était pas encore fait de cette matière qu'on utilisait en Allemagne il y a quelques dizaines d'années, pas encore de peau humaine, détail qui n'est pas non plus inscrit dans les manuels scolaires» (p. 136). Quelques pages plus loin, une remarque en apparence anecdotique est révélatrice de cette distillation du sentiment diffus de terreur : «Je ne connais pas ses entrailles et je ne veux pas les connaître, filtres à air, chambres de combustion, ne les appelait-on pas autrefois chambres à gaz ?» (p. 161).
Le caractère intangible du mal, sa banalité même, hors de toute référence trop grandiloquente, comme pourrait par exemple l'être la sphère religieuse (10), est pourtant le noyau de ténèbres, le cratère auprès duquel il faut tenter de s'approcher le plus près possible, sans jamais toutefois prétendre jeter son regard à l'intérieur du puits sans fond, ni même en raconter tel ou tel épisode qui ne serait pas seulement suggestif car tiré de la mémoire de l'auteur, mais nous permettrait de découvrir le motif dans le tapis qu'au fond tout écrivain n'en finit pas de chercher : «En viendrai-je un jour au fait ? Jamais, naturellement. Je devrais le savoir, depuis le temps. Jamais. Pas dans cette vie en tout cas. Mais les autres, en viendront-ils un jour au fait, et à quel fait ?» (p. 144).
L'absence de fait qui est donc la vérité qu'il importe de révéler (11) n'est finalement pas ce qui compte, puisqu'il nous semble que, pour le narrateur, l'horreur suprême réside dans l'histoire sans nom, celle qui n'a pu être racontée faute de conteurs : «les vrais saints, sans doute, ce sont eux; ce n'est pas le cardinal, vieillard vêtu de pourpre, mais le frère convers qui le déshabille, lave son corps délabré et lui conserve ainsi sa dignité; ce n'est pas le pape, mais la nonne qui retire le bassin sous le pape moribond. Personne ne pense à eux. Ils sont sans nom, sans langue, et quand ils s'éteignent, personne ne les connaît plus» (p. 193).
C'est ainsi que la question la plus bouleversante que pose cet étrange roman (12) qu'est Masante concerne sans doute, in fine, le statut du témoignage dans un monde qui a connu l'horreur, et dont nul ne sait si elle a pu être durablement vaincue, si donc elle ne va pas se présenter à nouveau, comme un monstre cherchant qui dévorer, alors même que le narrateur, celui qui pose justement le constat terrible selon lequel le monde a basculé dans un règne de fer, semble être celui qui est dépourvu de toute colère envers les assassins, de toute nostalgie même du monde, de la part sacrée de ce dernier que préserve le temps liturgique (13), monde qui a été irrévocablement détruit, et qui n'est même pas désireux de témoigner (14) : «Mon temps est passé. À l'avenir on ne chantera plus. On n'a plus le choix des tonalités. Plus qu'une seule. Non, deux : l'ordre et le cri. Qui ne commande pas, qui ne crie pas, reste muet. Témoigner ? Pour qui ? De quoi ? D'indifférences, d'acceptations, d'échecs, d'impuissance ? Plutôt en finir. Le pal dans la chair vaut mieux que la joyeuse salmonelle, mais, justement, il fait mal. Je n'étais destiné à rien, surtout pas au combat. J'aurais aimé être de ceux qui, brandissant le drapeau, bondissent par-dessus les barricades, un libérateur parmi les libérateurs ! Mais qui sont-ils, qui étaient-ils ? Un mythe, un beau conte. Prêcher un noble but. Oui, mais où le but a-t-il survécu à ses prophètes ? Où résiste-t-il et où l'emporte-t-il sur ses faussaires et ses démolisseurs ? Un faux ordre s'est installé, marqué au fer rouge; qui prétend pouvoir l'éradiquer se trompe. Celui-là ne connaît pas les hommes de main, les sbires, les spadassins, les agents et leurs maîtres» (pp. 218-9).
Notes
(1) Voir page 17 de notre édition, Masante, traduit de l'allemand par Uta Müller et Denis Denjean, notice de Jean-Yves Masson, Éditions Verdier, coll. Der Doppelgänger, 1999). Cette préoccupation des noms et de leur sonorité est constante tout au long du livre, comme nous pouvons par exemple le voir à propos des prénoms, p. 21 ou encore p. 25. Le narrateur déclare par ailleurs, amusé comme auraient pu l'être De Quincey ou Borges en émettant ce type de propos : «[...] je m'intéresse à l'histoire des noms, j'aurais même trouvé intéressant de connaître le nom et le prénom du petit chaperon rouge» (p. 33).
(2) Ainsi : «Masante : j'ignore encore aujourd'hui ce que ce nom signifie, personne n'a pu me le dire. Ce qui m'arrange car je peux en toute liberté poursuivre mes propres hypothèses. Je n'aime pas trop l'exégèse, mais je remonte volontiers toutes les pistes jusqu'à leur origine. Le nom sonne bien pour une maison. Masante : on avance d'un pas mesuré, sur un rythme d'andante [...]» (p. 43). Ailleurs, l'auteur évoque l'étrange bibliothèque d'un «relieur passionné», qui «regorgeait de trésors, des livres aux pages de vélin magnifique pressé à la main, des parchemins parfaits pour y inscrire textes apocryphes et palimpsestes, des pages de garde pastel aux motifs anciens, des livres aux formes bizarres, ovales ou hexagonales. Le travail d'une vie, et toutes les pages blanches. Dans toute sa bibliothèque, pas un seul mot» (p. 42).
(3) «Ces réceptacles bourrés de vanités, les choses que nous conservons pour les oublier. Si nous les jetons nous gardons au moins le souvenir de les avoir jetées, le regret les rend présentes. Mais si nous les gardons, nous ne les retrouvons plus jamais, et celles que nous n'avons pas retrouvées s'auréolent d'un nimbe, redoublent d'importance et deviennent la solution perdue de toutes les énigmes, alors qu'elles n'auraient témoigné sinon que de nos échecs et de nos défaillances» (p. 41).
(4) Comme par exemple : «Avec le mal le bien aussi s'en va, avec la douleur les images aussi [...]», p. 218 et «Réussir une œuvre, je n'en suis plus capable, l'époque de la réussite est révolue, tout comme l'époque de ceux qui réclament encore des œuvres réussies» (p. 226).
(5) «Je ne suis ici, si loin de Masante, que pour m'en approcher par mes rêves, seule la distance remet les choses en place et en définit la valeur» (p. 90).
(6) Remarquons tout de même que le narrateur se déclare plus d'une fois passionné, à l'évidence, par le déchiffrement des signes : «Que transporte-t-il [son hôte] là-bas, qu'en ramène-t-il ? Il y a là encore des possibilités : éclaircir ce qui est apporté et emporté, sonder les cachettes, examiner les pièces, ouvrir les portes, il y en a beaucoup, et moi, j'ai du temps» (p. 111).
(7) «[...] pazienza, pazienza – tout ce qui vient, laissons-le s'envoler et se disperser, et le moment venu, si possible, laissons-le approcher» (p. 111).
(8) Il est d'ailleurs significatif que les rares descriptions générales voire apocalyptiques (cf. p. 185) du déchaînement de l'horreur se réalisent par le biais de références littéraires ou picturales, qu'il s'agisse de Dante (cf. p. 128) ou de Breughel (cf. p. 141), quasiment obligées. À ce propos, remarquons que l'auteur mentionne encore T. S. Eliot (cf. p. 155) et Shakespeare, surtout sa pièce la plus noire, Macbeth, dont il cite plusieurs vers en anglais (cf. p. 248).
(9) Dont la nature universelle autant qu'impalpable est évoquée comme elle le serait dans un récit fantastique : «Des après-midi terribles, après-midi de peur et d'épouvante silencieuse. Cette terreur était dans l'air, elle descendait et montait et descendait encore, à chaque fois elle appuyait un peu plus fort, sans à vrai dire se communiquer, elle ne menaçait pas, se contentait de planer» (p. 156).
(10) «Le Mal véritable ne chuchote pas pater peccavi» (p. 179).
(11) Intéressante à ce titre est cette notation qui a trait à un portrait de femme peint par Piero di Cosimo : «elle [Qimonetta Vespucci] regarde un mystère, je la vois regarder le mystère, je ne vois pas le mystère, et les historiens d'art ne voient ni elle ni le mystère» (p. 222).
(12) Rappelons que la première de couverture de l'édition originale de Masante indiquait la mention roman qui fut supprimée en 1975 puis rétablie en 1988.
(13) Il est à ce titre frappant de constater que l'auteur inscrit la trame de son texte dans l'évocation de plusieurs saints et qu'il fait ainsi référence au temps chrétien sacré dont l'Église a la garde.
(14) Constat qui contrebalancerait ainsi le relatif optimisme par lequel Jean-Yves Masson clôt ses pages de présentation de l'auteur et du roman et où il déclare de Masante, assez justement, qu'il s'agit d'un texte «sans doute inachevable, achevé pourtant, où se lisent le deuil et l'ambition du «chef-d’œuvre» désormais interdit et le refus de critères de la «réussite» littéraire. Chef-d’œuvre pourtant, et de premier plan, où la fiction incendiée ne cesse de renaître de ses cendres, et dont la fin, malgré tout, réveille l'espoir d'un prochain retour vers Urbino, la ville d'Italie où se conserve intact le souvenir d'un âge où l'esprit occidental entrevit dans sa plus grande clarté le rêve d'un séjour harmonieux de l'homme sur la terre» (p. 253).


























































 Imprimer
Imprimer