« De la révolution conservatrice en Allemagne. Bilan d'une recherche, 2, par Jean-Luc Evard | Page d'accueil | Céline et Wagner : encore l'indignité du génie ?, par Thierry Guinhut »
25/03/2011
Au-delà de l'effondrement, 30 : En attendant les barbares de J. M. Coetzee

Crédits photographiques : Sucheta Das (AP/SIPA).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.
Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.
Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.
Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
__
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
Constantine Petrou Photiades Cavafy, Περιμένοντας τους Bαρβάρους.
«Les Barbares tardent bien à venir !... Que fait donc Attila ?»
Introduction, par Henri Lasserre, à L'homme. La vie. La science. L'art d'Ernest Hello (Librairie académique Didier, Perrin et Cie, Libraires-éditeurs, 1894, p. IV).
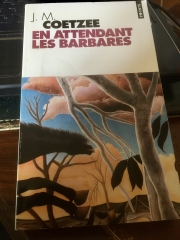 En attendant les barbares de J. M. Coetzee se rattache à cette poignée de livres singuliers, difficiles à caractériser tant ils paraissent flotter dans nos bibliothèques plutôt que d'y être dûment rangés, comme déliés de leurs amarres, que sont Sur les falaises de marbre, Le Désert des Tartares, Le rivage des Syrtes et, moins connu que ces titres fort célèbres, un peu trop célèbres même, Les Jardins du désert de Charles Bertin, publié d'ailleurs à la même époque que le roman de Coetzee, au tout début des années 80. Dans chacun de ces ouvrages, la thématique du temps est à l'évidence obsédante. Passionnante serait la lecture comparée qui nous préciserait, entre ces œuvres et sur cette question, les points d'accord et de dissemblance. Nous verrons que le roman de Coetzee s'inscrit lui-même dans cette dimension même si, à la différence des Falaises de marbre de Jünger, non seulement le bien n'y triomphe point des puissances mauvaises mais le temps demeure une puissance impénétrable, inhumaine, qui jamais n'offre la halte rassurante de la contemplation, voire l'immersion quasi mystique en son flot. Le livre de Coetzee est trouble, oppressant, énigmatique. Les espaces décrits lors de l'expédition du Magistrat sont grandioses et pourtant la lecture de ces pages provoque l'angoisse, l'angustia ancienne qui évoque un resserrement de la poitrine, la marche tout en bas du défilé depuis les hauteurs duquel le danger, inconnu et foudroyant, peut subitement tomber.
En attendant les barbares de J. M. Coetzee se rattache à cette poignée de livres singuliers, difficiles à caractériser tant ils paraissent flotter dans nos bibliothèques plutôt que d'y être dûment rangés, comme déliés de leurs amarres, que sont Sur les falaises de marbre, Le Désert des Tartares, Le rivage des Syrtes et, moins connu que ces titres fort célèbres, un peu trop célèbres même, Les Jardins du désert de Charles Bertin, publié d'ailleurs à la même époque que le roman de Coetzee, au tout début des années 80. Dans chacun de ces ouvrages, la thématique du temps est à l'évidence obsédante. Passionnante serait la lecture comparée qui nous préciserait, entre ces œuvres et sur cette question, les points d'accord et de dissemblance. Nous verrons que le roman de Coetzee s'inscrit lui-même dans cette dimension même si, à la différence des Falaises de marbre de Jünger, non seulement le bien n'y triomphe point des puissances mauvaises mais le temps demeure une puissance impénétrable, inhumaine, qui jamais n'offre la halte rassurante de la contemplation, voire l'immersion quasi mystique en son flot. Le livre de Coetzee est trouble, oppressant, énigmatique. Les espaces décrits lors de l'expédition du Magistrat sont grandioses et pourtant la lecture de ces pages provoque l'angoisse, l'angustia ancienne qui évoque un resserrement de la poitrine, la marche tout en bas du défilé depuis les hauteurs duquel le danger, inconnu et foudroyant, peut subitement tomber. En attendant les barbares peut être lu comme l'histoire de multiples dépossessions ou plutôt, comme l'histoire d'une dépossession unique dont les stations seraient nombreuses, le personnage principal du livre tout autant que le lecteur étant conviés au sommet d'un Golgotha de toute façon parfaitement inaccessible. Non point, comme le classique roman d'Ursula K. Le Guin intitulé bellement Les Dépossédés mais plutôt : La Dépossession, son ultime manifestation étant peut-être celle qui rend la lecture de ce livre difficile, décevante. Quelque chose ne nous est pas donné, nous est retiré en cours de route.
Dépossessions qui sont comme autant de pelures d'oignons ne découvrant aucun secret, ou alors nous laissant, imbéciles, face aux questions que soulève le livre de Coetzee.
Ainsi, les militaires envoyés par le puissant Empire que nous décrit ce roman que nous pouvons qualifier d'uchronie craignent l'arrivée de barbares qui ne viennent jamais, du moins en masses armées, comme ils ne se dessinent jamais sur l'horizon vide que contemple, du haut de son fort, Giovanni Drogo. Nous n'en apercevons que quelques-uns de ces barbares, vieillards, femmes et enfants sales, rôdeurs, humbles pêcheurs qui accueilleront le Magistrat, une fois sa destitution consommée, et partageront avec lui leur maigre pitance. Même lancé sur leurs traces, le personnage principal du roman de Coetzee ne les verra que se déplaçant sur l'extrême bord de l'horizon, comme s'ils n'étaient que des mirages. Peut-être, effectivement, qu'ils le sont. Le Magistrat justement, qui est le représentant impérial exerçant son autorité dans un fort se trouvant aux marches de l'Empire, essaie de s'incarner dans le rythme naturel d'un monde et n'y parvient pas. En tant que représentant légal d'un Pouvoir dont nous ne voyons que les lointains prolongements, en tant qu'homme civilisé donc, il serait d'ailleurs ridicule pour lui d'espérer vivre avec les peuplades barbares qui, elles, suivent le rythme de la nature.
Ainsi encore, il a bien essayé, durant des années, de coïncider avec l'Histoire, le temps inventé par l'Empire, qui donne un sens à l'absurdité cérémonielle du temps barbare : «Pourquoi n'avons-nous pas pu vivre dans le temps comme des poissons dans l'eau, comme des oiseaux dans l'air, comme des enfants ?», se demande le Magistrat (p. 215). Et la réponse, immédiate et déchirante pour lui, le représentant d'un Pouvoir qui a gauchi le temps, fuse dans son esprit : «C’est la faute de l’Empire ! L’Empire a créé le temps de l’Histoire. L’Empire n’a pas situé son existence dans le temps uni, récurrent, tournant, du cycle des saisons, mais dans le temps déchiqueté de l’ascension et de la chute, du commencement et de la fin, de la catastrophe. L’Empire se condamne à vivre dans l’Histoire et à conspirer contre l’Histoire. Une seule pensée occupe l’esprit submergé de l’Empire : comment ne pas finir, comment ne pas mourir, comment prolonger son ère» (pp. 215-6). Le temps déchiqueté de l’ascension et de la chute... Le Magistrat, lui, sans connaître aucune ascension, sera jeté à terre et torturé.
Notre personnage, tout autant que l'un de ces barbares vêtus de haillons, est un paria et sa disgrâce, le traitement inhumain que lui réservent les émissaires du pouvoir central, prouvent qu'il n'est pas parvenu à devenir un bon citoyen de l'Empire, comme il a échoué à s'adapter aux cycles de la nature. Il est donc par deux fois cruellement dépossédé de ses plus nobles rêves mais sa disgrâce ne s'arrête pas là. Il tente de déchiffrer de mystérieux signes gravés sur des languettes de bois, ultime trace d'une civilisation passée, et n'y réussit pas, se contentant, à la fin du roman, de les enduire d'huile de lin, de les emballer dans de la toile cirée et de les remettre là où il les a trouvées, pour que des habitants futurs les découvrent et, ainsi, ne sachent rien du bref épisode qui l'aura vu lui-même naître et mourir. Enfin, ultime désillusion pour notre personnage, il tente d'aimer une femme barbare qui ne lui plaît pas physiquement. Il se contentera de la ramener à son peuple, sans jamais avoir réellement pu communiquer avec elle, encore moins être parvenu à comprendre (avant qu'on ne les lui inflige) les tortures qu'elle a dû endurer de la part d'un émissaire fanatique de l'Empire.
De ces multiples dépossessions qui font, du roman de Coetzee, une espèce de révélation sans cesse procrastinée voire, tout simplement, refusée, l'une m'intéresse tout particulièrement : celle qui refuse au Magistrat la compréhension de la multitude de signes qui l'entourent. Jusqu'aux dernières pages de ce singulier roman, le Magistrat sera celui qui est en effet «conscient de mal interpréter les signes» (p. 241). Ces signes ne sont pas simplement ceux que de mystérieux habitants ont gravés sur de petites tablettes que le Magistrat essaie de déchiffrer, jusqu'à tenter de les lire dans un miroir (p. 30). Ces signes sont aussi ceux que l'émissaire de l'Empire et ses sbires ont tracés dans la chair de la jeune femme qui deviendra, un temps, la compagne du Magistrat. Ce dernier affirme qu'il la retiendra le temps de parvenir à déchiffrer cet alphabet de la souffrance (p. 54), quitte à suspecter, entre lui-même et le bourreau de son étrange compagne, une trouble complicité (1) : le tortionnaire n'est-il pas, après tout, comme l'amant, l'homme qui connaît le plus intimement la femme livrée à son savoir ténébreux et répugnant ? N'est-il pas celui qui écarte la chair et expose l'âme à la lumière (p. 191) ?
Finalement, confus, le Magistrat estime que les châtiments infligés par les délégués de l'Empire n'ont pas pénétré suffisamment profond la chair de sa rétive proie (p. 107). Les marques de la souffrance la plus extrême ne sont tout simplement pas visibles, de même que les murs d'une cellule où des hommes ont été torturés ne livrent rien de leur maléfique savoir (p. 132). Le monde que décrit Coetzee, s'il est magnifique de signes naturels et artificiels, n'en demeure pas moins hermétiquement fermé, à l'inverse de ce qui arrive dans certains des univers de cauchemar qu'aime peindre Lovecraft. Damnée ou sainte, la terre qui se lève en longues rafales pulvérulentes dans le roman de Coetzee est impénétrable, comme l'est du reste la femme barbare.
Le Magistrat ne sait pas lire les signes pourtant répandus d'abondance autour de lui, tout comme il est incapable de déchiffrer le sens d'un rêve mystérieux qui nous accompagne dès la première page du roman de Coetzee, rêve qui, lui aussi, ne débouchera sur aucune révélation.
Il continue toutefois de chercher ces signes, notre drôle de bonhomme dur et plein de bonté, sur les murs d'une pièce où quelques barbares ont été torturés (p. 61); il tente même de les lire comme une vieille femme déchiffrant les énigmes dans les feuilles de thé (p. 74) et Coetzee, fort ironiquement et même diaboliquement, nous fait comprendre que la douleur, même éprouvée intimement par sa propre chair, est un savoir aveugle.
Nouvelle déception. Que saura en effet le Magistrat de la souffrance d'une barbare torturée et rendue à moitié aveugle lorsque, lui-même, dans son propre corps, aura passé entre les mains expertes des représentants de l'ordre qui ne semblent même pas pressés de le faire avouer une ridicule entente avec l'ennemi ? Qu'apprendra-t-il de cette expérience extrême qui, pour le coup, l'aura livré à une troisième espèce, monstrueuse, de temps, ni artificiellement instaurée par les hommes, ni naturelle, mais le fruit maudit de leur dépravation, le temps de la souffrance ? À peu près rien, sa pauvre histoire d'homme humilié semblant contredire la vérité terrible qu'expose Jean Améry lorsqu'il écrit : «Celui qui voudrait faire comprendre à autrui ce que fut sa souffrance physique en serait réduit à la lui infliger et à se changer lui-même en tortionnaire» (in Par-delà le crime et le châtiment, Actes Sud, coll. Babel [1995], 2004, p. 82).
Le Magistrat a vite eu l'intuition qu'une mince pellicule le séparait de son bourreau; il eût pu, parfaitement, devenir un de ces agents zélé de l'État. L'inversion de la proposition n'a finalement que peu d'importance : torturé, le Magistrat n'en sait pas plus, non seulement sur sa souffrance, mais sur sa tentation de devenir bourreau. Quel est donc ce monde cassé où aucune expérience n'est assurée de nous délivrer un enseignement, fût-il infime ?
Cette impossibilité de lire les signes et surtout les comprendre, incapacité véritablement tragique mais que l'art de Coetzee déplace plutôt du côté d'une ironique mélancolie, est peut-être apte à nous livrer de nouvelles clés interprétatives d'En attendant les barbares.
En effet, n'est-ce point elle qui est également responsable du caractère incompréhensible du temps, que l'Histoire même de l'Empire n'ordonne que d'une façon illusoire, comme nous l'avons vu, édifiant, au besoin (un besoin pressant...), un ennemi qu'il revêtira de tous les maux et combattra à seule fin de prouver qu'il existe ? Ainsi le Magistrat se décrit-il comme un homme entre deux eaux, pas assez sot pour rejoindre une tribu nomade et vivre à son rythme, pas assez savant ou vicieux pour s'immerger avec délices dans le temps historique des hommes civilisés ou décadents, c'est d'ailleurs la même chose : «L’espace est l’espace, la vie la vie, partout semblable. Mais moi, entretenu par le labeur d’autrui, dépourvu de vices civilisés qui combleraient mes loisirs, je dorlote ma mélancolie et tente de déceler dans le vide du désert une acuité historique particulière» (p. 31).
Le désert, comme la chair d'une femme, est un livre qui ne peut se lire, hélas, et la seule façon de tenter de comprendre quelque chose à l'un comme à l'autre est d'en devenir le maître. D'ailleurs, n'est-ce pas aussi en se prétendant le maître du temps que l'homme marque au fer rouge sa création la plus chimérique, l'Histoire ? N'est-ce pas, comme le pense le Magistrat, le fait d'instituer un commencement là où il n'y a que chaos, bruit et fureur, qui donne sa grandeur à l'homme et le fait sortir de son cloaque sans histoire, au sens propre de cette expression, puisque privé de temps, de début et de fin ? Cette grandeur, bien sûr, est sanglante (2), de même qu'est sanglante l'idée, que le Magistrat ne condamne pas franchement, d'un Sauveur qui clôturera le temps par une violence qui au moins aura la vertu d'insuffler une nouvelle vigueur au vieux corps perclus : «Et qui suis-je pour ricaner d’illusions qui aident à vivre ? Est-il meilleure façon de passer ces jours ultimes que de rêver d’un sauveur, l’épée brandie, qui disperserait les armées ennemies, nous pardonnerait les erreurs commises par d’autres en notre nom et nous accorderait une seconde chance de bâtir notre paradis terrestre ?» (p. 231).
Finalement, la vérité du Magistrat est torve, comme l'est le monde qui l'entoure, et c'est bel et bien dans ce caractère louche du personnage que réside la beauté du roman de Coetzee : il ne peut se ranger du côté des barbares, même s'il finira par comprendre qu'il a fait beaucoup souffrir celle qu'il a lavée, soignée, recueillie auprès de lui, tenté, même, d'aimer, avant de la reconduire auprès des siens, à l'extérieur, hurlant, de la ville ceinte de remparts. Il ne peut pourtant pas, en tant qu'amateur, en tant que passionné d'histoire s'opposant à l'esprit de sérieux du fonctionnaire se contentant d'appliquer la loi sans chercher à l'interpréter, le Magistrat ne peut donc pas se ranger du côté de l'autorité, de l'Ordre, incarné par exemple par la figure, inquiétante et ridicule, du colonel Joll. Encore moins se trouvera-t-il du côté de l'Empire lorsque, déchu de ses droits, convaincu de complicité avec l'ennemi, il sera torturé par ceux-là mêmes qu'ils a accueillis dans sa ville fortifiée alors qu'ils sont chargés de la défendre contre d'invisibles assaillants. Les barbares ne seraient-ils pas en fin de compte, comme semble nous le suggérer le romancier, ceux qui, obsédés par un ennemi qu'ils n'ont jamais vu, n'hésitent pas à recourir à la torture contre leurs propres pairs ? Ainsi le Magistrat, qui n'a fait souffrir personne, du moins physiquement, peut-il affirmer, non sans une pointe de prétention (Coetzee use ici d'une ironie toute conradienne) : «Que du moins l’on dise, si l’on en vient un jour à le dire, s’il existe un jour, dans un lointain avenir, quelqu’un que notre façon de vivre intéresse : dans cet avant-poste extrême de l’Empire de la lumière, il y avait un homme qui, dans son cœur, n’était pas un barbare» (p. 170).
Cette vue est pourtant sommaire, car, tout au long de notre roman, le Magistrat stigmatise les mœurs barbares, notant quelques vérités qui, bizarrement, ne semblent point avoir ému les commentateurs de notre roman qui n'ont pourtant jamais manqué d'évoquer la situation de l'Afrique du Sud pour expliquer l'œuvre de Coetzee : «Comment pouvons-nous gagner une telle guerre ? À quoi servent les opérations militaires conçues d’après les manuels, les offensives, les raids de représailles au cœur du territoire ennemi, quand nous pouvons subir chez nous une saignée mortelle ?» (p. 163). Nul irénisme, c'est le moins que l'on puisse dire, dans cette sentence de l'écrivain : le barbare pue, il vole, il vit comme un chien et notre Magistrat, aimant les hommes comme il se doit, n'est du moins pas affligé par le mal curieux qui semble avoir pris possession des esprits de tant de nos contemporains lorsqu'ils évoquent les hordes crasseuses des miséreux qui par tous les moyens tentent de venir en Europe, cette terre fatiguée qui leur semble encore constituer un Eldorado.
Cette saignée mortelle est celle que les barbares, véritable cinquième colonne de l'Empire puisque certains d'entre eux se sont installés au sein même de la ville gouvernée par le Magistrat pour tenter de vivre maigrement de leurs produits, peuvent bien évidemment infliger à leur ennemi insouciant et fier de son prestige militaire et moral.
Le mal, voici une vérité que tout écrivain d'un peu de talent a faite sienne, est le cœur des ténèbres que chacun d'entre nous cache au plus intime de son être. La grandeur et la misère du Magistrat est d'avoir osé explorer son propre gouffre, comprenant qu'il ne comprenait rien, ne savait rien, n'était ni bon ni mauvais mais capable de bonté tout comme de méchanceté. En un mot, le Magistrat est un homme dont le faible cri est emporté par le fracas mécanique de l'Histoire tout comme il est noyé dans le flot déchaîné d'un temps sans raison ni but. L'attente est un leurre, tout comme le sont les barbares car l'énigme, si difficile et peut-être même impossible à déchiffrer, est celle de notre propre cœur de ténèbres.
Notes
(1) «Se lave-t-il les mains très soigneusement, par exemple, ou change-t-il de vêtements ? Ou bien le Bureau a-t-il créé des hommes nouveaux, capables de passer sans malaise de la souillure à la pureté ?», in J. M. Coetzee, En attendant les barbares [1980] (traduit de l’anglais par Sophie Mayoux, Seuil, coll. Points, 2000), p. 25.
(2) «Ce sont les hommes nouveaux de l’Empire qui croient aux commencements immaculés, aux nouveaux chapitres, aux pages blanches; je continue tant bien que mal l’histoire ancienne, espérant qu’elle me révélera avant de s’achever ce qui a pu me faire croire qu’elle en valait la peine» (p. 44).




























































 Imprimer
Imprimer