« Les Saules d'Algernon Blackwood, Stalker d'Arkadi et Boris Strougatski | Page d'accueil | Lettre ouverte au Juif imaginaire, par Jean-Luc Evard »
26/06/2010
L'Imposture de Georges Bernanos

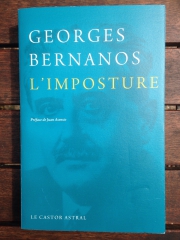 Acheter L'Imposture sur Amazon.
Acheter L'Imposture sur Amazon.S’il est un écrivain qui reste à découvrir, c’est bien Georges Bernanos, comme je l’écrivis pour Famille chrétienne (n° 1589, 28 juin - 4 juillet 2008). Aucune lecture n’a épuisé la formidable richesse de son œuvre, comme je viens de le constater de nouveau, en relisant pour la sixième fois L’Imposture, un roman d’une violence inouïe, une plongée dans la conscience d’un prêtre renégat, absolument unique dans la littérature française, dont je viens d’achever la préface pour Le Castor Astral qui réédite tous les ouvrages du Grand d'Espagne : L'Imposture devrait ainsi paraître durant la seconde quinzaine du mois de juin.
Quel incroyable roman, hélas moins connu que le premier, Sous le soleil de Satan paru en 1926 et, bien sûr, l’admirable Journal d’un curé de campagne. J'espère ne vexer aucun écrivain vivant (à vrai dire, je m'en fiche un peu) mais il me semble parfaitement évident que Bernanos n'a eu aucun héritier direct, hormis, peut-être, sur le versant polémique de son œuvre prodigieuse, Pierre Boutang, et je serai tout à fait incapable de trouver, dans la France contemporaine, un auteur dont les romans atteindraient la puissance hallucinatoire de ceux du Grand d'Espagne.
Quelle apocalypse, en effet, opposer, si ce ne sont les cauchemars d’un Dostoïevski ou d’un Céline, à celle que nous oblige à fixer un auteur ayant contemplé la prodigieuse fermentation du monde moderne de laquelle naquit l’abbé Donissan, sorti des tranchées de la Grande Guerre tout fumant de sang ? Quelle plus parfaite illustration convoquer d’un hermétisme démoniaque, à l’œuvre d’ailleurs dans L’Imposture, qui ne soit celle des plus grands, Shakespeare dans Macbeth, Barbey d’Aurevilly dans Une Histoire sans nom, Gadenne dans Le Vent noir ? Quelle puissance d’évocation du Mal, sous les plumes d'un Ernesto Sabato ou d'un Hermann Broch, pourrait ridiculiser la véritable vision du néant que Bernanos subit puis maîtrise, au prix d’années d’un travail acharné, dans Monsieur Ouine qui est sans doute le plus grand roman français du XXe siècle ? Quel plus farouche contempteur de la lâcheté dresser sur les barricades si ce n’est Bergamín qui salua l’auteur des Grands cimetières sous la lune comme un frère d’armes ? Quel plus formidable peintre de la lumière, surtout lorsqu'elle est intensifiée par des béances de ténèbres, imaginer si ce n’est Rembrandt ?
Georges Bernanos a eu peu de maîtres et encore moins d’égaux, aucun héritier de nos jours je l'ai dit, même s'il existe bien évidemment des romanciers de grand talent, qui sans doute lui doivent une partie de leur souffle, comme Didier Séraffin, Jean Védrines, Sébastien Lapaque et Julien Capron.
Georges Bernanos est ainsi, comme les plus grands écrivains le sont, devant nous.
Intégralité de ma préface, intitulé Les disciplines de l'imposture
C’est par un brutal coup de dague que nous pénétrons dans le deuxième roman de Georges Bernanos, L’Imposture, qui tout entier ressemble à une horrible blessure que l’écrivain semble ne point vouloir refermer. Violence bien réelle puisque, pour le romancier, les batailles de l’âme sont sans doute bien plus brutales que celles que les corps se livrent entre eux. Violence fascinante dont André Malraux, qui admirait Bernanos, se souviendra peut-être en y ajoutant les sucs vite éventés de l’érotisme, lorsqu’il fera s’interroger Tchen devant la fameuse moustiquaire qui lui cache l’homme qu’il faut assassiner, «moins visible qu’une ombre» sous le «tas de mousseline blanche» tombant du plafond. Il s’agit en tout cas de détruire, ici en lardant d’implacable ironie l’esprit d’un pauvre type, Pernichon, qui se joue la comédie et finira par se suicider, là en enfonçant une lame bien réelle dans une chair endormie, avec l’unique volonté de s’en débarrasser de la façon la plus rapide et, si possible, sans bagarre ni bruits, sans faire le plus petit scandale. Un éclair en somme, trouant les ténèbres qui auront vite fait de happer de nouveau les personnages qu’elles ont laissé s’échapper le temps d’une scène mémorable. Bernanos fouaillant la conscience d’un publiciste, puis plaçant sur le chemin nocturne de Cénabre un mendiant qui sera son double misérable; Malraux contractant dans La Condition humaine les muscles de Tchen autant que sa volonté : les grands romanciers semblent être ceux capables de fixer sur le papier des scènes fulgurantes, quitte à tenter ensuite de transformer en véritable orage ces explosions de chaleur sourdes et éphémères.
De fait, la pauvre âme de Pernichon crève sous le regard minéral, tranchant comme un couteau, de celui qui reçoit, avec dégoût et colère, la confidence de son misérable tas de petits secrets et de fautes imaginaires. Cénabre, à la différence de Chevance dont le nom même affirme la bonté et la garde du bien d’autrui, ne veut, lui, absolument rien recevoir des autres, une fois sa curiosité dévorante satisfaite. Dans les premières pages surprenantes de L’Imposture qui, comme une sonde, descendent à très grande vitesse dans les profondeurs de l’âme humaine, Cénabre révèle sa stature puissante de maître à l’ironie complexe, au savoir froid et altier, qui a tenté un pari aussi fou qu’impossible : «écrire de la sainteté comme si la charité n’était pas.» Il n’est assurément point, tel Pernichon, un médiocre qui se donne au plus offrant. Pourtant, quelques subtiles notations nous font vite comprendre que la médiocrité du fameux auteur des Mystiques florentins n’est guère différente de celle que sa pauvre marionnette a senti exploser comme une bulle de gaz sous le feu de son confesseur. Plutôt qu’un véritable imposteur, Cénabre se révèle, pour ainsi dire, un génial médiocre. Il est peut-être même le médiocre par excellence selon Bernanos, en tous les cas l’ébauche la plus convaincante de Monsieur Ouine. En ce miroir déformé qu’est Pernichon, Cénabre a reconnu son propre visage grimaçant de douleur, comme il reconnaîtra dans le mendiant Framboise un double avili, alors qu’il contemplera le mensonge du vagabond «du même regard avide qu’il eût regardé sa propre conscience». En fin de compte, malgré ses livres savants qui tournent autour des vies de saints sans jamais oser pénétrer dans leur cœur, il n’est qu’une pauvre âme fuyant la lumière de sa propre lucidité. Aucun partage possible entre les personnages de Bernanos, Cénabre, Pernichon et le mendiant, mais ce constat est également valable pour bien d’autres ombres parcourant les pages de L’Imposture : tous ces fantômes semblent s’adresser à quelque témoin muet qu’ils implorent secrètement d’une délivrance qui jamais ne viendra.
Que sont donc ces pages qui ouvrent L’Imposture ? Assurément moins une confrontation entre Cénabre et son protégé ridicule, le sordide Pernichon, qu’un combat entre le prêtre et le timide Chevance, le «confesseur de bonnes» à l’autorité spirituelle foudroyante. Si le double est traditionnellement l’une des figures spéculaires les plus évidentes de Satan, celui que nous pourrions a contrario appeler le frère (ou la sœur, bien sûr), Chevance puis Chantal, est le véhicule de la grâce qui libère. Et c’est peu dire qu’avec une véritable rage, le romancier ferme les unes après les autres les portes qui emprisonnent ceux qu’un autre écrivain, Julien Green, nommera des épaves. Pernichon, Catani, Mgr Espelette et Guérou à la trouble réputation, Framboise et Cénabre : autant de personnages littéralement rentrés en eux-mêmes, tombés dans un réduit où ils demeurent prostrés, incapables de faire éclater la bulle pestilentielle depuis laquelle ils contemplent une réalité déformée par leurs envies, leurs complots, leurs mensonges, leurs sordides manœuvres. C’est le même vide qui réunit ces hommes creux dans une communion pourtant impossible. La médiocrité est l’unique pain que rompent ces damnés que Bernanos condamne à une pure et simple disparition, sans appel (ni rappel) sur la scène romanesque.
Nous pourrions lire ces pages comme le prolongement et l’exploration acharnée d’un de «ces drames cachés, étouffés» que Barbey d’Aurevilly illustra dans ses Diaboliques ou dans Une histoire sans nom. Elles constituent quoi qu’il en soit l’une des plus troublantes introspections psychologiques et spirituelles que le roman français moderne nous a données. Le coup de sonde génial que Bernanos lance dans les mobiles les plus profonds de Cénabre est bien trop lucide pour que nous ne puissions soupçonner, de sa part, une condamnation indirecte des pouvoirs inquisitoriaux de tout grand écrivain, comme le théologien Hans Urs von Balthasar et Max Milner l’avaient remarqué. En ouvrant l’âme de Cénabre comme on ouvre un fruit, Bernanos ne nous convie pas seulement au juteux festin qui sera salué par ses confrères ou ses lecteurs. L’un d’entre eux, Antonin Artaud, que la scène de l’agonie de Chevance avait bouleversé, comprit d’ailleurs que Bernanos, son «frère en désolante lucidité», avait dû lui-même beaucoup souffrir pour écrire semblable œuvre. Sous les regards de ses lecteurs fascinés, l’écrivain dispose en fait ses propres entrailles. Il désigne les ruses par lesquelles le romancier de génie est le moins dupe de ses pouvoirs de vision. Ce n’est ainsi pas sans raison que Bernanos a écrit dans Les Enfants humiliés que L’Imposture lui avait coûté beaucoup de peine, objectant même, contre la réalité purement humaine de l’imposteur, des doutes radicaux : «Je ne crois plus aux imposteurs depuis que j'ai écrit L’Imposture, ou du moins je m’en fais une idée bien différente. [La] dernière ligne écrite, j’ignorais encore si l’abbé Cénabre était oui ou non un imposteur, je l’ignore toujours [...]. Pour mériter le nom d’imposteur, il faudrait qu’on fût totalement responsable de son mensonge, il faudrait qu’on l’eût engendré, or tous les mensonges n’ont qu’un Père, et ce Père n’est pas d’ici» (1). Pas étonnant que les pauvres hères dont ce roman nous fait contempler la noria monotone ne puissent se décharger de leur fardeau imaginaire, leur ridicule chevance. Pas étonnant non plus, à l’exemple de Pernichon, qu’ils soient liquidés en quelques mots par un écrivain en apparence insensible à leur sort qui évoquera le probable suicide du journaliste comme, d’un geste de la main, on chasse une pensée importune ou encore un moucheron.
Ces pages sont peut-être enfin un théâtre sur les planches duquel Dieu et diable se livrent bataille, puisque Cénabre et Chevance, nous dit Bernanos, «s’étreignaient dans le ciel». Dieu et diable s’affrontent, de même que «deux combattants qui se prennent à la gorge au-dessus d’un cadavre» qui n’est autre que celui du prêtre, comme si le romancier donnait une nouvelle vie aux mystères du Moyen Âge et nous indiquait, par la longue et belle évocation de la voix de la création (2), que le décor de son roman n’a de réalité qu’invisible et immémoriale. Ainsi, accompagner l’écrivain dans les plus secrètes contrées de l’esprit et de l’âme, c’est pénétrer dans un royaume dérobé à nos yeux de chair, dont la réalité semble cependant plus assurée que celle des rues où Cénabre erre durant une nuit. L’Imposture de Georges Bernanos, avant le crépusculaire Vent noir de Paul Gadenne qui paraîtra en 1947, nous convie à une marche harassante sur la terre vaine qu’arpentent sans relâche ni but les hommes à la cervelle remplie d’un peu de bourre, comme l’écrit T. S. Eliot. Cette exploration des ténèbres de l’âme humaine, bien sûr, n’est pas dépourvue de dangers, comme Gadenne nous le montrera dans son magnifique roman.
«Convenez cependant que je me suis bien avancé pour pouvoir, maintenant, reculer ?» Aussi banale que nous semble cette phrase lorsque Cénabre la lance avec dédain à Chevance qu’il a fait venir chez lui en pleine nuit, elle ne peut qu’éveiller l’écho d’une autre phrase, célèbre, prononcée par Macbeth devant son épouse : «I am in blood / Stepp’d in so far that, should I wade no more, / Returning were as tedious as go o’er», «Je suis dans le sang, enfoncé si profondément que, même si je n’y pataugeais plus, revenir en arrière serait aussi fastidieux qu’avancer». Macbeth avancera donc coûte que coûte et s’enfoncera dans son mauvais rêve, croyant peut-être aborder une terre au-delà du bien et du mal, jusqu’à ce que son cauchemar, les actes odieux qu’il a commis et leurs conséquences néfastes, soient dissipés comme une vapeur maligne par un rai de lumière. Il faudra la farouche décision, pour les hommes de bonne volonté, de se débarrasser de celui qu’ils appellent le tyran, il faudra même la marche, irréelle, d’une forêt tout entière s’avançant sur son château pour faire disparaître Macbeth le meurtrier. Défait, ce dernier aura les mots pitoyables de l’enfant qui trop tard mesure la portée de ses actes.
Cénabre lui aussi, nous confie Bernanos, semble ne plus pouvoir revenir des profondeurs qu’il a atteintes ni escompter «un arrêt dans la descente verticale», sans remonter chargé de précieux trésors, arrachés aux ténèbres. Non point, comme nous l’indiquerait une lecture trop hâtive de L’Imposture, l’indifférence ou même le néant, mais la joie, la joie sans retenue de celui qui n’a plus besoin d’aiguiser son mensonge quotidien à toutes les arêtes qu’une banale journée lui offrira d’abondance. Contre la volonté inébranlable et sèche du prêtre auprès de laquelle les regrets de Macbeth sonnent comme un véritable cri de libération, la lumineuse charité de deux âmes magnifiques, celles d’un humble prêtre et d’une jeune femme qui en vision contemplera l’apôtre félon, Judas Iscariote enfermé dans une solitude inconcevable, ne sera point de trop.
Enchaîné à ses résolutions comme Macbeth l’est à ses desseins, Cénabre est libre, aussi libre que l’est un damné. A-t-il trahi, comme le suggère la présence dans La Joie de la figure de Judas ? Il eût fallu pour cela avoir prêté allégeance, alors que Cénabre semble tenir pour billevesées les postulations baudelairiennes vers Dieu et Satan. Ne faisant plus qu’un avec son imposture, du moins en ayant pris la conscience la plus irrécusable, le prêtre sans foi peut ainsi jouir de «l’effusion de son affreux bonheur», même si, de sa joie, nul signe ne paraîtra sur son visage inexpressif.
Avant d’être tué, Macbeth reviendra à la raison, nous mettant en garde contre les «ennemis jongleurs («juggling fiends») qui nous ont enroulés dans le double sens» (cf. Acte V, scène 9). Cénabre, lui, avant de sombrer dans la folie, trouvera la force de prier le Père. C’est sans doute forcer le texte de Shakespeare que de supposer que le tyran aura eu le temps, d’une seule pensée tue, d’honorer à nouveau l’antique piété que le meurtre du roi Duncan a détruite dans son cœur «gorgé d’horreurs». Car c’est bien le geste impie de Macbeth qui a fait vaciller l’axe du monde, c’est bien le meurtre qu’il a commis qui fait que la nuit ne parvient plus à être dissipée par le jour. C’est son forfait inouï qui a transformé le bien en mal et inversement, alors que tous les animaux (3) deviennent des créatures enragées. La nature, déséquilibrée par l’assassinat du roi, bascule dans le chaos en raison de la folie d’un seul homme, que l’on dirait choisi avec grand soin par les puissances maléfiques. Dans l’esprit de Macbeth tourmenté gît la faille étroite par laquelle le poison subtil des sorcières va s’infiltrer, comme la lézarde minuscule finira par faire s’écrouler la majestueuse maison Usher dans le marécage qui s’étend devant elle. Dans sa geste la plus achevée, la pièce de Shakespeare nous présente le drame de la tentation, qui est celui de l’écart, tragique, entre la volonté et l’acte, le projet et sa conséquence funeste. À la différence de Macbeth, tout paraît consommé dans L’Imposture, bien que Georges Bernanos cherche sans relâche, dans les pages fébriles de son roman, à mettre le doigt sur cette faille pratiquement insoupçonnable qui a fissuré l’âme de Cénabre alors qu’il était encore jeune. Nous ne savons pas avec certitude si le prêtre, avant de sombrer dans la folie qui conclut les toutes dernières lignes de La Joie, a eu le temps de véritablement comprendre le sens de son aventure, et de quelle façon son imposture a pu bouleverser l’ordre invisible du monde. Peut-être a-t-il remis au Père, Lui adressant sa toute dernière prière, l’âme pure du petit enfant qu’il a été ?
Macbeth est un personnage que Shakespeare a peint avec beaucoup de subtilité comme un homme devenu prisonnier de son mauvais rêve, alors que, comme n’importe lequel de ses rudes compagnons, il n’a accompli aucun forfait notable avant de rencontrer les trois sœurs démoniaques qui paralyseront sa volonté par leurs paroles trompeuses. Macbeth est encore celui que Shakespeare a imaginé en héros maléfique ayant une parfaite conscience de ses pensées et actions, comprenant qu’il s’enchaîne irrémédiablement au mal qu’il est contraint de perpétrer pour faire advenir son rêve de puissance. La grandeur romantique dans le Mal semble cependant consommée, comme nous le montre le roman de Bernanos et, avant celui-ci, l’un des textes les plus connus de Joseph Conrad. Est-il ainsi exagéré de prétendre que Macbeth, dans Cœur des ténèbres, est devenu l’homme creux dont le seul pouvoir est celui de sa voix, Kurtz (4), réfugié au plus profond de la jungle où des sauvages l’adorent au sens propre du terme ? Ne peut-on en outre considérer que Macbeth est l’un des lointains ancêtres, encore tout rempli de bruit et de fureur, de Cénabre, ce personnage implacable et froid qui annonce la véritable «incarnation du néant» qu’est Monsieur Ouine ? C’est La Joie qui nous fera assister aux derniers instants de lucidité de l’auteur de La Vie de Tauler, tandis que L’Imposture nous le décrit tout entier livré à sa béatitude infernale, glacée : le prêtre a repoussé la main tendue de celui-là même, l’abbé Chevance, qu’il a appelé pour faire de lui le témoin de son hideux secret. Macbeth a cédé à la tentation, matérialisée par la prophétie (ou bien la ruse, nous ne le saurons jamais) des trois sorcières qui lui donneront les clés de son parodique royaume de crainte et de violence. Cénabre, lui, ne cède à rien puisque le diable a trouvé libre la place que l’Autre eût dû occuper dans l’âme et le cœur du prêtre; ce dernier, par une discipline de fer et un goût prodigieux pour le mensonge, les a aménagés pour en faire les tabernacles gardiens d’une présence de pacotille. Imaginons la scène : Chevance, qui comme Donissan dans Sous le soleil de Satan peut sonder les intentions les plus inavouables des êtres qu’il tient sous le faisceau de sa brûlante charité, aurait pu détourner de ses forfaits Macbeth, parce qu’en ce dernier la peur, la terreur, la pitié, la certitude de faire le mal en toute connaissance et volonté, maintiennent vivante son âme tourmentée. L’âme de Cénabre, elle, paraît absolument vidée de toute trace de louange ou de blasphème, comme Chevance le constate avec effroi : l’enfer que le prêtre renégat habite «est le plus froid».
Macbeth, Kurtz, Cénabre, Ouine : quatre figures de l’intériorité devenue vide, hermétique, démoniaque. Quatre personnages qui ressentent aussi un mystérieux appel du passé, puisque leur expérience semble s’inscrire sur un fond de ténèbres primordiales. Marlow remonte le puissant fleuve qui le mène vers Kurtz. Cénabre, lui, a l’impression de revenir à la source et de se diriger, en pénétrant dans la forêt de pierre d’un Paris endormi, vers le cœur du mal d’où vont se répandre, comme des eaux boueuses, le «petit peuple monstrueux, soudain tiré des limbes de la mémoire», ces «hommes oubliés que les caves et les prisons dégorgent tout à coup sur la ville, éblouis par la lumière, prudents, furtifs, se hâtant vers la clameur et l’incendie d’un pas silencieux». Macbeth, Kurtz, Cénabre, Ouine : en ces quatre noms de personnages inventés par trois grands écrivains, la destinée de l’Occident peut se lire, plus sûrement annoncée que par l’oracle ou même la prophétie qui auraient prédit l’avènement de l’homme creux.
«Je m’oriente toujours, écrit Georges Bernanos à son ami Pierre Belperron le 19 janvier 1938, comme dans les grandes circonstances, sur les visages imaginaires que je crois voir devant moi et que j’essaie d’ouvrir – par force ou autrement. Quand ils me souriront je m’arrêterai» (5). La foi toute simple de Chevance paraît se lire sur son visage et dans les gestes de son corps, dans «l’avidité sublime du regard» ou encore «la prière muette des mains», alors que le visage de Cénabre est «contracté» et que ses «traits immobiles» semblent «creusés dans la pierre», comme Bernanos l’écrira dans La Joie. D’ailleurs, le romancier a-t-il réellement vu ce visage d’un homme dont le nom évoque la dureté du règne minéral ? N’est-il pas quelque peu ridicule d’imaginer l’écrivain chercher du regard le sourire de Cénabre et, le temps de l’écriture tout au moins, refuser d’ouvrir «par force» l’âme du prêtre sans Dieu ? Inutile de faire remarquer que Bernanos malmène terriblement son personnage principal, qu’il le dénude sous une lumière intolérable, bien plus cruelle que celle que Joris-Karl Huysmans braque sur son héros Durtal lors de la grande scène de la tentation d’En route (6), qu’il faudrait mettre en évident rapport avec le premier chapitre de notre roman.
L’Imposture de Bernanos est par excellence le roman qui semble verrouiller toutes les issues par lesquelles son personnage principal, Cénabre, eût pu s’échapper. Avec une volonté qu’une lecture superficielle pourrait juger malsaine voire diabolique, il met en scène la dureté, l’emprisonnement volontaire, l’hermétisme démoniaque au sens que Sören Kierkegaard donnait à ces termes (7). Et en conséquence, il évoque également, avec tout autant de violence que lorsqu’il s’est agi d’emprisonner Cénabre, l’effraction, le vol, «l’ouverture involontaire» selon l’expression de Kierkegaard, c’est-à-dire une liberté qui ne débouche sur rien. Le prêtre inflexible est devenu le prisonnier de son seul mensonge, puis, l’ayant reconnu et pleinement accepté, du vide qui le remplit une fois qu’il a rejeté la présence divine, ou plutôt une fois qu’il a compris qu’il n’a jamais ressenti son manque intolérable. Comme le montre le très beau dernier film d’Ingmar Bergman, Saraband (qui met en scène le pauvre démon qu’est Henrik, tourmenté par son père qui le hait), il ne peut communiquer qu’en crachant son secret, en l’avouant, en le jetant à la face de celle ou celui qui deviendra son confident d’infortune. Il se livre «malgré lui», dans la haine et le mépris, sans nulle volonté de partage et de fraternité puisque «Le démoniaque est l’hermétisme et l’ouverture involontaire. Ces deux définitions signifient comme de juste la même chose; car l’hermétisme est précisément le mutisme, et, quand celui-ci doit s’exprimer, il faut que cela se fasse malgré lui […]» (8, l’auteur souligne).
Durant sa terrifiante nuit, Cénabre ne peut sourire mais rire, rire d’un rire démentiel qu’il commence par ne pas reconnaître. Il rit atrocement, d’une façon qui signe la présence d’un autre : il se vide plus qu’il ne se confie, il hurle davantage qu’il ne parle, il rit sans même pouvoir parvenir à maîtriser son rire (qu’il ne reconnaît plus). Sa main se saisit d’une arme qu’il retourne contre lui sans qu’il puisse retenir son geste. Cénabre est dépossédé de sa propre volonté, et même de son corps : «Je est un autre», assurément ! Quelle est la hantise, mais aussi peut-être le salut de celui qui est enfermé dans le cachot de l’hermétisme ? Kierkegaard répond : l’ouverture involontaire. De même Cénabre ne peut-il que cracher à Chevance son pathétique secret, comme une injure, au lieu de s’en remettre à lui. Juste avant de rencontrer le vagabond dénommé Framboise, le prêtre sans foi ne cessera de s’inquiéter du fait qu’un seul, Chevance, a vu son âme et la désolation dans laquelle elle demeurait. Dès lors, il s’agira pour lui de combler la brèche restée ouverte, de fuir la lumière, revenir à son horrible tranquillité d’âme et d’esprit, comme un avare referme ses mains sur le trésor, réel ou imaginaire, qui est le sien. Trop tard, puisque l’avare, ayant livré son précieux secret qui n’est rien de plus que le masque grimaçant de son imposture, ne possède littéralement plus rien.
Deux guides précieux peuvent nous aider à caractériser le mal qui ronge Cénabre. Ernest Hello, tout d’abord, dont Bernanos a découvert les livres dans les tranchées de la Grande Guerre. Dans un texte intitulé Le Veau d’or (9), Hello écrit sur l’avare et la lèpre qui le ronge des mots que nous pourrions appliquer à Cénabre : «La plupart des passions parodient les hauteurs et bavardent volontiers. L’Avarice parodie la profondeur; elle se tait avec passion. L’avare ne cache pas seulement son secret aux autres; il se le cache à lui-même. Il voudrait peut-être se tromper sur le lieu où est enfoui ce qu’il adore. Je ne serais pas étonné si l’avare arrivait à se craindre lui-même comme un rival, comme un voleur, tant l’adoration est jalouse ! Il y a peut-être en lui deux hommes, dont l’un a des secrets pour l'autre.» L’une des thématiques les plus évidentes de L’Imposture, nous l’avons écrit, est celle du double.
Kierkegaard ensuite, précieux cicérone lorsqu’il s’agit de s’aventurer sur le territoire pour le moins inhabituel du démoniaque, nous permet de comprendre ce que le prêtre timide et humble, Chevance, représente en vérité pour le prêtre renégat : «Le démoniaque est l’hermétisme, il est l’angoisse du Bien. Si nous appelons X l’hermétisme et que son contenu soit X, c’est-à-dire le comble du terrible ou de l’insignifiant, l’horreur dont bien peu d’hommes osent rêver la présence dans leur vie, ou la bagatelle à laquelle personne ne fait attention, qu’est-ce que signifie alors cet X qu’est le Bien ? Il signifie l'ouverture» (10). Hélas, Cénabre refusant l’aide du frère qui pourrait le libérer, sera réduit, dans L’Imposture, à l’état de prisonnier volontaire et à ne pouvoir contempler que des reflets de sa propre déchéance.
L’enfer, écrit Bernanos, est pétrifié «dans son silence absolu»… Loin des célèbres et terrifiantes représentations médiévales, qu’elles soient littéraires ou picturales, le Catéchisme de l'Église catholique donne de l’enfer une définition étonnante par sa sobriété même, que l’on dirait animée d’une volonté purement technique de taxinomie : par le mot «enfer», est désigné un «état d’auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux» (11). Quelques lignes seulement après cette première définition, nous trouvons cette autre : «La peine principale de l’enfer consiste en la séparation éternelle d’avec Dieu en qui seul l’homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire.» En parlant, à propos de l’enfer, de «châtiment éternel» ou d’»éternelle expiation», Bernanos ne s’écarte donc point des termes les plus orthodoxes, même si, écrivain, ce sont d’autres images, plus habituelles (celle d’une prison circulaire, des ténèbres, de la haine) qui en précisent dans son roman les tourments inconcevables.
À lire ces lignes à la clarté douloureuse, rien ne peut être dit de la destinée surnaturelle qui attend Cénabre après sa mort : damné ou racheté par le sacrifice de Chantal de Clergerie et l’agonie de Chevance ? Ce débat n’a pas plus de sens que celui qui a conduit certains universitaires à plaider en faveur de Monsieur Ouine, afin, prétendaient-ils, de le racheter ! Stricto sensu, la réalité surnaturelle de l’enfer concerne uniquement la seule possibilité pour le pécheur, et par sa faute, de ne point désirer connaître la félicité promise à tous les hommes de bonne volonté. Quoi qu’il en soit de ces débats théologiques que le génie de Bernanos a laissé ouverts dans son roman, la définition de l’enfer en tant qu’»état d’auto-exclusion» s’applique merveilleusement au drame que vit Cénabre. En rejetant la dernière illusion qui lui faisait penser qu’il croyait en Dieu, en s’écartant volontairement du monde des hommes, en refusant l’aide du malheureux Chevance, le prêtre érudit se mutile, se débarrasse de l’ultime partie de son âme encore vivante. Il s’enferme (l’enfer enferme, écrit Jean-Luc Marion) ou, pour le dire en employant un terme de la vie monastique, il se retire.
Une fois encore sans le moindre ménagement, Bernanos nous plonge dans l’exploration inédite de cet enfer des médiocres et des lâches, loin des habituelles représentations médiévales, loin aussi de la tendance moderne ayant provoqué, dans l’esprit de nombre de penseurs, religieux ou non, l’émergence de très vives critiques à l’égard de la réalité de l’enfer. Sous la plume de Jean Elluin (12), nous pouvons ainsi lire que «la réduction d’un seul homme à un enfer total, fût-il de simple anéantissement» lui est apparue «de plus en plus clairement, comme contradictoire à l’Oméga universel de l’Amour, et à un vrai respect de notre liberté finie». Une telle critique, aussi légitime que la prudence des doctes le voudra, n’a pas lieu d’être selon le romancier, qui trouve, sur cette question pour le moins infernale, un allié de poids en la personne d’un autre écrivain, Julien Green. Pour l’auteur de Moïra, qui n’a pas craint de scandaliser ses propres lecteurs, l’enfer est l’une des marques de l’amour divin. Il note que «la charité divine a permis l’enfer», cette permission étant «inconcevable à la raison humaine, mais cela est, car si le créateur est charité, comme on nous l’enseigne, il faut bien que cette charité se retrouve dans son œuvre». La certitude que l’enfer existe est légitimée, sous la plume de Green, par une évidence tout aussi scandaleusement intolérable, parfaitement incompréhensible : l’infinie souffrance de Dieu versée pour empêcher qu’un seul pécheur puisse rester en enfer. Julien Green affirme en outre que «l’idée de l’enfer est peut-être plus enivrante que celle du paradis», puisqu’elle nous montre «notre âme à sa juste valeur, elle nous fait comprendre que ses fautes atteignent à des proportions surhumaines et que certaines d’entre elles sont absolument inexpiables» (13).
Bernanos aurait sans doute pu contresigner de telles phrases. Nous devons bien comprendre que les plus grands romans de l’écrivain inscrivent en leur cœur même ce mouvement qui porte un saint, Donissan, Chevance, le curé de campagne, à rencontrer un pécheur, à devenir «anathème» selon l’étonnante parole de saint Paul dans l’Épître aux Romains (en 9, 3). Nul, en effet, comme l’écrit le romancier dans L’Imposture, «n’est jeté à l’abîme, sans avoir repoussé, sans avoir dégagé son cœur de la main terrible et douce, sans avoir senti son étreinte». Cette magnifique inscription n’empêche point le doute, elle le conforte même, puisque Bernanos écrit dans son Journal d’un curé de campagne que «l’erreur commune à tous est d’attribuer à ces créatures abandonnées» que sont les damnés «quelque chose encore de nous, de notre perpétuelle mobilité, alors qu’elles sont hors du temps, hors du mouvement, fixées pour toujours. Hélas ! continue Bernanos, si Dieu nous menait par la main vers une de ces choses douloureuses, eût-elle été jadis l’ami le plus cher, quel langage lui parlerions-nous ? [...]. Le malheur, l’inconcevable malheur de ces pierres embrasées qui furent des hommes, c’est qu’elles n’ont plus rien à partager» (14).
Nous évoquions les paroles de saint Paul désirant devenir «anathème et séparé du Christ» pour sauver ses «frères» pécheurs, l’apôtre ne faisant que rappeler la volonté de Moïse (en Exode, 32, 32) qui, face à la colère de Dieu, offrit de se sacrifier pour que soient pardonnés ses proches. Bernanos trace dans son œuvre romanesque, en particulier dans L’Imposture, au-delà même de la certitude de ne pouvoir rien faire pour Cénabre en qui, selon Pierre Boutang (15), «l’orgueil du “même”, d’être créé pour le salut, fait oublier, puis nier la possibilité radicale de se perdre», ce remarquable mouvement de charité et d’amour. Aux yeux du romancier comme pour Hans Urs von Balthasar (16), «quiconque envisage la possibilité ne fût-ce que d’un seul réprouvé en dehors de lui-même, celui-là sera difficilement capable d’amour sans réserve».
Une fois de plus, c’est affirmer que Bernanos n’élude d’aucune façon l’incroyable violence qui œuvre dans L’Imposture. Ce livre est tout bonnement scandaleux. Je crois même qu’il va devenir de plus en plus scandaleux pour les yeux des lecteurs à venir, en ce sens qu’il ose imaginer que l’âme d’un seul homme, Cénabre, est l’enjeu d’un combat surnaturel implacable. Comment faire comprendre à l’homme creux qu’il reste, quelle que soit sa lâcheté et sa volonté d’être débarrassé de toute forme de croyance religieuse, l’unique casus belli entre les dieux eux-mêmes enfuis ? Comment faire comprendre aux écrivains contemporains qu’un romancier, sauf à se dédidre, ne peut abandonner sa propre créature à la damnation ?
Albert Béguin nous apprend dans quelles difficiles conditions Georges Bernanos a écrit son deuxième roman : «Fixé à Ciboure pendant l’été […], Bernanos écrit L’Imposture et y travaille d’arrache-pied malgré l’anxiété où le plonge durant quelques semaines de l’automne 1926 la condamnation de l’Action française par le Vatican. […] Long séjour à Amiens, chez ses beaux-parents, où il achève L’Imposture en mars 1927. Établissement à Clermont-de-l’Oise, place de l’Hôtel de Ville, où Bernanos a acheté une grande maison. Il s’y installe le 25 juillet 1927 et se met aussitôt à écrire La Joie, travaillant la plupart du temps au Café Français à Mouy. Il achèvera ce roman à Amiens, dans la semaine de Noël 1928, alors que L’Imposture a paru en octobre 1927» (17). Quelque étude existe peut-être montrant que, lorsqu’il écrit l’histoire du prêtre sans Dieu qu’est Cénabre, Georges Bernanos annonce la raison essentielle pour laquelle il finira par se séparer de Charles Maurras, même si, durant la composition de son roman, Albert Béguin nous rappelle qu’il s’est publiquement rapproché de l’Action française.
Le calendrier pour le moins riche en événements qui est celui durant lequel le romancier a composé L’Imposture n’explique sans doute qu’artificiellement l’impression étrange que laisse la lecture de cette œuvre énigmatique, que l’on dirait constituée de quatre blocs hiératiques plantés les uns en face des autres, incapables de faire cercle mais qui, pourtant, se reflètent subtilement. Difficulté, impossibilité même d’écrire L’Imposture qui devait à l’origine composer avec sa suite, La Joie, un seul livre. Échec que le romancier évoque en écrivant : «L’imposteur et l’imposture ne font qu’un, il y a une fatalité sous l’imposture […] Les disciplines de l’imposture ne sont pas moins strictes que les nôtres, l’imposteur ne dispose pas de son imposture comme il lui plaît […], toutes les impostures sont solidaires […]» (18).
Cette solidarité dans le péché est une idée pour le moins ancienne, remarquablement illustrée par la littérature qui a tiré, de la figure du double, un profit exceptionnel. Ainsi voyons-nous Bernanos multiplier, dans son roman, les apparitions de figures torves, en fait des doubles de Cénabre, alors même que le diable a disparu de la scène de L’Imposture. Intérioriser le démon, en voiler les manifestations, c’est paradoxalement faire de la chair humaine, mais d’une chair dégradée reflétée en l’autre, qu’il soit publiciste ou mendiant, le nouveau théâtre d’inconstance du mauvais ange. À la lettre, Cénabre ne peut s’échapper de sa prison parce que les visages des menteurs et des médiocres qu’il rencontre lui renvoient sa propre déchéance.
Dans son roman, Bernanos ne fait que reprendre, mais pour la porter à son point de perfection, la très ancienne tradition littéraire qui a soupçonné ou très clairement identifié, dans le personnage du double, le véhicule du diable, qu’il s’agisse d’exemples bien connus comme William Wilson d’Edgar Allan Poe ou la Confession du Pécheur justifié de James Hogg, qu’il s’agisse encore de romans où la figure du double s’est subtilisée, comme nous le voyons dans l’étonnant Maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson ou Les Élixirs du Diable d’E. T. A. Hoffmann. Parvenu au bout de ce long processus de décantation de la figure de Satan, Bernanos ne nous donne plus à voir ce dernier, qui s’est littéralement évaporé dans une communauté moins inavouable qu’impossible que formeraient les hommes creux, dont Cénabre n’est pas même le hiérarque mais un simple abcès de fixation. Si le diable, nœud gordien de l’imposture, a disparu, comment donner consistance à l’imposteur, qui honore à son corps défendant l’antique mensonge dont il ne peut et ne pourra jamais être tenu pour responsable ou, pour utiliser un terme évangélique, dont il ne sera jamais le père ? L’analyse de Pierre Gille part du constat, juste, d’une pulvérisation de la figure du diable pour l’étendre, faussement, à celle de Dieu : «L’imposture est la figure d’une réversibilité devenue si plénière que le rôle de Dieu, pour ainsi dire, est tenu par le diable lui-même. Mais déjà il n’y a plus ni Dieu, ni diable : ni Dieu parce qu’il est mort dans le cœur de ses ministres et donc de ses fidèles, ni diable puisqu’il est tout entier dans le comportement de ces mêmes ministres, dans cette politique ecclésiastique pour laquelle il n’y a plus ni Dieu ni diable... La perversion est autre... Quand la politique d’Église singe la responsabilité de l’Église, ce dépôt sacré, dans des compromis qui sont une parodie sacrilège du mystère de l’Incarnation, c’est Dieu qui se trouve lui-même compromis» (19).
Je doute que Dieu soit d’une quelconque façon «compromis» dans L’Imposture. Cette curieuse pétition de principe ne peut être reçue qu’à l’unique condition que l’on fasse de l’absence – qu’il conviendrait d’ailleurs davantage de nommer apophatisme – de Dieu dans les romans de Bernanos le rigoureux pendant de l’absence du diable, qui est comme s’il n’était pas, dont l’essence est de ne pas être. Si Dieu était compromis, cela signifierait bel et bien que c’est le comportement minable, caricaturé par Bernanos avec une méchanceté aussi indéniable que réjouissante, de cette faune composée des étranges créatures aux noms ridicules que sont MM. Le Doudon, Petit-Tamponnet, Hochegourde, Têtard, etc., qui aurait plus de poids que le sacrifice sur la Croix. Lecture parfaitement absurde ! C’est au contraire l’imposteur qui est pulvérisé dans notre roman, c’est bel et bien le diable qui est compromis dans cette affaire, du moins le diable romantique tel qu’il apparaît dans Sous le soleil de Satan lors de sa rencontre avec Donissan (20).
L’Imposture, splendide roman qui n’a pas fini de livrer tous ses secrets, est la plus claire préfiguration de la plongée dans les profondeurs du mal, absolument inédite dans la littérature française, que constituera le dernier roman de Georges Bernanos, Monsieur Ouine. La paroisse morte hantée par la présence délétère de l’ancien professeur de langues plonge ses fondations dans la société sans vie où se débattent et complotent les médiocres, dont Cénabre est l’accomplissement muet. Si le démon disparaît au seuil de ce livre pour ne plus jamais y reparaître, Dieu, lui aussi invisible, dont l’absence est tragiquement ressentie par les saints bernanosiens et pas seulement à l’heure de leur plus haut abandon, ne cesse pourtant d’être présent. Cette affirmation banale n’est ni une vue de l’esprit ni un acte de foi que la démarche critique aurait parfaitement raison d’écarter, mais une évidence que Georges Bernanos inscrit dans chacune de ses œuvres qui doit être lue comme la tentative, forcenée et admirable, d’atteindre, par l’écriture, au silence de la grâce.
Notes
(1) Les Enfants humiliés, in Essais et écrits de combats, tome 1 (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1971), pp. 830-831.
(2) Voir le très beau passage qui commence par les mots « Qu’à travers les ténèbres, les villes appellent, d’une voix profonde ! », à rapprocher d’un texte extraordinaire de Walter Benjamin intitulé Sur le langage en général et sur le langage humain, où l’auteur évoque, au contraire de Georges Bernanos, une création devenue muette à cause de la première faute de l’homme (que Benjamin nomme le péché de la «surdénommination») : «Être privée de langage, telle est la grande souffrance de la nature (et c’est pour la délivrer que vit et parle dans la nature l’homme, et non pas seulement, comme on le suppose en général, le poète)», in Œuvres I (Gallimard, coll. Folio Essais, 2002), pp. 162-163.
(3) Remarquons le registre animalier que Bernanos utilise pour décrire l’abbé Cénabre, qui possède ainsi une «tête osseuse, léonine», une «poitrine velue», un corps qui «d’un imperceptible écart, sitôt retenu, esquiss[e] le bond d'une bête traquée». Soulignons encore l’étonnante image décrivant Cénabre le «nez dans la laine épaisse» qu’il serre de «ses mâchoires», puis «rugissant» pour échapper «à la lumière intolérable» qui l’assaille, comme s’il était une bête blessée.
(4) Dans le n° 23 des Études bernanosiennes publiées par les éditions Minard, j’ai longuement développé les nombreux parallèles existant entre le dernier roman de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, et Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, chef-d’œuvre ambigu que nous pouvons considérer comme l’un des textes matriciels de la littérature anglo-saxonne moderne.
(5) Georges Bernanos, Correspondance inédite 1934-1948. Combat pour la liberté (Plon, 1971), p. 191.
(6) Cette scène prend place dans la deuxième partie, chapitre V, d’En route (Gallimard, coll. Folio, 1996), pp. 406-430.
(7) Voir mon étude dans les Études bernanosiennes, n° 23, op. cit., Le Démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos.
(8) Le Concept de l’angoisse (Gallimard, coll. Tel, 1990), p. 293.
(9) L’homme. La vie – La science – L’art (Librairie académique Didier, Perrin et Cie, Libraires-éditeurs, 1894), p. 7.
(10) Sören Kierkegaard, op. cit., p. 297.
(11) Catéchisme de l'Église catholique (Mame / Plon, 1992), pp. 221 et 222.
(12) Quel Enfer ?, Jean Elluin (Cerf, 1994), p. 35. L’auteur souligne.
(13) Pamphlet contre les catholiques de France, in Œuvres complètes, t. 1 (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1972), respectivement pages 894 et 895.
(14) Œuvres romanesques, Dialogues des Carmélites (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1972), p. 1157.
(15) Ontologie du secret (PUF, coll. Quadrige, 1988), p. 142.
(16) L’Enfer. Une question (Desclée de Brouwer, 1988), p. 60. L’auteur souligne.
(17) Bernanos (Seuil, coll. Écrivains de toujours, 1982), pp. 90-1.
(18) Georges Bernanos, Les Enfants humiliés, in Essais et écrits de combat, t. 1, op. cit., p. 871.
(19) Bernanos et l’Angoisse (Presses Universitaires de Nancy, 1984), p. 82.
(20) Gardons-nous toutefois des simplifications puisque, dès son premier roman, Georges Bernanos brosse du diable une peinture pour le moins complexe, comme j’ai essayé de le montrer dans une longue étude publiée dans les Archives Bernanos, n° 11 (Minard).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, georges bernanos, l'imposture |  |
|  Imprimer
Imprimer
























































