« Carcassonne de Lord Dunsany | Page d'accueil | Une vieille maîtresse de Jules Barbey d’Aurevilly, par Germain Souchet »
22/07/2007
Lettre(s) pour emmerder les catholiques progressistes
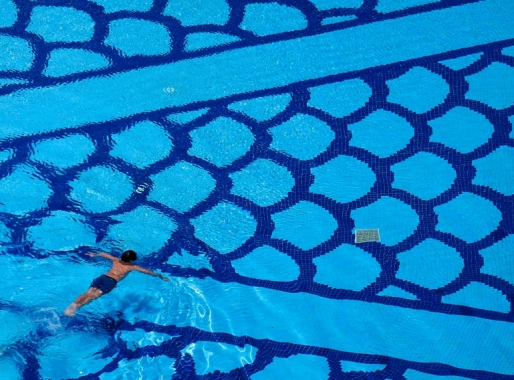
Crédits photographiques : Nicky Loh (Reuters).
«Mais je sais déjà que ma génération est celle des kamikazes, des hommes bengalores qui allument ces mèches des générations de vingt ans. Réformer et reformer l’ordre des nobles voyaugeurs. Oui, je crois à la faculté des guillotines qui tombent», Dominique de Roux à Robert Vallery-Radot, le 9 mars 1967 (je souligne).
Je passe pour un mauvais garçon alors que je suis plutôt systématiquement surpris par ma formidable capacité à écouter (je dis bien : écouter, là où entendre serait encore trop concéder aux bavards) toutes sortes d'imbéciles, auxquels je réponds en général avec la plus exquise politesse. Je ne suis toutefois jamais aussi doux, aussi débordant de mansuétude, aussi suintant de bonté que face à une catégorie bien précise de bigots qui aiment le sport, l'héritage sacré (c'est même le seul sacré qu'ils vénèrent...) de Vatican II, les messes en plein air, un Christ de praline plutôt que de douleur, un écrivain, par exemple Ernest Hello, à condition qu'il soit châtré et qui détestent par-dessus tout celles et ceux qui osent ne pas aimer, ou plutôt qui aiment trop, jusqu'au point de commettre l'irréparable, comme l'a fait par exemple le vilain extrémiste Judas, ce Juif qui à notre époque aurait parfaitement pu avoir la grossièreté de se faire exploser au milieu d'une foule compacte d'innocents Arabes. Vous pensez que j'exagère ? Où donc ? Vite, dites-moi quelle ligne mérite la géhenne et n'est pas digne de recevoir le tampon de l'imprimatur des bien-pensants, que je la jette dans les oubliettes de la Zone.
Ma catégorie d'imbéciles préférée, puisqu'il est évident qu'il y a autant d'imbéciles que d'espèces d'insectes sur Terre (il en reste à découvrir sans doute plusieurs milliers selon les spécialistes les plus pessimistes), mes imbéciles favoris, mes médiocres de prédilection, mes ânes de haute-voltige ou plutôt de hauts-plateaux, mes cancrelats de plus humide planche vermoulue, mes blattes de confessionnal les plus circonspectes, mes Sombreval (une vieille connaissance de sacristie, celui-là), ce comique mélange de Ken, d'extraordinaire prétention et de stupidité intégrale (pas intégriste, nuance) devant lequel se prosternent une petite dizaine d'oies plus dindes que blanches, tout ce joyeux bestiaire compose donc le cercle en constante expansion des catholiques progressistes, la source vive par laquelle se déverse sur la terre gaste la perpétuelle fontaine de bonne humeur où frétillent ces tanches de baptistère.
Chacun ses petites plaies n'est-ce pas, qu'il ulcère avec délicatesse et voluptueuse cruauté. Mon eczéma de contact immédiat est de cette sorte-là : purulent. Et, considérant la parole de ces médiocres comme s'il s'agissait d'un très précieux lixiviat ayant été filtré par une strate de sottise de plusieurs milliers de kilomètres, je la recueille comme si venait de m'être chuchotée la plus précieuse des confidences faites par l'augure.
Quelque expert en grammaire ou bien un simple observateur moins placide que je ne le suis, me fera remarquer que ces deux termes, catholique et progressiste, sont rigoureusement identiques, puisqu'un catholique réactionnaire ou, comble de l'abomination de la désolation, d'humeur taciturne, est un être tout simplement rigoureusement impossible, d'ailleurs interdit par les deux testaments, ces monuments de non-violence et de taizisme absolu. Il est même une absurdité. Une chimère. Un monstre-né, un pauvre phocomèle dont le corps contrefait baignera sa mélancolie (tous les monstres sont mélancoliques) dans un bocal de musée des horreurs, avec une étiquette poussiéreuse rédigée en un latin désormais absolument incompréhensible. Voyez d'ailleurs la façon si peu joyeuse dont sont morts Barbey, Bloy et bien sûr Bernanos (et que dire de son fils Michel !)... Sûr qu'ils ne tenaient pas une plume pour rire ces emmerdeurs relaps, ces empêcheurs de prier en rond, ces tristes sires à la pâle figure bronzée par le soleil blanc des limbes. Ah, vous me dites que l'existence de ces dernières est à présent contestée ? Il ne nous reste plus que l'Enfer alors. Mais celui-là aussi n'est qu'un cauchemar inventé par quelques moines crasseux du Moyen Âge ? Décidément... Alors ne demeure donc plus que l'interdiction très stricte, sous peine d'excommunication, du raout mondain, cette exquise torture des temps modernes consistant à murer vivant le récalcitrant dans l'in-pace du silence des prudes et des prudents. La punition ultime est toutefois réservée aux plus renfrognés Savonaroles : l'exécution, en deux lignes mal écrites, de votre ouvrage. Pour ces basses besognes les imbéciles qui sont des personnes discrètes et surtout pratiques font appel aux rats : il s'en trouve toujours assez pour venir mordiller votre sainte patience jusqu'à finir par la dévorer.
Il y a quelques années, tentant de placer un de mes articles, fort sombre puisqu'il évoquait le si peu joyeux drille Ernesto Sábato, dans la revue Études on le sait dirigée par les petits soldats du jésuitisme, je me trouvais assis face à une personne, une femme d'un âge et d'un visage parfaitement vagues, qui me scandalisa par sa prudente médiocrité au bout de quelques minutes à peine. Ses questions, comme l'ensemble de sa personne d'ailleurs, étaient huilés, laissaient sur la bouche ce goût rance des aliments frits dans des graisses industrielles. Parlant, me parlant, me questionnant quelque peu tout de même, elle me livra son oracle sur mon article : apocalyptique, les vénérables et pieux lecteurs de sa revue risquaient la crise cardiaque s'ils me lisaient, l'hostie avalée de travers, la congestion papale. Sa poignée de main, enduite de saint chrême, suffit amplement à me faire préférer mon dîner de la veille, où je goûtai du bout des lèvres, en compagnie d'un ami aventurier retour des forêts indonésiennes m'assurant qu'il s'agissait là d'un véritable must, une gluante purée de limaces géantes.
Je ne laissai bien sûr rien paraître de mon dégoût, étant un gentleman en toutes circonstances, même lorsque je me suis retrouvé, au dernier Salon du livre, à moins d'un mètre du stand de Libération (et que dire de celui de Technikart) où traînaient quelques déchets, ici antédiluviens, là pré-pubères, que personne ne se souciait de ramasser.
Autre rencontre avec le progressisme, autre confrontation à des fantômes intarissables et contents d'eux-mêmes.
Il y a quelques jours à peine, à l'invitation de Charles Ficat, j'écoutais avec un calme granitique ce dernier m'expliquer avec beaucoup de sérieux que Dominique de Roux n'était qu'un aventurier des lettres, pas toutes bien écrites, un de plus, il y en a tellement n'est-ce pas, qui n'avait pas même fait découvrir Ezra Pound en France, paraît-il connu depuis que de sombres universitaires avaient consacré au maudit quelques lignes illisibles dans la gazette interne de l'Université de La Poisse-sur-Flache. Rendez-vous un peu compte : ce n'est que l'activisme débordant de ce bolide marginal qui nous a fait croire, durant quelques mois, que ce fou zélé était un... écrivain ! Vous le prenez même pour un infréquentable ? Peuh, si vous voulez des auteurs dont vraiment personne n'évoque le sombre patronyme, je m'en vais vous en fournir par quintaux entiers mais, de grâce, ne me parlez pas de ce Dominique de Roux, cet Assis supérieur !
Il est vrai que le même Charles Ficat m'avait assuré qu'il fallait vivre avec son temps et que notre époque ne pouvait décemment plus s'honorer d'écrivains aussi méchants que ces vieux demi-soldes d'un catholicisme totalement passéiste (ah, pauvre Bloy, tes éructations sardoniques contre les lieux communs nous manquent tant...). Lorsque je le priai, avec une courtoisie de vieux sage chinois, et sans l'ombre même d'un sourire (et réprimant surtout coûte que coûte mon envie de lui demander s'il songeait à ses propres livres pour remplir la panse gloutonne de notre époque), de me citer un seul nom d'écrivain digne de lécher une rognure d'ongle de pied de Bernanos, Charles Ficat, prudemment, préféra attirer mon attention sur les nombreuses publications dont pouvaient s'honorer ses éditions, allant même jusqu'à m'en donner quelques-unes, à l'exception toutefois notable, malgré la manifestation sybilline de mon intérêt, des volumineux tomes de la correspondance de Dostoïevski, de toute façon prudemment disposés sur la plus haute rangée de la bibliothèque.
Je compris alors la raison pour laquelle Constance de Bartillat (récemment promue au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le Premier Ministre) et Charles Ficat n'avaient eu aucune réponse à me donner (à ce moment de notre discussion, l'un et l'autre échangèrent un regard gêné) quand je leur demandai pourquoi ils n'avaient point accepté de publier un de mes recueils d'articles sur George Steiner : mon livre était trop compliqué alors que je le trouve d'une lecture peu ardue, il n'est pas franchement progressiste et George Steiner lui-même doit sembler un fanatique aux yeux de ceux qui osaient publier Une vieille maîtresse de Barbey avec une préface de... Catherine Breillat. Pauvre Connétable des lettres, dont l'acrimonie aurait probablement transpercé de part en part nos si benoîts éditeurs, pour lesquels il faut de tout n'est-ce pas pour faire un monde.
C'est donc en pensant tendrement à Charles Ficat et à tous ses trop nombreux semblables qu'il m'a été donné de croiser durant onze années passées chez les pères maristes puis depuis l'époque où je quittai Lyon pour venir tenter de vivre à Paris que je reproduis ci-dessous quelques lignes d'une admirable lettre que Dominique de Roux adressa à Robert Vallery-Radot, le même qui était devenu le grand ami de Georges Bernanos et qui, sur le jeune De Roux, a exercé une influence très profonde, bien que peu décelable dans ses écrits.
Autre évidence, qui éclate dès les toutes premières lettres du jeune Dominique de Roux à sa tante, Gabrielle de Lestapis (nous sommes en 1953) : une voix se lit et s'écoute lorsque nous lisons à haute voix ces lettres pressées de dire le monde et la folie des hommes, la beauté des femmes et l'urgence de les aimer véritablement, une voix qui est celle d'un véritable écrivain. Que l'on me montre un seul catholique progressiste qui soit aussi un écrivain. Un écrivain vous dis-je, pas un cacographe de Procure. Un écrivain, pas un docteur spécialisé dans l'histoire du chrisme faisant maigrement suinter les jeunes filles déjà vieilles, grosses de leur future progéniture dont la Terre se passerait si aisément. Un écrivain, pas un journaliste du Monde qui vitupère avec autant de colère qu'un moustique déploie d'efforts pour percer une peau de nourrisson, qui conchie sans jamais oser chier, de peur d'incommoder la flore des égouts. Charles Ficat lui-même ? Il est vrai que l'homme a écrit quelques livres, ce qui n'est certes pas une raison de pavoiser, même à l'heure où le merveilleux progrès, tant vanté par mes amis progressistes, permet à la plus anonyme tanche de bocal d'imprimer ses déjections, en conséquence de se prétendre écrivain.
 À Robert Vallery-Radot, le 15 janvier 1964.
À Robert Vallery-Radot, le 15 janvier 1964.Mon père,
Votre lettre n’a fait que confirmer ce que je ressens dans mon apocalypse actuelle, m’incitant à poursuivre plus totalement encore le but que je me suis défini de préparer la terre aux levains futurs, puisqu’il faut que le grain se meure et que nous, nous devons passer sous la meule comme certaines autres générations ont dû mourir au feu. Nous mourrons de solitude. Notre mort sera légère et sèche comme la poussière qui vole. Tout remonte à la guerre d’Espagne, à l’ouverture des temps modernes – le dernier romantisme guerrier – et à cette fin des Temps modernes un été de 1945 à Berlin. Depuis 1945, on assiste dans le monde occidental à un morcellement de la littérature, de même qu’une terre sans eau se craquelle et sur la croûte âpre tous ceux qui avaient du talent à vingt ans à la Libération sont morts ivres de désespoir de s’être pris pour des étoiles. En notre temps, certains avaient entrepris de fixer le langage pour repartir sur le sable. Et notre époque si intelligente, qui a toute la solitude des machines, ne secrétera de grands créateurs que dans cinquante ans peut-être (en serons-nous ?). En attendant, dans le crépuscule, sur nos cerveaux humides et ondulants, se préparera l’avenir. Et nous, qui faisons tout pour avoir des frères, notre solitude est si totale que, petites silhouettes enfermées dans nos lanternes, nous nous fabriquons des lumières avant la dissolution dans l’infini.
Dominique de Roux, Il faut partir. Correspondances inédites 1953-1977 (Fayard, 2007), p. 196.



























































 Imprimer
Imprimer