« Salut à Hart Crane | Page d'accueil | Le livre des fantômes d’Alexandre Mathis, par Francis Moury »
30/05/2011
Gerard Manley Hopkins ou l'effrayante nuit de l'âme

J'ai découvert Gerard Manley Hopkins il y a quelques années, lisant avec passion le petit volume publié par La Différence dans une collection (Orphée) qui hélas n'existe plus, faute de lecteurs sans doute, comme il en va hélas pour une écriture poétique qui n'est plus, aujourd'hui, nourricière de notre monde cassé et sourd. Qui, de nos jours, avoue sans une timide réserve qu'il lit encore Saint-John Perse ou Claudel (et que dire de Char, dont l'heure de gloire semble être, fort heureusement, passée...) ? Ou même, outre-Rhin, Celan, Trakl ou Benn et tant d'autres ?
Lisant Manley Hopkins, j'avais surtout été saisi par la violence d'un long poème, jugé trop difficile et donc refusé par la publication jésuite The Month, intitulé Le naufrage du Deutschland (The Wreck of the Deutschland, 1876) évoquant un événement terrible qui eut lieu dans la nuit du 6 au 7 décembre 1875, le naufrage près des côtes du Kent de cinq nonnes franciscaines venues de Brême. Le naufrage en question était aussi celui qui avait failli engloutir l'âme et l'esprit du poète avant que le trait de feu ne le cloue, littéralement, sur place, dans une nuit qu'il savait et taisait bien que son effroi exsude de chacun de ses vers.
Geoffrey Hill, autre grand poète et excellent lecteur d'Hopkins, pouvait ainsi, dans ce même petit volume si bien pensé, fort justement affirmer, de la poésie de son aîné, que sa vocation était de racheter les temps, non pas en occultant l'horreur ou en la gommant dans une théodicée ridicule mais en proférant son insurpassable épouvante (cf. Redeming the Time, in The Lords of Limits, Londres, A. Deutsch, 1984, repris en guise de préface dans Le Naufrage du Deutschland suivi de Poèmes gallois, Sonnets terribles de Gerard Manley Hopkins, La Différence, coll. Orphée, 1991, traduit de l’anglais par René Gallet). Hill, en employant cette expression, avait sans doute à l'esprit un poème d'Hopkins datant de 1877 et intitulé Grandeur (ou Magnificence, selon le traducteur) de Dieu (God's Grandeur) où l'on peut lire ces vers :
«And all is seared with trade; bleared, smeared with toil;
And wears man’s smudge and shares man’s smell : the soil
Is bare now, nor can foot fell, being shod.»
«Tout est flétri par le lucre, terni, noirci de labeur,
Poissé de traces humaines, pénétré d’odeur humaine : le sol
Est nu désormais, et nul pied ne l’éprouve, étant chaussé.»
Voici la deuxième strophe du Naufrage du Deutschland, qui évoque cette nuit de l'âme qui, à coup sûr, a dû bouleverser ce que le grand poète appelait inscape, un mot forgé sur le modèle de landscape et que nous pourrions traduire par schème intime, paysage de l'âme se recueillant pour attendre le Christ, dans l'attente d'une fulguration aussi bien esthétique (traduite par ce sprung rhythm rappelant la vieille poésie anglo-saxonne et le Milton de Samson Agonistes) qu'intellectuelle et spirituelle :
«I did say yes
O at lightning and lashed rod;
Thou heardst me, truer than tongue confess
Thy terror, o Christ, o God;
Thou knowest the walls, altar and hour and night :
The swoon of a heart that the sweep and the hurl of thee trod
Hard down with a horror of height :
And the midriff astrain with leaning of, laced with fire of stress.»
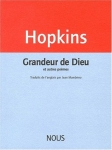 vers qui, dans la traduction impeccable de René Gallet que je préfère presque toujours à celles de Pierre Leyris et de Jean Mambrino (lequel a traduit avec son ami un volume de poésies intitulé Grandeur de Dieu et autres poèmes (Nous, coll. Now, Caen, 1999, édition revue et augmentée d'un précédent volume édité par Granit, 1980; j'imagine que c'est bien ce même volume qu'ont repris les éditions Arfuyen récemment), vers donc qui donnent en français :
vers qui, dans la traduction impeccable de René Gallet que je préfère presque toujours à celles de Pierre Leyris et de Jean Mambrino (lequel a traduit avec son ami un volume de poésies intitulé Grandeur de Dieu et autres poèmes (Nous, coll. Now, Caen, 1999, édition revue et augmentée d'un précédent volume édité par Granit, 1980; j'imagine que c'est bien ce même volume qu'ont repris les éditions Arfuyen récemment), vers donc qui donnent en français :«J’ai dit oui, pleinement
Ô à l’éclair, la puissance infligée;
Tu m’as entendu, plus vrai que langue, confesser
Ton effroi, ô Christ, ô Dieu;
Tu sais les murs, l’autel, l’heure et la nuit :
Le cœur défailli que ton passage et ton élan
Écrasants foulaient d’une terrifiante hauteur –
Et les flancs raidis sous la pesée, enserrés du feu pressant.»
Faut-il s'étonner que les responsables de la revue à laquelle le poète destinait ces vers aient été plus que décontenancés par leur audace ? Plusieurs années après cette première lecture reprise, dans l'effroi, il y a quelques semaines, nouvelle lecture durant laquelle j'ai été encore une fois brutalisé par une si admirable violence, me glacent ces vers que, comme beaucoup d'autres, qu'ils soient de Shakespeare ou de Yeats, j'ai fait miens il y a bien longtemps, mentalement, charnellement, pour ne jamais les oublier et les redire, tremblant, lors de certaine nuit où je fus déchiré par un éclair glacial, contemplant :
«The frown of his face.
Before me, the hurtle of hell
Behind, where, where was a, where was a place ?»
«La colère de son regard
Devant moi; le fracas de l’enfer
Derrière; quel, oui, quel lieu trouver ?»
Les Sonnets terribles (1885), selon le titre que leur donna le plus proche ami du poète et son exécuteur testamentaire, Robert Bridges, paraissent encore s'enfoncer davantage dans les ténèbres épaisses de la nuit de l'âme, celle que connut le poète alors que, devenu prêtre en 1877, il exercera son ministère au milieu de la misère de Liverpool puis de Glasgow, puis en tant que professeur de grec à Dublin en 1884 :
«O the mind, mind has mountains; cliffs of fall
Frightful, sheer, no-man-fathomed. Hold them cheap
May who ne’er hung there. Nor does long our small
Durance deal with that steep or deep.»
«Ô l’esprit, l’esprit a des montagnes, des parois de précipices
Affreux, à pic, par-homme-jamais-sondés. Les tient pour rien
Qui n’y fut accroché. Et notre endurance maigre
Ne peut longtemps soutenir tel abrupt ou abîme.»
Et encore :
«I am gall, I am heartburn. God’s most deep decree
Bitter would have me taste : my taste was me;
Bones built in me, flesh filled, blood brimmed the curse.
Self yeast of spirit a dull dough sours. I see
The lost are like this, and their scourge to be
As I am mine, their sweating selves; but worse.»
«Je suis fiel, brûlure d’âme. Le décret de Dieu, si profond,
A voulu pour moi ce goût amer; ce goût était moi :
Mes os bâtis, ma chair emplie, mon sang gorgé d’opprobre.
Le propre-levain d’esprit une pâte lourde aigrit. Je vois
Que les damnés sont tels, et leur enfer d’être,
Comme je suis le mien, leur être suant; mais pire.»
Et enfin, voici ce qui à mes yeux est sans doute l'un des plus beaux poèmes de langue anglaise, écrit en 1885 et lui aussi inconnu des vivants avant qu'il ne soit révélé après la mort de son créateur :
«Not, I’ll not, carrion comfort, Despair, not feast on thee;
Not untwist — slack they may be — these last strands of man
In me ór, most weary, cry I can no more. I can :
Can something, hope, wish day come, not choose not to be.
But ah, but O thou terrible, why wouldst thou rude on me
Thy wring-world right foot rock ? lay a lionlimb against me ? scan
With darksome devouring eyes my bruisèd bones ? and fan,
O in turns of tempest, me heaped there; me frantic to avoid thee and flee ?
Why ? That my chaff might fly; my grain lie, sheer and clear.
Nay in all that toil, that coil, since (seems) I kissed the rod,
Hand rather, my heart lo ! lapped strength, stole joy, would laugh, chéer.
Cheer whom though ? the hero whose heaven-handling flung me, fóot tród
Me ? or me that fought him? O which one ? is it each one ? That night, that year
Of now done darkness I wretch lay wrestling with (my God !) my God.»
«Non, je ne veux, immonde réconfort, Désespoir, pas me gorger de toi,
Ni défaire les ultimes fibres, même sans force, de l'homme
En moi, ou, harassé, crier «Je n'en puis plus». Je puis :
Puis quelque chose, espérer, souhaiter l'aube, ne pas choisir de ne pas être.
Mais ah, mais ô toi terrible, pourquoi sur moi durement mouvoir
Ton pied droit étau-du-monde ? M'infliger ta poigne de lion ? Scruter
De sombres yeux dévorants mes os meurtris ? Et souffler
Ô ces brutales rafales sur moi, ramassé, éperdu du désir de t'éviter et fuir.
Pourquoi ? Pour que s'envole ma paille, que reste mon grain, pur et net.
Et même en cette traverse, cette tourmente, puisque j'ai (je crois) accepté sa puissance,
Sa main juste, mon cœur, oui !, a eu gorgée de force, dérobée de joie, prêt à rire, applaudir.
Mais applaudir qui ? Le héros qui m'a de geste céleste jeté, du pied
Pressé ? Ou moi qui l'affrontais ? Ô des deux lequel ? Chacun d'eux ?
Cette nuit, cette année-là
De ténèbres passées, j'ai lutté, en misérable, avec (mon Dieu !) mon Dieu.»
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, poésie, gerard manley hopkins |  |
|  Imprimer
Imprimer
























































